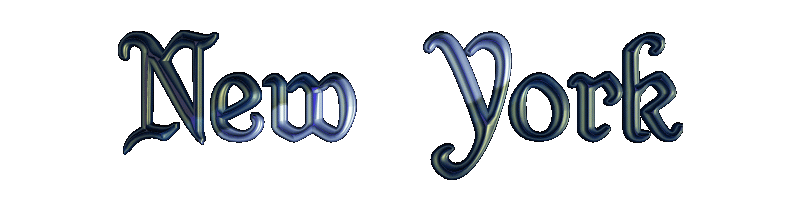
À l’arrivée des premiers Européens, la région de la baie de New York était peuplée, depuis plusieurs siècles, par des Amérindiens du groupe des Algonquins et des Iroquois. Le navigateur florentin Jean de Verrazane, qui voyageait pour le compte de la France, fut le premier Européen à y pénétrer, en avril 1524. Le site fut à nouveau exploré, en 1609, par Henry Hudson, un navigateur anglais au service de la Compagnie hollandaise des Indes occidentales. Celui-ci entra en relation avec les Indiens Algonquins et remonta le fleuve qui porte aujourd’hui son nom, sur près de 150 km.
Au début du XVIIe siècle, le Hollandais Adriaen Block établit une colonie dans la région qui prit alors le nom de Nouvelle-Hollande, et les colons commencèrent à se livrer au commerce de la fourrure. La capitale, La Nouvelle-Amsterdam, fut fondée par Peter Minuit, le directeur général de la colonie, à la pointe méridionale de l’île de Manhattan, où un fort avait été construit dès 1614, avant d’acheter l’île aux Indiens, en 1626. La colonisation de l’île de Manhattan se poursuivit au cours du XVIIe siècle et s’étendit aux quartiers de Brooklyn et du Bronx. Parallèlement, des villages s’établirent sur Long Island et sur Staten Island. Le développement de la région reposait sur les activités agricoles et commerciales.
Domination anglaise
En 1664, les Anglais s’emparèrent de la colonie et rebaptisèrent La Nouvelle-Amsterdam New York, en l’honneur du duc d’York, futur roi Jacques II et frère de Charles II d’Angleterre. Reprises par les Hollandais en 1673, la ville de New York et l’île de Manhattan furent cédées définitivement à l’Angleterre par le traité de Westminster (1674). Bien qu’enrichie au début du XVIIIe siècle par le trafic d’esclaves, ses possibilités de développement restèrent limitées par la présence des Français au Canada. Ainsi, au moment de la révolte des colonies britanniques d’Amérique, New York était un centre bien moins important que Boston ou Philadelphie. La région profita de cette période pour se doter de nouvelles institutions, en particulier dans le domaine législatif. Les Britanniques réunirent ensuite l’ensemble de leurs colonies en Amérique afin de constituer la Nouvelle-Angleterre.
Indépendance et essor économique
New York devint rapidement un centre d’anticolonialisme où les idées d’indépendance se développèrent. Foyer d’agitation contre la politique de la métropole, elle joua un rôle important dans les événements qui menèrent à la guerre de l’Indépendance américaine (1776-1783). En 1735, l’imprimeur John Peter Zenger fut emprisonné pour avoir critiqué les autorités royales. Il plaida sa cause et établit le principe de la liberté de la presse. À la suite de l’introduction du Stamp Act par le gouvernement, le mouvement révolutionnaire des Fils de la Liberté provoqua des troubles sanglants dans la ville. Le 23 avril 1775, les New-Yorkais se rendirent maîtres de leur ville et chassèrent le gouverneur royal. Mais l’échec de George Washington, à la bataille de Long Island (août 1776), livra la ville aux Britanniques qui l’occupèrent jusqu’à la fin de la guerre de l’Indépendance. New York devint alors le siège du Congrès fédéral et du gouvernement des États-Unis de 1785 à 1790, et resta la capitale de l’État de New York jusqu’au transfert vers Albany, en 1797.
L’indépendance des États-Unis et l’ouverture du canal Érié en 1825 firent la fortune de la ville. Dès l’accession à la souveraineté, le développement urbain devint très rapide. La population new-yorkaise, qui n’était encore que de 22 000 habitants en 1774, atteignit 60 000 habitants en 1800 et 550 000 en 1850. D’abord centre bancaire et financier (ouverture de la Bourse en 1792), New York devint le principal centre industriel et la première place commerciale des États-Unis, après l’achèvement du canal Érié. Celui-ci mettait le port de New York en communication directe avec les Grands Lacs et lui ouvrait les grands marchés de l’Ouest. Principal débouché des céréales en provenance des Grandes Plaines, la ville devint vers 1850 le plus grand port du pays. New York apparut dès lors comme la principale charnière entre l’Europe et les États-Unis. Avec 940 000 habitants en 1870, elle était deux fois plus peuplée que Philadelphie et trois fois plus que Boston. La ville fut, pendant tout le XIXe siècle, le point de débarquement des immigrants, dans un premier temps irlandais, allemands, juifs et italiens, qui allaient peupler les Grandes Plaines et l’Ouest américain ; puis, de nouveaux immigrants arrivèrent du sud et de l’est de l’Europe, ainsi que de la Chine.
La guerre de Sécession (1861-1865), en relançant les industries d’armement et le commerce, eut des conséquences plutôt positives pour le développement de la ville. À la même époque, la croissance démographique ne cessait de progresser, New York comptait 1,5 million d’habitants en 1890, 3,4 millions en 1900 et 7,9 millions en 1950. Les limites administratives de la ville, restreintes jusqu’en 1874 à l’île de Manhattan, atteignirent en 1898 leur cadre actuel. Le développement urbain (premier gratte-ciel en 1902), l’équipement portuaire, les communications (métro à partir de 1904, ponts sur l’Hudson et l’East River, aérodromes) se développèrent rapidement. Progressivement, la population quitta le centre de la ville pour aller s’installer dans les banlieues avoisinantes, laissant le cœur new-yorkais se détériorer. Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, la ville accueillit de nombreux immigrants noirs américains en provenance des États du Sud. Ils furent suivis dans les années cinquante par une vague d’immigration en provenance notamment de Porto Rico.
Sur le plan politique, New York souffrit entre 1868 et le début des années trente de la vaste entreprise de corruption animée par l’organisation démocrate Tammany Hall, qui contrôlait les hommes politiques, la police, les tribunaux, le gouvernement de l’État et les journaux.
Époque contemporaine
Conformément à la charte de la cité, entrée
en vigueur le 1er janvier 1963, New York est dirigée par un
maire élu pour quatre ans, à la tête du gouvernement
de la ville. Secouée dans les années soixante par de
violentes émeutes raciales, la cité est aujourd’hui gravement
touchée par la recrudescence de la criminalité et de
la drogue. Depuis 1975, elle est en outre confrontée à de
sérieux problèmes budgétaires.
En 1990, la population new-yorkaise comprenait 52 % de Blancs,
29 % de Noirs et 7 % d’Asiatiques. Les Hispaniques, essentiellement
des Porto-Ricains, représentaient 24 % de la population.
Une nouvelle vague d’immigration, en provenance de l’ex-URSS, a commencé au
début des années quatre-vingt-dix.
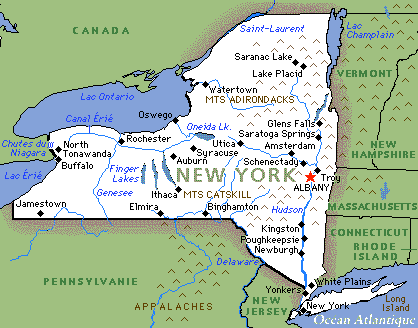
C’est la plus importante agglomération des États-Unis et l’une des plus grandes métropoles mondiales. Sa puissance et son rayonnement s’exercent à l’échelle planétaire.
Tirant parti d’une situation géographique particulièrement favorable, le site de New York couvre les îles de l’estuaire de l’Hudson, qui s’épanouit en un golfe intérieur (Upper Bay), large de 7 à 8 km. Rétréci en un passage étroit de 2 km en aval, ce dernier forme un excellent abri portuaire. Le fond rocheux de l’Hudson, à la hauteur de Manhattan, atteint 90 m. Dans le port de New York, la profondeur dépasse 20 m. Par l’Hudson et son affluent, le Mohawk, New York est reliée à la région des Grands Lacs et, au-delà, aux Grandes Plaines. Grâce à cette situation d’ouverture sur un immense arrière-pays, l’agglomération new-yorkaise s’est développée rapidement.
La ville est formée de cinq districts : au centre, Manhattan ; le Bronx, au nord-est ; Brooklyn et le Queens, à l’extrémité occidentale de Long Island ; Richmond, sur l’île méridionale de Staten Island. Les banlieues de l’agglomération new-yorkaise débordent sur les États du Connecticut à l’est, de New York au nord, et du New Jersey à l’ouest, sur la rive droite de l’Hudson.
|
|
||
 |
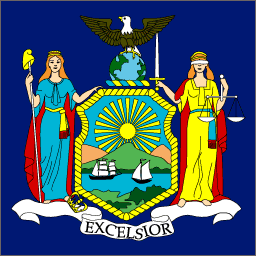 |
Il
a été adopté en
1778. Il représente une version moderne d'un drapeau de la Révolution.
Sur fond bleu, le blason de l'État. |
 |
Il
montre la Liberté et la Justice debout, chacun d'un côté du bouclier de
la Protection sur lequel a été décoré le soleil montant derrière
une chaîne de montagnes. Le bateau symbolise le commerce |
|
 |
Excelsior | adopté en 1778 |
 |
Empire
State |
L'État d'Empire Adopté depuis 1784, après que Georges Washington les eut prononcé. |
 |
I love New York |
Paroles et musique de Steve Karmen
|
 |
 |
Le Castor |
 |
 |
L'Érable |
 |
 |
La rose, adopté en
1955. |
 |
 |
L'Oiseau
Bleu ou Prolifique |
 |
 |
Les Pommes |
 |
 |
La Truite |
 |
 |
Le
Grenat |
 |
 |
L'Eurypterus
Remipes |




