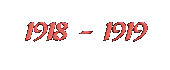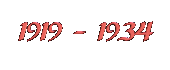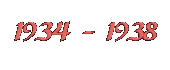Des Romains aux Slaves
Peuplées dès les temps préhistoriques, les régions qui ont formé l'Autriche étaient autrefois connues sous le nom de Norique, pour celles situées au sud du Danube ; les hautes terres à l'ouest, situées entre le Rhin supérieur et le cours inférieur de l'Inn et le plateau subalpin de la Bavière formaient la Rhétie, tandis que les plaines de l'Est et du Sud-Est correspondaient à la Pannonie. Les Romains envahissent les trois régions vers 15 av. J.-C. et en font des provinces de l'empire. Si elles sont prospères pendant la pax romana, le déclin de l'Empire romain les transforme en marches. L'un des premiers postes militaires romains de la région est celui de Vindobona (Vienne), situé sur l'emplacement d'un établissement celte. Vindobona devient un carrefour important en raison des deux routes commerciales de première importance et de nombreuses voies d'accès au bassin fertile de la Basse-Autriche. Au Ve siècle, le limes est submergé par les Barbares. Les peuples germaniques s'attaquent aux limes à plusieurs reprises dès le IIe siècle. Puis Goths, Rugiens, Lombards, Vandales, Ostrogoths et Huns traversent à un moment ou à un autre le bassin de Vienne. Les Alamans avancent en Rhétie, les Hérules prennent Juvavum (Salzbourg), et les Wisigoths avancent le long de la rivière Drave.
Les Slaves et les Avars pénètrent en Pannonie par l'est et le sud-est tandis que, presque en même temps, les Germains envahissent le nord-ouest. Au milieu du VIe siècle, les Bavarois occupent le Tyrol et les Alamans s’établissent à l'ouest. Les Slaves occupent le bassin du Danube et les Alpes du Sud. Le passage des Avars ne laisse que des traces superficielles dans le pays, mais les Slovènes créent des établissements dans les vallées dépeuplées des Alpes orientales.
L'époque médiévale
Sa lutte contre les Avars entraîne Charlemagne jusqu'au Danube. Le pays devient l'Ostmark (marche de l'Est). Soumis aux Bavarois, puis ravagé par les hordes hongroises arrêtées par Otto Ier le Grand à Lechfeld (955), l'Ostmark ressuscité est confié en 976 au commandement (Österreich qui par extension deviendra l'Autriche) du margrave Léopold de Babenberg. Cette marche étendue au-delà de la Leitha s'insère entre les territoires des Slaves du Nord, Moraves et Tchèques, et ceux du Sud, Croates et Slovènes. Outre un rôle militaire, les Babenberg font œuvre de colonisateurs et facilitent la christianisation du pays en y implantant de nombreux couvents. En 1156, ils obtiennent de Frédéric Ier Barberousse que l'Autriche soit érigée en duché héréditaire. La mort du dernier Babenberg en 1246 est suivie d'une période de troubles. Durant son règne, de 1230 à 1278, le roi Ottokar II de Bohême s'attribue l'Autriche, la Styrie et la Carniole. Son autorité est contestée par Rodolphe Ier de Habsbourg. Une fois élu saint Empereur romain germanique en 1273, il s'empare de l'Autriche et bat à Dürnkrut les troupes d'Ottokar, qui est tué. En 1283, la majeure partie du domaine d'Ottokar passe sous la domination du fils de Rodolphe, Albert Ier.
La maison des Habsbourg
L'unification de l'empire est étroitement liée à l'action de la maison de Habsbourg. Au cours des XIVe et XVe siècles, les Habsbourg étendent leurs possessions dans la partie orientale du Saint Empire. L'indivisibilité des possessions héréditaires des Habsbourg, qui correspondent peu ou prou au territoire de l'actuelle Autriche, est acquise, puis, en 1438, Albert II est élevé à la dignité impériale : commence alors la quasi-hérédité des Habsbourg au trône impérial. De 1438 à 1806 (hormis entre 1742 et 1745), les archiducs d'Autriche reçoivent le titre de saint empereur romain germanique. Son successeur Frédéric III obtient des princes de l'Empire la reconnaissance du titre d'archiduc pour le chef de la maison d'Autriche.
Durant le règne de l'empereur Maximilien Ier, de 1493 à 1519, l'empire des Habsbourg devient une puissance politique de dimension européenne. Pour ce faire, l'empereur mène une politique matrimoniale habile, notamment en épousant l'héritière des ducs de Bourgogne, Marie, et en unissant son fils Philippe le Beau (qui deviendra Philippe Ier de Castille) à Jeanne (fille de Ferdinand V d'Aragon et Isabelle Ire) : de cette union naît Charles Quint, qui devient empereur germanique après la mort de Maximilien en 1519.
Charles réunit sous son autorité les héritages de ses grands-parents, les territoires autrichiens héréditaires des Habsbourg, les Pays-Bas et l'Espagne. L'étendue de l'empire des Habsbourg le rend impossible à gouverner par un seul homme. En 1521, Charles cède à son frère Ferdinand les territoires autrichiens et une partie de l'Allemagne. La partition de la dynastie des Habsbourg en deux branches, celle d'Espagne et celle d'Autriche, est achevée quand Charles renonce au trône d'Espagne en 1556 au profit de son fils Philippe II et au titre de saint Empereur romain germanique en 1558 en faveur de son frère Ferdinand.
La Contre-Réforme
La Réforme se répand vite dans le Saint Empire romain germanique, y compris dans la très catholique Autriche. Charles V la combat par tous les moyens et son frère Ferdinand favorise l'implantation de la Compagnie de Jésus, qui doit faire de l'Autriche la citadelle de la Contre-Réforme. Dès 1563, elle monopolise l'enseignement dans le pays tout entier. L'intolérance religieuse doit conduire les États autrichiens, l'Allemagne puis l'Europe à la guerre : si la paix d'Augsbourg (1555) a apporté un répit en établissant une certaine tolérance religieuse en Allemagne pour les luthériens et les catholiques, la remise en cause des accords passés par Ferdinand II, partisan farouche de la Contre-Réforme, amène les protestants de Bohême à se révolter en 1618. Leur défaite, en 1620, à la bataille de la Montagne Blanche, donne le signal de la guerre de Trente Ans. Cette guerre impitoyable ensanglante l'Allemagne (on estime qu'elle y a perdu 50 p. 100 de sa population), et les Habsbourg eux-mêmes sortent, en 1648, affaiblis du conflit qui est réglé par les traités de Westphalie (1648). À la même époque se profile un danger extérieur : la progression rapide, dans les Balkans, de l'Empire ottoman. La lutte contre les Turcs va servir, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, de ciment à l'empire, où se côtoient de multiples nationalités.
En 1683, une armée ottomane commandée par Kara Mustapha Pacha met le siège devant Vienne. Il faut une coalition de toutes les forces catholiques — dont celles du roi de Pologne Jean III Sobieski pour les repousser et encore dix ans de luttes acharnées pour que le prince Eugène de Savoie puisse chasser définitivement les Turcs de Hongrie.
L'équilibre de cet immense empire demeure fragile. Le décès, en 1700, de Charles II d'Espagne laisse l'Espagne, les Pays-Bas espagnols et ses possessions d'Italie à Philippe, duc d'Anjou, le petit-fils de Louis XIV. L'empereur Léopold Ier ne peut laisser la France s'emparer d'un aussi vaste royaume : il revendique la couronne pour son fils Joseph Ier (voir Succession d'Espagne, guerre de). À la fin de la guerre, la France épuisée accepte les conditions autrichiennes : Philippe est reconnu roi d'Espagne (Philippe IV) mais se voit interdire toute alliance politique ou matrimoniale avec la France.
Les règnes de Marie-Thérèse et de Joseph II
En 1713, la promulgation de la pragmatique sanction règle les modalités de l'ordre de succession au trône. La fille de Charles VI, Marie-Thérèse, pourrait régner. Cette loi est la première loi fondamentale commune à tous les territoires des Habsbourg, et elle doit être le point de départ de leur intégration progressive. Son caractère unificateur est amoindri en Hongrie, qui ne l'accepte qu'après que Charles a confirmé la Constitution et l'autonomie du pays ce qui, en réalité, renforce le séparatisme hongrois. La plupart des monarques européens s'engagent à accepter la pragmatique sanction.
Un despotisme éclairé
L'avènement de Marie-Thérèse, qui, en 1736, s'est mariée avec François Ier, duc de Lorraine, commence par une crise qui a failli emporter l'empire. En dépit de la pragmatique sanction, ses droits sont immédiatement contestés (voir Succession d'Autriche, guerre de). La crise culmine lors de la guerre de Sept Ans (1756-1763). La Prusse prend à l'Autriche la majeure partie de la Silésie, mais doit reconnaître les droits de Marie-Thérèse sur l'héritage des Habsbourg. La guerre montre l'urgence de réformes centralisatrices et unificatrices.
Le fils de Marie-Thérèse, Joseph II, empereur et corégent depuis 1765, lui succède en 1780. C'était un homme acquis aux Lumières, rationaliste. En dix ans de règne, il publie 10 000 décrets et 11 000 lois nouvelles, qui doivent faire de la monarchie un État moderne et;… heureux. Il abolit entièrement le servage (sauf pour les Tziganes), améliore les procédures civiles et pénales, décrète la tolérance religieuse et la liberté de la presse, réforme l'Église catholique en s'accordant le droit d'intervenir dans les affaires ecclésiastiques et essaie de centraliser l'administration impériale. Mal comprises, ses réformes ne sont pas toujours bien accueillies ; à sa mort, la Hongrie et la Belgique sont en pleine révolte. Le frère et le successeur de Joseph, Léopold II, revient sur la plupart des réformes et est contraint de reconnaître la Hongrie comme une unité séparée des territoires des Habsbourg.
Les guerres contre la France
De 1792 à 1815, l'empire des Habsbourg est engagé dans la guerre de façon quasi permanente, d'abord du fait de la Révolution française, puis à cause des guerres napoléoniennes. La France révolutionnaire est une menace permanente pour l'Autriche. Plusieurs fois battue et envahie, l'Autriche obtient la restitution de la Lombardie, la Vénétie, l'Istrie et la Dalmatie. L'habileté diplomatique du chancelier autrichien, le prince Klemens von Metternich, au Congrès de Vienne vaut à l'empire des Habsbourg de se retrouver à la base du nouvel ordre européen. L'influence de l'Autriche, à la fois dans la Confédération germanique, qui succède au Saint Empire romain germanique, et dans la Sainte-Alliance, atteint alors son apogée.
La Révolution de 1848
De 1815 à 1848, l'empire d'Autriche, dirigé par Metternich, se consacre principalement au maintien du statu quo, à l'intérieur comme à l'extérieur. À long terme, cette politique va mener l'empire — construction historique habitée par des peuples divers — à sa perte. La première erreur est de ne pas s'apercevoir que le concept de nationalité a changé de contenu, glissant de la conception étatique à une conception ethnique. Le maintien dans l'empire de populations de langues et de cultures différentes oblige l'État à des contorsions curieuses : ainsi, en 1800, dans les armées autrichiennes, les ordres sont donnés en latin afin de ne pas risquer de vexer une nationalité. Une autre erreur est de ne pas voir que le ferment nationaliste et libéral lève d'autant plus vite que les cadres féodaux éclatent. En Transylvanie, les seigneurs sont magyars, les paysans roumains ; en Bucovine, les seigneurs polonais, les paysans ruthènes. Essentiellement rural et agricole, l'empire connaît dès 1820 un essor industriel significatif. Les tensions sont exacerbées par les mutations sociales et la Sainte-Alliance, transformée en « société de secours mutuel » pour permettre aux souverains européens de lutter contre toute subversion sur leur territoire, comme en Italie.
C'est dans ce contexte, aggravé par une crise de subsistance, qu'éclate la crise révolutionnaire de 1848, qui est plus grave en Autriche que partout ailleurs. À Vienne, en mars 1848, un mouvement de révolte oblige Metternich à démissionner. La révolution se répand rapidement quand les Allemands, les Magyars, les Slaves et les Italiens se retournent contre le régime impérial. Ferdinand Ier abdique en décembre, et son neveu de dix-huit ans, François-Joseph Ier, monte sur le trône, qu'il occupe jusqu'en 1916. Le nouvel empereur promulgue une Constitution pour l'Autriche, qui institue un gouvernement de type parlementaire et délivre les paysans des charges féodales (de la corvée notamment) ; les tziganes sont libérés. Bénéficiant du manque de synchronisation des différents mouvements nationaux et révolutionnaires, l'Autriche peut récupérer un certain nombre de ses possessions, au prix évidemment de concessions, mais aussi grâce à une répression féroce, comme en Hongrie, où le soulèvement populaire mené par Petofi et Kossuth de 1845 à 1849 se solde par un bain de sang.
L’empire austro-hongrois de François-Joseph
Congrès de Berlin (1878) Le 13 juin 1878 s'ouvre à Berlin un congrès international accueillant les représentants des grandes nations européennes : Anglais, Allemands, Français, Austro-Hongrois, Italiens, Russes et Ottomans doivent réviser les termes du traité de San Stefano, signé le 3 mars, qui a consacré le démantèlement de l'Empire ottoman au seul profit de la Russie. Sous la présidence du chancelier allemand Otto von Bismarck, les délégations s'accordent, après un mois de pourparlers, pour un nouveau partage des territoires balkaniques (13 juillet). Le congrès permet notamment à l'Autriche-Hongrie d'occuper - jusqu'à une annexion radicale en 1908 - la Bosnie-Herzégovine.
Hésitant entre une monarchie fédérative ou centralisatrice, François-Joseph, devant l'opposition des Allemands centralistes et des Hongrois autonomistes, proclame une Constitution centralisatrice, la patenta du 26 février 1861. Après la bataille de Sadowa (1866), l'empereur se résigne à transiger. En 1867, François-Joseph divise l'empire en deux États, la Cisleithanie et la Transleithanie (Hongrie), égaux en droits et soumis au même souverain. Ce compromis donne à la Hongrie sa propre Constitution et une quasi-indépendance. L'Empire austro-hongrois est né.
Cette monarchie duale ne peut, en consacrant les prétentions des Magyars et des Allemands à l'hégémonie sur les autres peuples de l'empire, que mécontenter ceux-ci. Les Tchèques, un groupe ethnique de cinq à six millions de personnes, ne peuvent faire reconnaître leurs droits, bloqués par l'opposition des Allemands et des Hongrois. À la veille de la Première Guerre mondiale, trois périls menacent toujours l'empire : le séparatisme hongrois, le pangermanisme et le panslavisme.
Le premier est contrebalancé par la crainte de l'expansionnisme russe, qui rend nécessaire malgré tout l'union avec l'Autriche ; le pangermanisme est le fait d'une minorité bruyante, réclamant une unité de plus en plus étroite de l'Autriche avec l'Allemagne et qui trouve un écho favorable au sein de l'empire allemand, établi en 1871. Le panslavisme constitue un danger beaucoup plus redoutable en raison de l'attitude de la Russie, qui s'est autoproclamée protectrice des Slaves du Sud. C’est dans les Balkans que se joue le sort de la monarchie. Les Habsbourg modifient leur politique vis-à-vis de l'Allemagne et des Balkans. Le ministre des Affaires étrangères, le comte Gyula Andrássy, Hongrois d'origine, promet que l'Autriche-Hongrie restera en dehors des affaires internes de l'Allemagne ; en échange, l'Allemagne soutiendra l'Autriche-Hongrie dans ses tentatives de limiter l'influence russe dans les Balkans. Quand la Russie vainc les Turcs en 1878, l'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne et la Grande-Bretagne, intervient afin d'empêcher les Russes de s'emparer de toute la Turquie européenne. Le congrès de Berlin (1878) limite les acquisitions russes ; il permet également à l'Autriche-Hongrie d'occuper la Bosnie-Herzégovine puis de l'annexer (1908). En 1879, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie signent une alliance officielle que rejoint l'Italie en 1882 (voir Triple-Alliance).
Toutes ces conquêtes accroissent le nombre des Slaves, qui sont 21 millions en 1913 sur un total de 51 millions d'habitants, alors que, depuis 1908, les visées autrichiennes se concentrent sur le petit État créé en Serbie en 1878. Quand la Serbie sort vainqueur de la guerre des Balkans et territorialement agrandie, les dirigeants austro-hongrois voient qu'une grande Serbie est en voie de formation ; celle-ci ne fait pas mystère d'aider les Slaves soumis à la domination austro-hongroise. De cette hostilité réciproque découle le tragique incident qui déclenche le premier conflit mondial.
La Première Guerre mondiale
Le 28 juin 1914, l'héritier au trône austro-hongrois, l'archiduc François-Ferdinand, et sa femme sont assassinés dans la capitale bosniaque de Sarajevo par un nationaliste serbe, Gavrilo Princip. Après avoir reçu l'assurance du soutien de l'Allemagne, le ministère des Affaires étrangères austro-hongrois adresse un ultimatum au gouvernement serbe, le rendant responsable de l'assassinat et lui laissant un délai de trois jours pour accepter l'ensemble des conditions de l'Autriche-Hongrie. En dépit d'une réponse conciliante des Serbes, qui cèdent sur tous les points sauf deux, et des efforts de médiation des puissances européennes, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet. C'est avec la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie et à la France au début du mois d'août que le conflit se transforme en Première Guerre mondiale.
Sans entrer dans le détail de la guerre, il faut remarquer que la majorité des sujets de l'empire reste fidèle à la monarchie. Malgré le manifeste du 16 octobre 1918, par lequel Charles Ier promet une solution fédérale et une large autonomie, l'édifice impérial s'écroule. L'armistice est signé le 3 novembre 1918. Appliqué un jour plus tôt que prévu, il provoque la débâcle de l'armée impériale ; les contingents allogènes rentrent chez eux. Les Croates et les Slovènes proclament leur union avec la Serbie, les Tchèques et les Slovaques proclament leur indépendance. Le mythe habsbourgeois autour duquel s'est forgé le sentiment national autrichien a vécu. Il se répand alors chez les Allemands d'Autriche l'idée d'une « communauté de destin » avec le « grand frère allemand » et l'idée de l'Anschluss commence à faire son chemin dans les esprits.
La République autrichienne (1918-1938)
Déséquilibres économiques et politiques
Le 12 novembre 1918, la république est proclamée et Charles Ier abdique. Réduit aux pays alpins assez pauvres, avec une capitale hypertrophiée, cet État artificiel ne trouvera jamais son équilibre. D'emblée, trois forces politiques s'affirment : les chrétiens-sociaux, conservateurs, catholiques et monarchistes s'appuyant sur le monde rural ; le Parti social-démocrate, dont l'idéologie est connue sous le nom d'« austro-marxisme », s'appuyant sur le prolétariat des villes industrielles ; les pangermanistes, attirés par l'Allemagne. Les antagonismes aggravés par la crise économique mènent à la formation de groupes paramilitaires, le Heimwehr à droite, le Republikanischer Schutzbund à gauche.
Vienne reste en majorité socialiste. Le 15 juillet 1927, les socialistes organisent un soulèvement insurrectionnel pour protester contre l'acquittement d'extrémistes de droite, accusés de meurtre. C’est un échec et deux ans plus tard, la Constitution est révisée, en décembre 1929 : un État plus autoritaire et corporatif se met en place, toujours dominé par les chrétiens-sociaux.
Nazisme et Anschluss
La crise de 1929 aggrave la situation économique et c'est vers l'Allemagne que se tourne l'Autriche. En mars 1931, les deux gouvernements s'engagent à réaliser l'union douanière. La menace d'une annexion future par l'Allemagne alarme la Société des Nations. La montée du nazisme autrichien ajoute un nouveau facteur de déstabilisation. Face à l'amenuisement de son électorat et à l'opposition grandissante de la gauche et de l'extrême droite, le chancelier chrétien-social Engelbert Dollfuss prononce la dissolution du Parlement en 1933 et gouverne par décrets. Soutenu par l'armée et le Heimwehr (Défense de la patrie), il écrase à coups de canon les émeutes ouvrières de février 1934, interdit le Parti socialiste puis tous les autres partis, hormis le Front de la patrie, qu'il a créé. Mais le 25 juillet 1934, victime de ses erreurs politiques, le chancelier Dollfuss tombe sous les balles des tueurs nazis. Le nouveau chancelier, Kurt von Schuschnigg, ne peut enrayer la dérive du régime. L'Anschluss n’est évité de justesse que parce que Benito Mussolini a mobilisé l'armée italienne. La Wehrmacht n'étant pas prête, le chancelier allemand Hitler recule pour la première et la dernière fois. Schuschnigg, sous la pression d'Adolf Hitler, organise un plébiscite pour ou contre l'Anschluss, le 13 mars 1938. La veille, les troupes allemandes ont occupé le territoire autrichien et le 14 mars, Hitler entre triomphalement dans Vienne. Le 10 avril, Hitler organise à son tour un plébiscite qui consacre le fait accompli. L'Autriche devient l'Ostmark, la province orientale du Troisième Reich.
La seconde République au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
Les zones d’occupation alliées
En avril 1945, les troupes soviétiques libèrent la partie est de l'Autriche, dont Vienne. Le territoire de l'Autriche, placé sous contrôle allié, est divisé en quatre zones d'occupation (États-Unis, Grande-Bretagne, URSS, France). Un gouvernement provisoire, dirigé par l'ancien chancelier socialiste Karl Renner, élu premier président de la nouvelle République, est reconnu en octobre 1945 par les puissances occupantes occidentales. La dénazification est entreprise, mais menée incomplètement dans la mesure où l'Autriche n’est pas reconnue coupable au même titre que l'Allemagne.
La première tâche du gouvernement de coalition du chancelier Léopold Figl est d'instituer un programme d'aide. L'Organisation des Nations unies pour l'assistance et la reconstruction (ONUAR) apporte une aide importante et, au milieu de l'année 1947, tout danger de famine est écarté. Le redressement économique est grandement facilité après 1948 grâce à l'aide des États-Unis, offerte dans le cadre du plan Marshall. Dès 1951, la production industrielle a dépassé les chiffres d'avant-guerre.
Le traité d’État (1955)
Sur le plan international, l'Autriche récupère sa souveraineté pleine et entière en 1955, après de longues négociations qui ont débuté en 1947. La question essentielle entre l'URSS, d'un côté, et les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, de l'autre, est l'avenir de l'Allemagne. Les quatre pays alliés et l'Autriche signent le traité d'État le 15 mai 1955 : celui-ci signifie le rétablissement officiel de la République d'Autriche. Le traité interdit l'Anschluss entre l'Autriche et l'Allemagne, prive l'Autriche du droit de posséder ou de fabriquer des armes nucléaires ou des missiles guidés, et l'oblige à réserver à l'URSS une partie de sa production de pétrole brut pendant plusieurs années. Toutes les forces d'occupation se retirent au mois d'octobre 1955, et le Parlement adopte une loi constituante prévoyant la neutralité militaire de l'Autriche. En décembre, l'Autriche adhère à l'Organisation des Nations unies.
L'ère du bipartisme
En 1957, l'Autriche est impliquée dans un différend avec l'Italie concernant le statut des Autrichiens du Tyrol du Sud — lequel est sous autorité italienne depuis 1919. L'arrangement qui est enfin conclu en 1970 appelle la mise en œuvre de l'accord de 1946 garantissant les droits linguistiques et culturels de la population autrichienne germanophone. En 1960, l'Autriche signe le traité qui établit l'Association européenne de libre-échange. En juillet 1961, le gouvernement annonce son désir de parvenir à une association avec la Communauté économique européenne (CEE, à présent Union européenne) qui soit compatible avec sa neutralité militaire. L'opposition initiale du Parti socialiste à l'adhésion s'affaiblit peu à peu, et, en 1972, l'Autriche signe un accord bilatéral de libre-échange avec la CEE.
L’Autriche contemporaine
La chancellerie de Bruno Kreisky (1970-1983)
Les socialistes remportent une courte victoire électorale en 1970, ce qui, pour la première fois, leur permet d'être le parti le plus représenté à l'Assemblée nationale. Toutefois, faute de majorité, le dirigeant socialiste Bruno Kreisky essaie en vain de former une coalition avec le Parti populiste. En mai, il est nommé chancelier et forme le premier cabinet autrichien entièrement socialiste, soutenu à l'Assemblée nationale par le Parti libéral. Lors des élections de 1971, les socialistes remportent la majorité absolue de 93 sièges et sont en mesure de gouverner seuls. Les initiatives de Kreisky en matière de politique étrangère donnent à l'Autriche une envergure internationale considérable. Mais, en dépit de la popularité et des réalisations de Kreisky, l'opposition progresse autour des questions d'environnement, de scandales financiers, de projets d'augmentation des impôts, et particulièrement de la construction d'une centrale nucléaire à proximité de Vienne. Quand, lors du référendum de 1978, les antinucléaires remportent une courte victoire, le gouvernement est contraint d'arrêter la construction de la centrale, pourtant presque terminée. Kreisky donne sa démission en 1983, après que les socialistes ont perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale.
De Fred Sinowatz à Viktor Klima (1983-2000)
Le nouveau chancelier, Fred Sinowatz, un socialiste, forme une coalition avec le Parti libéral, mais l'alliance est rompue en 1986 quand le Parti libéral vire brusquement à droite. La mauvaise gestion et les licenciements dans le secteur public, associés à la controverse concernant des privatisations, alimentent le mécontentement à l'égard du gouvernement et des socialistes. L'élection présidentielle de 1986 est remportée par le candidat populiste conservateur Kurt Waldheim, ancien secrétaire général des Nations unies, bien qu'il soit accusé d'avoir menti à propos de ses actions dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Ce vote est le reflet de l'attitude ambiguë d'un grand nombre d'Autrichiens à propos du passé nazi de leur pays.
Après les élections législatives de novembre, le chancelier Sinowatz démissionne et Franz Vranitsky, un autre socialiste, entre en fonctions en formant une coalition avec le Parti populiste (ÖVP). Son gouvernement doit faire face à des diminutions budgétaires continues dans le secteur public, à des déficits budgétaires élevés et aux réactions négatives de l'étranger à la suite de l'élection de Waldheim. La coalition survit aux élections d'octobre 1990, qui voient les socialistes remporter 80 sièges à l'Assemblée nationale. Le Parti du peuple perd 17 de ses 77 sièges, et le Parti libéral de droite remporte 15 sièges sur un total de 33. L'électorat, particulièrement celui de la nouvelle classe moyenne, semble être en train de changer. Pourtant, en 1992, le candidat du Parti populiste, Thomas Klestil, diplomate de carrière et ancien ambassadeur aux États-Unis, est élu président. Il promet d'appuyer la demande d'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne (UE), qui a été déposée en 1989. En avril 1998, il est réélu président.
Franz Vranitsky, critiqué au sein de son parti à la suite de la défaite du Parti social-démocrate (SPÖ) aux élections législatives de 1996, démissionne du poste de chancelier et de la présidence du parti en janvier 1997. L'ancien ministre des Finances Viktor Klima lui succède dans ces deux fonctions.
L'adhésion à l'Union européenne
Interrompues en 1993, en raison de divergences portant sur la limitation de la circulation des poids lourds sur les routes alpines — qui sera limitée jusqu’en 2001 —, les négociations en vue de l’intégration de l’Autriche dans l’Union européenne (UE) aboutissent en mai 1994, et l’Autriche y fait son entrée en janvier 1995.
Grâce à un « train de restrictions budgétaires » très sévères, l'Autriche peut faire partie, en mars 1998, des onze pays qualifiés pour intégrer la future Union économique monétaire (UEM) en 1999. Dans le même temps, elle adhère aux accords de Schengen (novembre 1997), qui prévoient la libre circulation des personnes entre les différents pays membres, et ratifie le traité d’Amsterdam en 1998. Mais son adhésion à l'Union européenne provoque une crise d'identité, relançant le débat sur le maintien ou non de sa neutralité, tandis que l'effondrement des régimes communistes dans les pays de l'Est voisins entraîne un afflux d'immigrés.
Cette situation favorise l'essor du Parti libéral (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), parti d’extrême droite dirigé par Jörg Haider, qui, lors des élections régionales de mars 1999, arrive en tête en Carinthie (42,1 p. 100 des suffrages) et progresse également au Tyrol et dans la province de Salzbourg. Face à cette avancée de la droite nationaliste, la coalition gouvernementale (sociaux-démocrates et conservateurs) se mobilise. Aux élections européennes du 13 juin 1999, les sociaux-démocrates ne devancent les conservateurs que d’un point, soit respectivement 31,7 p. 100 des voix contre 30,6 p. 100 (7 sièges chacun au Parlement européen), tandis que l’extrême droite est en léger repli (23,5 p. 100 des suffrages, soit 5 sièges).
La chancellerie de Wolfgang Schüssel (2000- )
Wolfgang
Schüssel Leader du Parti populiste autrichien (ÖVP),
Wolfgang Schüssel forme en février 2000 une coalition avec
le parti de Jörg Haider, le Parti libéral (FPÖ), et devient
chancelier d'Autriche. Cette alliance avec un parti d'extrême droite
provoque des réactions très critiques, tant à l’étranger
(notamment au sein de l’Union européenne) qu’en Autriche même,
de la part de la jeunesse et des forces de gauche.
Aux élections législatives d’octobre 1999, le FPÖ,
avec 26,9 p. 100 des suffrages, devance légèrement les
conservateurs de l’ÖVP (415 suffrages de moins) et s’affirme comme
la deuxième force politique du pays après les socialistes
du SPÖ (33,1 p. 100 des suffrages). Menée par le conservateur
Wolfgang Schüssel, la coalition gouvernementale conservateurs-extrême
droite, à laquelle ne participe pas Jörg Haider, est investie
par le président de la République Thomas Klestil en février
2000. Cette coalition, critiquée au sein même de l’Autriche,
est réprouvée par les quatorze membres restants de l’UE,
qui suspendent leurs relations officielles avec Vienne, tandis que les États-Unis
réduisent les leurs, et lui imposent des sanctions bilatérales.
Succédant à Viktor Klima, Alfred Gusenbauer prend la tête du SPÖ à la fin avril. Après trente ans au pouvoir (dont treize en coalition avec les conservateurs), ce parti en pleine crise se retrouve dans l’opposition. De son côté, Jörg Haider quitte la présidence du FPÖ en mai 2000, assumée dès lors par la vice-chancelière Suzanne Riess-Passer, sa plus fidèle alliée. Tandis qu’au sein de l’UE s’opposent partisans de la fermeté et partisans d’une normalisation des rapports avec l’Autriche, Haider évoque un retrait de son pays de l’UE si cette dernière ne lève pas ses sanctions, menace qui embarrasse les conservateurs restés fidèles aux engagements communautaires.
Les relations avec l’Union européenne finissent par se normaliser et, en septembre 2000, les sanctions sont levées. Sur le plan intérieur, les manifestations d’hostilité au nouveau gouvernement s’essoufflent au cours de l’année 2000, mais le FPÖ enregistre plusieurs revers électoraux, notamment lors des élections dans les États de Styrie et du Burgenland en 2001 et surtout en mars 2001 lors des élections municipales à Vienne. Ayant mené personnellement campagne sur des thèmes xénophobes, Jörg Haider voit en effet son parti passer de 27,9 p. 100 en 1996 à 20,16 p. 100, tandis que le SPÖ retrouve la majorité absolue dans la capitale autrichienne. Cette série de revers fragilise la coalition gouvernementale, critiquée aussi pour sa politique libérale en matière économique, et répressive en matière de délinquance (notamment en ce qui concerne les toxicomanes). Le 1er janvier 2002, l’euro est mis en circulation avec succès en Autriche, de même que dans les onze autres pays de l’Union européenne (UE) qui l’ont adopté comme monnaie unique.
À la suite de divergences politiques internes au FPÖ, se traduisant par la démission de la vice-chancelière Suzanne Riess-Passer et par celle du ministre des Finances, le chancelier Wolfgang Schüssel dissout le gouvernement et convoque des élections législatives anticipées en novembre 2002. Les conservateurs de l’ÖVP en sortent largement vainqueurs avec 42,3 p. 100 des suffrages (+ 16) — ils sont en tête du scrutin pour la première fois depuis 1966 —, devant les sociaux-démocrates du SPÖ qui en recueillent 36,5 p. 100. L’ÖVP réussit ainsi à reconquérir une large partie des électeurs du FPÖ (- 16) qui descend à 10 p. 100 tandis que les Verts obtiennent 9,5 p. 100 des suffrages. Mais, après trois mois de négociations avec le SPÖ puis les Verts, le chancelier sortant est finalement amené à se tourner à nouveau vers le FPÖ avec lequel il trouve un accord le 28 février 2003. La coalition ÖVP-FPÖ est donc reconduite, l’ÖVP détenant 11 ministères et secrétaires d’État contre 6 pour le FPÖ.

Autriche, en allemand Österreich, officiellement république d'Autriche. Pays d'Europe centrale, elle est limitrophe de la république Tchèque au nord ; de la Slovaquie au nord-est ; de la Hongrie à l'est ; de la Slovénie, de l'Italie, et de la Suisse au sud ; du Liechtenstein, de la Suisse et de l'Allemagne à l'ouest. La superficie de l'Autriche est de 83 858 km². Vienne est la capitale et la plus grande ville du pays.
Avec la Suisse, l'Autriche est le pays le plus alpestre d'Europe. Les Préalpes de Bavière, de Salzbourg, les Alpes de Carinthie, de Styrie, des Tauern et du Tyrol couvrent à elles seules 80 % du pays. Les régions subalpines se limitent à quelques plaines étroites et au bassin du Danube. Le relief de l'Autriche est récent et la configuration des Alpes orientales, qui constituent la majeure partie du territoire autrichien, trois bandes parallèles alignées d'est en ouest, est typique des systèmes alpins. On observe une première zone très élevée, les Hohe Tauern, qui culminent au Grossglockner (3 797 m) et dont l'altitude décroît vers l'est ; puis, au sud, les hautes Alpes, séparées des Alpes carniques par le sillon de la Drave. Au nord, elles sont doublées par des Préalpes, qui se développent au-delà des hautes vallées des affluents du Danube, l'Inn, la Salzach, l'Enns et la Leitha. Ces cours d'eau rejoignent le Danube vers le nord, séparant les Préalpes par de superbes cluses transversales. Au nord, les Préalpes s'abaissent et rencontrent la plaine danubienne. À l'est, la vallée du Danube s'élargit après Vienne dans la plaine de Moravie et, vers le sud-est, entre la Leitha et les Alpes de Styrie, dans le Burgenland — qui est une avancée de la grande plaine de Hongrie. L'altitude moyenne du pays est proche de 910 m. Les principales chaînes comprennent les Alpes du Tyrol du Nord et les Alpes de Salzbourg. Au centre, les Alpes noriques avec les Hohe Tauern et les Nieder Tauern, au sud, les Alpes carniques et les Alpes du Karawanken. Les Alpes autrichiennes, comme en Italie, sont percées par des cols, dont les plus importants sont le col du Brenner et celui de Semmering. Au nord du Danube, l'Autriche ne possède que la retombée méridionale du massif de Bohême.
Les plaines sont situées dans les zones frontalières du nord et de l'est. La partie septentrionale correspond à de hauts plateaux ondulés, et la région frontalière de l'est se situe en partie dans le bassin du Danube.
L'Autriche, à l'exception du Vorarlberg — tributaire du Rhin et du massif de Bohême drainé par la Vltava (Moldau) —, fait partie du bassin hydrographique du Danube. Celui-ci entre en Autriche à Passau, à la frontière allemande, à 290 m d'altitude ; il draine le pays en bordure des plateaux préalpins, d'ouest en est, sur près de 350 km. Les deux grandes métropoles autrichiennes, Linz et Vienne, sont situées sur son cours. Les affluents autrichiens du Danube sont l'Inn, qui forme une partie de la frontière austro-allemande, la Traun, l'Enns et l'Ybbs. Le seul affluent important de la rive gauche du Danube est la Morava, qui se confond avec la frontière slovaque à Bratislava et conflue avec le Danube quand il entre en Hongrie. La Drave et ses affluents drainent tout le Tyrol oriental. Moins riche que la Suisse en lacs, l'Autriche possède néanmoins de beaux lacs glaciaires dans les Hohe Tauern et à ses extrémités occidentale et orientale, le lac de Constance (Bodensee) et le lac de Neusiedl, dans le Burgenland.

 |
 |
|
 |
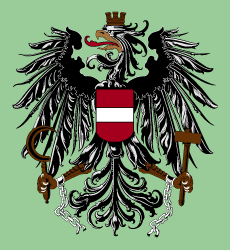 |
|
 |
|
|
 |
|||
 |
 |
 |
|
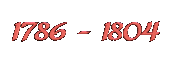 |
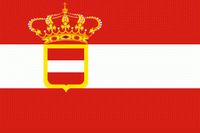 |
 |
|
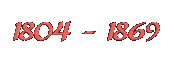 |
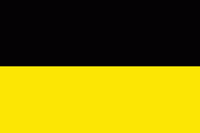 |
 |
|
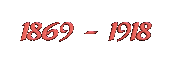 |
 |
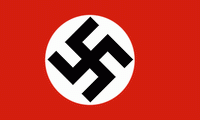 |
|
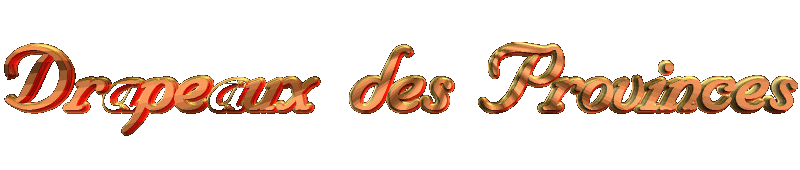 |
|||
 |
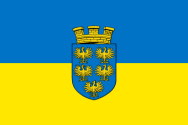 |
|
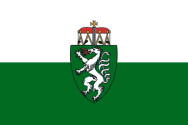 |
 |
 |
|
 |
 |
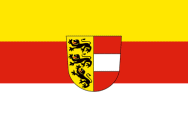 |
|
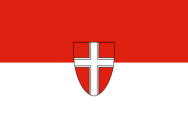 |
 |
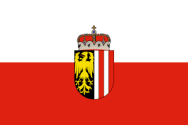 |
|
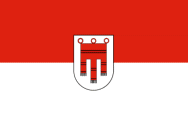 |
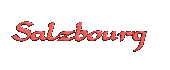 |
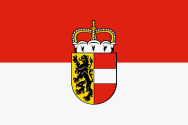 |
||
Certains
des éléments
de cette page proviennent des sites suivants :
|