
Selon les archéologues, la Norvège était déjà habitée, il y a 14 000 ans, par un peuple de chasseurs paléolithiques venus d’Europe centrale et d’Europe occidentale. Plus tard, des paysans originaires du Danemark et de Suède s’établissent dans le pays. Ils parlent un langage germanique dont sont issues les langues scandinaves. Ces nouveaux arrivants s’installent autour des grands lacs et des fjords, les montagnes formant des frontières naturelles entre les zones habitées. Chaque communauté est d’abord dominée par une aristocratie, puis par un roi local. À l’époque des premiers documents de l’histoire scandinave, au VIIIe siècle apr. J.-C., il y a quelque 29 petits royaumes.
L’âge des Vikings
Très vite, les rois s’intéressent à la mer qui constitue le moyen de communication le plus simple avec le monde extérieur. Vers 800 apr. J.-C., des navires de guerre sont construits et envoyés en mission pour effectuer des raids ; s’ouvre ainsi l’ère des Vikings. Ces guerriers du Nord sont marchands, colonisateurs, explorateurs et pillards. Autour de l’an 875, ils fondent des colonies en Irlande, en Écosse, en Islande ainsi que dans les îles Orcades, Féroé et Shetland.
Un siècle plus tard, vers 985, Erik le Rouge les guide vers le Groenland depuis l’Islande. Son fils, Leif Eriksson, est l’un des premiers Européens à explorer l’Amérique du Nord.
Au IXe siècle, le roi Harald Ier Hårfager, originaire du Vestfold (sud-est de la Norvège), tente d’unifier, pour la première fois, les royaumes norvégiens. Après avoir accédé au trône du Vestfold, il réussit à asseoir sa suprématie sur tout le territoire un peu avant l’an 900. Cependant à sa mort, vers 933, ses fils divisent le royaume. Les dissensions entre les héritiers d’Harald minent l’unité et de nombreux chefs de clan refusent de se soumettre. À ces difficultés internes s’ajoutent les tentatives d’annexion des souverains danois et suédois.
Les débuts du christianisme
En 995, Olav Ier Trygevsson, arrière-petit-fils d’Harald Ier, devient roi. Avant son couronnement, Olav vit en Angleterre où il est baptisé. Il décide donc de convertir la Norvège au christianisme et y réussit partiellement. Cinq ans après son accession au trône, il se heurte à l’opposition du roi de Danemark Sven Ier Tveskägg et est tué au combat. La Norvège, divisée pendant une courte période, est réunifiée par Olav II Haraldsson, devenu roi en 1015. Celui-ci poursuit l’œuvre religieuse de ses prédécesseurs en passant par les armes tout sujet qui refuse de se faire baptiser. Olav II est le plus puissant de tous les rois qui l’ont précédé, mais les nobles, alliés au roi d’Angleterre et de Danemark, Canut le Grand, le forcent à s’exiler en Russie en 1028. Deux ans plus tard, Olav II revient en Norvège où il est tué. Canonisé, il devient le saint patron de la Norvège.
Les rois norvégiens
Canut le Grand En 1013, Canut le Grand prend part à la conquête de l'Angleterre aux côtés de son père, le souverain danois Sven Ier Tveskägg. Après la mort du roi anglais Edmond II Ironside en 1016, il s'empare du trône d'Angleterre, avant d'obtenir ceux du Danemark (1018) et de la Norvège (1028).
Marguerite Ire Valdemarsdotter
Reine du Danemark, Marguerite Ire Valdemarsdotter assure la régence du royaume de Norvège à la suite
du décès de son mari, Haakon VI, en lieu et place de son
fils, dont le jeune âge lui interdit d'exercer effectivement le
pouvoir. Imaginant un avenir commun pour les deux royaumes, elle proclame
l'Union de Kalmar en 1397, après y avoir intégré la
Suède, dont elle occupe le trône depuis 1389.CORBIS-BETTMANN/Hulton-Deutsch
Collection
Agrandir
À
la mort de Canut le Grand en 1035, le fils d’Olav II, Magnus Ier Olavsson
le Bon, est rappelé de Russie par les partisans de son père.
Il devient roi, puis unifie le Danemark et la Norvège sous son
autorité. Pendant les trois siècles suivants, une succession
de rois règnent sur la Norvège. Malgré les guerres
et les luttes dynastiques, l’unité de la Norvège commence à s’affirmer.
Elle bénéficie d’une relative prospérité grâce à ses
flottes marchandes. À la même époque, l’Église
norvégienne se renforce, le clergé devenant l’une des plus
puissantes autorités du royaume. En 1046, Magnus nomme son oncle
Harald Hådråde cosouverain. À la mort de Magnus, un
an plus tard, Harald devient roi sous le nom de Harald III Hådråde,
mais est tué lors de l’invasion de l’Angleterre en 1066.
Le dernier souverain issu de sa lignée est Sigurd Ier, qui règne de 1103 jusqu’à sa mort en 1130. Parmi ses successeurs, Sverre, roi de 1184 à 1202, est le plus remarquable. Homme d’État très habile, il établit une monarchie puissante et affaiblit le pouvoir du clergé et de la noblesse. Sous le règne de Haakon IV Haakonsson l’Ancien, de 1217 à 1263, la Norvège atteint l’apogée de sa puissance économique, politique et culturelle au Moyen Âge. L’Islande est alors annexée au royaume en 1262, et l’autorité royale est renforcée par Haakon et par son fils, Magnus VI Lagaböte. L’aristocratie terrienne est affaiblie par Haakon V, monarque de 1270 à 1319. Les vieilles familles nobles déclinent ensuite graduellement et la Norvège devient surtout une nation de paysans. La Ligue hanséatique détourne à son profit le commerce en mer du Nord et contrôle toute l’économie de la région.
En 1319, à la mort d’Haakon V qui n’a pas d’héritier mâle, le royaume échoit à Magnus II de Suède. En 1343, son fils Haakon VI le remplace sur le trône. Puis c’est le tour, en 1380, du fils de celui-ci, Olav II, roi de Danemark, qui devient le roi Olav IV de Norvège. Le jeune roi n’exerce qu’un pouvoir de façade car le vrai pouvoir est détenu par sa mère, Marguerite Ire Valdemarsdotter. Il meurt d’ailleurs avant elle et celle-ci devient souveraine de la Norvège et du Danemark, puis de la Suède en 1389. Afin d’obtenir le soutien des Allemands contre les ducs de Mecklembourg prétendants au trône de Suède, Marguerite fait élire roi son petit-neveu, Éric de Poméranie.
L’Union avec le Danemark et la Suède
La destinée commune des trois royaumes scandinaves est scellée par l’union de Kalmar en 1397. La Norvège devient une province du Danemark et le luthéranisme sa religion officielle. La prospérité et la culture norvégiennes déclinent régulièrement après cette union. À ces maux s’ajoute la peste qui, au XIVe siècle, ravage le pays, tout comme le reste de l’Europe, et tue les deux tiers de ses habitants. Pendant les quatre siècles suivants, la Norvège est négligée par les rois scandinaves au profit de la Suède et du Danemark, plus étendus et plus riches.
Les guerres napoléoniennes mettent fin à l’union de Kalmar. À la suite de la défaite de Napoléon en 1814, le Danemark, allié de la France, est obligé de signer le traité de Kiel et cède la Norvège au roi de Suède. Cependant, les Norvégiens rejettent le traité et proclament leur indépendance. Ils rédigent une Constitution libérale et offrent la couronne au prince héritier du Danemark, Christian Frédéric (le futur Christian VIII). Les puissances européennes désapprouvent l’action norvégienne et le maréchal Jean-Baptiste Bernadotte, futur roi Charles XIV, prend la tête d’une armée pour persuader la Norvège d’accepter le traité de Kiel. En échange de la signature du traité, la Norvège réussit à garder sa nouvelle Constitution. Par l’acte d’Union de 1815, elle a sa propre armée, sa marine, ses services de douanes, son Parlement et une certaine autonomie à l’intérieur de ses frontières.
La deuxième union avec la Suède
Après 1814, le Parlement norvégien (Storting) tente surtout de stabiliser et d’améliorer les finances du pays ainsi que de conserver sa liberté nouvelle. Malgré la forte opposition de Charles XIV, monarque autocratique, le Storting vote en 1821 une loi qui abolit la noblesse créée par les Danois. Il proclame en outre que seuls les descendants paysans des barons médiévaux constituent la vraie noblesse norvégienne. Le nationalisme norvégien s’intensifie et amène le Storting à se plaindre du traitement infligé à la Norvège par la Suède, traitement jugé incompatible avec l’esprit de l’acte d’Union et contraire au principe d’égalité entre les nations. En 1839, Charles XIV nomme une commission mixte suédoise et norvégienne pour réviser les termes de l’acte d’Union. Il meurt en 1844, avant que la commission n’ait pu livrer ses conclusions. Son fils, Oscar Ier, admet la justesse des revendications norvégiennes et se rend populaire en offrant un drapeau national à la marine norvégienne, bien que celui-ci porte également l’emblème de l’union avec la Suède.
La montée du nationalisme
En politique, le mouvement libéral accompagne la montée du nationalisme et prend encore plus d’ampleur après les révolutions de 1848 intervenues en Europe. Le nationalisme est soutenu par le patriotisme intellectuel et culturel. On rassemble et on adapte les contes et les chansons du folklore norvégien qui deviennent très populaires. On rédige des dictionnaires ainsi que des grammaires et des manuels d’histoire norvégienne. Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjønson, Jonas Lie et Alexander Kielland prennent part à la renaissance littéraire.
Lorsque la Suède commence à proposer des amendements à l’acte d’Union, offrant des pouvoirs accrus à la Norvège en 1860, les deux plus grands partis politiques norvégiens, le Parti des avocats et le Parti paysan, s’unissent pour former le Parti Venstre (« de la gauche ») qui bloque tout changement. Les relations entre les deux pays se dégradent à nouveau lorsque les Suédois tentent d’imposer une révision de la Constitution, incluant la possibilité pour le souverain de dissoudre le Parlement. Johan Sverdrup, le président du Storting, prend la tête d’un mouvement d’opposition au roi Oscar II. Celui-ci est obligé de céder en 1884. Les Norvégiens continuent de lutter pour une indépendance plus grande, réclamant leur propre service consulaire ainsi qu’un drapeau norvégien ne comportant pas l’emblème de l’union pour la marine marchande. Le pavillon est obtenu en 1898, mais la Suède refuse la création d’une représentation consulaire norvégienne autonome. En 1905, après de longues négociations, le gouvernement démissionne, puis refuse la demande du roi d’annuler sa démission. Enfin, le Storting déclare qu’Oscar n’est plus désormais le souverain de la Norvège et proclame l’indépendance du pays. Au cours du plébiscite d’août 1905, le peuple norvégien vote à une large majorité pour sa séparation de la Suède. Le Parlement suédois (Riksdag) ratifie l’indépendance du pays en octobre. Un mois plus tard, le prince Charles de Danemark accepte la couronne norvégienne et prend le nom d’Haakon VII.
L’indépendance et les deux guerres mondiales
Grâce à une prédominance des ministres progressistes, le gouvernement norvégien devient l’un des pionniers en Europe en matière de protection sociale. En 1913, les Norvégiennes obtiennent le droit de vote pour toutes les élections nationales. La Norvège encourage l’égalité entre les hommes et les femmes, et celles-ci sont amenées à jouer un rôle primordial dans la vie politique du pays. Au début de la Première Guerre mondiale, les souverains suédois, norvégiens et danois s’accordent pour maintenir la neutralité des pays scandinaves et décident de s’entraider. Cette politique de neutralité et d’amitié persiste dans les trois pays après la guerre.
La récession économique mondiale qui débute en 1929 affecte sérieusement la Norvège à cause de sa dépendance commerciale. Le Parti travailliste parvient au pouvoir en 1935 et poursuit la politique modérée et libérale inaugurée dans le pays en 1905.
La Norvège proclame à nouveau sa neutralité au début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Malgré les sentiments de sympathie pour la Finlande pendant la phase russo-finnoise du conflit, la Norvège rejette la demande franco-britannique de faire transiter des troupes via son territoire. Cependant, les manœuvres allemandes le long des côtes norvégiennes rendent la neutralité du pays difficile à respecter. Le 8 avril 1940, la France et la Grande-Bretagne avouent avoir miné les eaux territoriales norvégiennes afin d’empêcher les navires de ravitaillement allemands de les utiliser. Le lendemain, les troupes d’Hitler envahissent la Norvège. Vidkun Quisling, le dirigeant du Rassemblement national (Nasjonal Samling), pronazi, se proclame chef du nouveau gouvernement norvégien.
Le roi Haakon et son cabinet se réfugient en Grande-Bretagne en juin, après une vaine tentative de résistance. Pendant les cinq années suivantes, Londres est le siège du gouvernement norvégien en exil. Les dirigeants politiques de la Norvège refusent de coopérer avec le commissaire du Reich, Josef Terboven. En septembre, celui-ci déclare le Nasjonal Samling unique parti autorisé. Il met en place un Conseil national composé de membres du parti et d’autres sympathisants allemands, puis annonce l’abolition de la monarchie et du Storting. Ces mesures, ainsi que d’autres mesures plus répressives, sont accueillies par une résistance massive de la part de la population norvégienne. Quisling proclame la loi martiale en septembre 1941, après de très nombreuses actions de sabotage et d’espionnage au profit des Alliés dans tout le pays.
Les chefs de la résistance norvégienne en Norvège coopèrent étroitement avec le gouvernement en exil à Londres pour préparer la libération. Finalement, l’armée allemande en Norvège capitule le 8 mai 1945, et le roi Haakon rentre dans son pays en juin. La peine de mort, abolie en 1876, est rétablie pour punir les traîtres. Quisling ainsi que 25 autres Norvégiens sont condamnés puis exécutés pour haute trahison.
Les gouvernements travaillistes
Le gouvernement en exil démissionne après le retour à l’ordre normal. Le Parti travailliste remporte les élections générales d’octobre 1945, et Einar Gerhardsen devient Premier ministre. Le parti demeure au pouvoir sans interruption pendant les vingt années suivantes. Sous sa direction, la Norvège devient une démocratie sociale et un État-providence. Elle adhère à la charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1945. La Norvège bénéficie du plan Marshall en 1947, puis adhère à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 1949. Cette adhésion à l’OTAN signifie la fin de la neutralité du pays et est tacitement approuvée par le peuple norvégien aux élections d’octobre 1949.
L’économie norvégienne sort de la guerre exsangue en raison de l’exploitation allemande et du sabotage intérieur. Les troupes allemandes, lors de la retraite, ont notamment brûlé de nombreuses villes du Nord. La reconstruction, conduite par le gouvernement travailliste, démarre très vite. Toute l’économie du pays est planifiée, sa place dans les marchés mondiaux renforcée, et la richesse nationale est redistribuée selon des critères plus égalitaires. En trois ans, le produit intérieur brut norvégien a retrouvé son niveau d’avant-guerre. Ce développement est accompagné de nouvelles lois sociales qui améliorent le bien-être des citoyens. En 1959, la Norvège devient un des membres fondateurs de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
Les changements politiques
Aux élections législatives de septembre 1961, le Parti travailliste perd la majorité, pour la première fois depuis 1935. Gerhardsen, qui a été Premier ministre depuis la guerre, à l’exception de la période allant de 1951 à 1955, est néanmoins reconduit à la tête du gouvernement. La domination du Parti travailliste prend fin aux élections générales de 1965. Le roi Olav V, qui accède au trône à la mort de Haakon VII en 1957, nomme Per Borten, chef du Parti centriste, au poste de Premier ministre. Il prend la tête d’une coalition de partis non socialistes. Cependant, sa politique économique n’est pas très différente de celle des gouvernements précédents. La Norvège institue un programme de sécurité sociale universelle en 1967.
La Norvège et l’Europe
En 1970, la Norvège pose sa candidature pour adhérer à la Communauté économique européenne (CEE). Cette candidature divise les ministres au pouvoir. Au début de l’année suivante, Borten démissionne après avoir été accusé d’avoir divulgué des informations confidentielles. Le travailliste Trygve Bratteli lui succède et forme un gouvernement minoritaire qui mène une campagne vigoureuse pour l’adhésion à la CEE. Cependant, au référendum de 1972, les électeurs rejettent les recommandations du gouvernement. Celui-ci démissionne et est suivi d’une coalition centriste dirigée par Lars Korvald du Parti démocrate-chrétien. En mai 1973, la Norvège signe un accord de libre-échange avec la CEE. Le Parti travailliste perd à nouveau de nombreux sièges aux élections de 1973, mais Bratteli forme encore un cabinet travailliste minoritaire. Il doit démissionner en janvier 1976, mais son parti demeure au pouvoir jusqu’aux élections de septembre 1981. La même année, de février jusqu’en octobre, le gouvernement norvégien est dirigé par une femme, Gro Harlem Brundtland, pour la première fois de son histoire. Les partis non socialistes remportent une victoire confortable en septembre. Le conservateur Kare Willoch forme, en octobre, un gouvernement de coalition qui s’élargit en 1983. Il est réélu en 1985.
L’exploitation du pétrole
Les perspectives économiques du pays s’améliorent considérablement à la fin des années 1960, avec la découverte de gisements de pétrole et de gaz dans le secteur norvégien de la mer du Nord. Ces ressources naturelles commencent à être exploitées par une société d’État à la même époque. Au début des années 1980, le pétrole de la mer du Nord assure environ 30 % des recettes d’exportations annuelles de la Norvège. Cependant, les cours baissent soudainement en 1985 et en 1986, et les perspectives de recettes fiscales et commerciales plus faibles amènent le gouvernement Willoch à réclamer des taxes pétrolières plus élevées en avril 1986. Celui-ci perd un vote de confiance à ce sujet au Parlement et est remplacé en mai par un gouvernement travailliste minoritaire, dirigé par Gro Harlem Brundtland. Cette dernière démissionne après des élections peu concluantes en septembre 1989 et ramène le Parti travailliste dans l’opposition.
Jan P. Syse, du Parti conservateur, lui succède au poste de Premier ministre, à la tête d’une coalition de centre-droit. Cependant, la durée du gouvernement de Syse est très brève. Il est divisé quant à la position à adopter au sujet de ses futures relations avec la Communauté européenne et doit démissionner en octobre 1990. Il est remplacé, le mois suivant, par une coalition dirigée par la travailliste Gro Harlem Brundtland. Le roi Olav V meurt en janvier 1991 et son fils, Harald V, monte sur le trône.
La Norvège aujourd’hui
En 1993, la diplomatie norvégienne joue un rôle important dans les négociations de paix entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).
Le refus de l’Europe
Les XVIIIe jeux Olympiques d’hiver ont lieu à Lillehammer en février 1994. Le 4 mai 1994, le Parlement européen appuie l’adhésion de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de l’Autriche à l’Union européenne (UE). Auparavant, les négociations ont été bloquées par une querelle sur les droits de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord. Cependant, au référendum des 27 et 28 novembre 1994, les Norvégiens rejettent l’adhésion à l’UE pour la seconde fois, malgré une importante campagne pour le « oui » animée par Gro Harlem Brundtland, qui en fait une affaire personnelle. Les 52,4 % du vote pour le « non » sont l’expression de sentiments profondément anti-UE, surtout présents dans la population rurale et féminine. La population rurale craint l’érosion des subventions de l’État pour la pêche et l’agriculture, tandis que les femmes voient en l’UE une menace pour la politique égalitaire du pays. Il y a aussi un sentiment d’inquiétude, plus général, au sujet des lois norvégiennes en matière de protection de l’environnement.
Le ralentissement de l’économie
Jens
Stoltenberg Le travailliste Jens Stoltenberg prend la tête
du gouvernement norvégien en mars 2000 et devient, à l'âge
de 41 ans, le plus jeune Premier ministre de Norvège.REUTERS/SCANPIX
Extrêmement populaire malgré son échec lors du
référendum sur l’adhésion, Gro Harlem Brundtland
décide de démissionner en octobre 1996 et est remplacée
par le travailliste Thorbjørn Jagland. Alors qu’ils ont bénéficié d’une
période de forte prospérité économique
liée aux revenus pétroliers, les travaillistes perdent
les élections de septembre 1997 (35,2 %), payant ainsi
les carences de leur politique en matière de santé et
de retraite. Une coalition de centre droit très minoritaire
(26,1 % des voix) accède au pouvoir, regroupant les libéraux
et les démocrates-chrétiens de Kjell Magne Bondevik,
un ancien pasteur du Parti démocrate-chrétien devenu
Premier ministre, tandis que le Parti du progrès, populiste
et xénophobe, devient la deuxième formation du pays,
avec 15 % des voix aux législatives, derrière le
Parti travailliste. La très faible représentation de
la coalition au Parlement, qui ne dispose que de 42 sièges sur
165, entraîne une certaine instabilité gouvernementale,
empêchant une ligne politique forte. Les effets de la crise financière
internationale et la chute des prix du pétrole entraînent,
en 1998, un ralentissement de l’économie, qui est, par ailleurs,
en état de surchauffe, et provoque la chute de la couronne.
La Norvège s’engage, le 24 mars 1999, aux côtés
de 13 des 19 membres de l’OTAN, dans l’opération « Force
alliée » menée contre la Serbie. En mars 2000,
Kjell Magne Bondevik démissionne après l’acceptation
par le Parlement d’un projet de construction de centrales au gaz auquel
le gouvernement est opposé. Le nouveau gouvernement est constitué par
le travailliste Jens Stoltenberg.
Lors des élections législatives de septembre 2001, le Parti travailliste du Premier ministre subit une défaite historique. Avec 24,2 % des voix, il enregistre son score le plus faible depuis 1927 et un recul de plus de dix points par rapport au scrutin de 1997, même s’il demeure le premier parti du royaume. Les électeurs sanctionnent l’incapacité du gouvernement à améliorer les services publics, alors que le pays est le deuxième exportateur mondial de pétrole et que la pression fiscale y est l’une des plus fortes d’Europe. Au mois de juillet, un rapport de l’ONU a d’ailleurs indiqué que la Norvège est le pays bénéficiant du niveau de vie le plus élevé au monde. Les conservateurs de la droite arrivent en deuxième position (21,8 % des voix), et le Parti du progrès (extrême droite) obtient 14,3 % des voix. Après la démission de Jens Stoltenberg, c’est à nouveau Kjell Magne Bondevik, du Parti démocrate-chrétien, qui forme un gouvernement de coalition. Outre la formation politique à laquelle appartient le Premier ministre, le nouveau gouvernement réunit le Parti conservateur et le Parti libéral.

Un coup d'œil sur la carte du monde vous permet de situer géographiquement la Norvège, à l'extrémité nord-ouest de l'Europe. Notre pays a une frontière commune avec la Suède, la Finlande et la Russie. À l'ouest, elle est ouverte du nord au sud sur l'océan Atlantique. Notre pays a pour nom officiel " Le Royaume de Norvège ". Outre la Norvège continentale, il englobe l’archipel du Svalbard et l’île Jan Mayen, situés dans l’Arctique. Les îles Bouvet et Pierre Ier, situées dans l'Antarctique, sont rattachées à la Couronne norvégienne.
Le territoire norvégien s’étend jusqu’aux limites septentrionales du continent européen. Se rendre de Lindesnes, tout à fait au Sud du pays, jusqu’au Cap Nord, suppose de parcourir quelques 2500 km. Cette ampleur des distances est, pour le voyageur, le gage d’une variété spectaculaire des paysages. Le réseau routier, bien développé, répond à un standard de qualité satisfaisant. Les ponts qui enjambent les profondeurs des fjords, les tunnels qui se faufilent sous l’empilement des montagnes raccourcissent la route. Au débouché des tunnels, surprise et émerveillement sont constamment au rendez-vous.
La Norvège est l’un des rares pays au monde qui possèdent des fjords. Ces profondes entailles dont est marquée la ligne des côtes se formèrent il y a des millions d’années sous l’action des glaciers.

 |
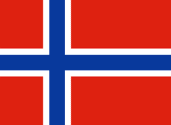 |
L'aspect du drapeau norvégien a évolué en fonction des grands évènements historiques du pays. La longue inféodation au Danemark (1397 - 1805) fut symbolisée par le "Danebrog". Puis, avec la réunion à la Couronne suédoise, il y eut d'abord l'apparition provisoire du lion de Norvège au canton du drapeau, lequel prit finalement son aspect actuel en 1821, quand on inclut une croix bleue dans la croix blanche du "Danebrog". |
 |
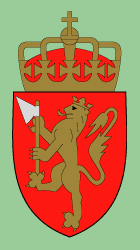 |
|
 |
Nordvegr | "La route vers le Nord". En norvégien : Norge (officiel) ou Noreg (en néonorvégien) |
 |
Ja, vi elsker dette landet |
|
 |
 |
La
callune, variété de
bruyère commune, est la fleur nationale de la Norvège.
Elle pousse dans presque tout le pays, y compris à haute altitude.
L'été, elle se couvre de fleurs aux pétales
rouge clair. Cette plante à miel est essentielle pour
les abeilles. |
 |
 |
Le cincle, oiseau
national de la Norvège, se nourrit
de larves et de plantes qu'il trouve dans les cascades et les
cours d'eau. C'est un oiseau de petite taille, spécialiste
de plongée, qui peut facilement rester une minute
sous l'eau. |
 |
 |
L'élan, animal national
de la Norvège, est le plus gros mammifère de Norvège.
Il vit en troupeau dans presque toutes les régions du pays,
se nourrissant d'herbe, de feuillage, d'écorce et autres végétaux |
 |
|
 |
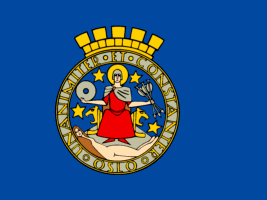 |
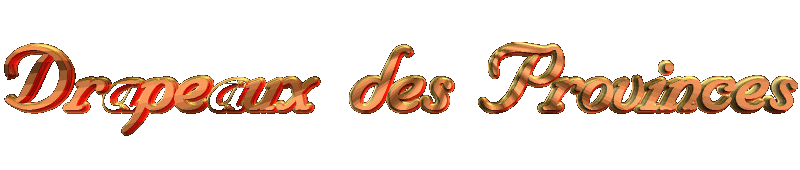 |
|||
 |
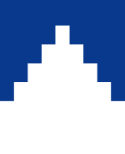 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
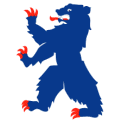 |
 |
 |
 |
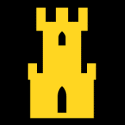 |
 |
 |
 |
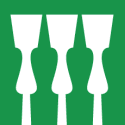 |
 |
 |
 |
 |
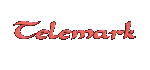 |
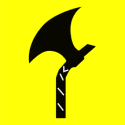 |
 |
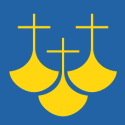 |
 |
 |
 |
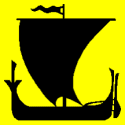 |
 |
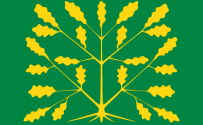 |
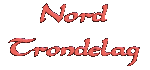 |
 |
 |
 |
 |
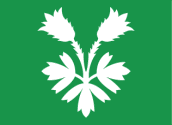 |
||
Certains
des éléments
de cette page proviennent :
|


