
À l’ère préchrétienne, le vaste territoire, qui va devenir la Russie, est faiblement peuplé de tribus nomades. Le nord, région couverte de vastes forêts et presque totalement inconnue, est habité par des tribus indo-européennes qui sont plus tard désignées sous le nom collectif de Slaves, les ancêtres des Russes. Le sud, beaucoup plus grand et déjà familier des Anciens, comprend une région mal délimitée, la Scythie, située au nord de la mer Noire, qui est occupée successivement par différents peuples : les Cimmériens, d’origine indo-européenne (IXe siècle av. J.-C.), les Scythes, d’origine iranienne (VIIIe-IIIe siècles av. J.-C.) et les Sarmates, peuple indo-iranien (IIIe siècle av. J.-C.-IIe siècle apr. J.-C.). Les marchands et les colons grecs fondent, à partir du VIIe siècle av. J.-C., des comptoirs commerciaux et des villes, essentiellement sur la côte nord de la mer Noire et en Crimée, dans cette région connue alors sous le nom de Chersonèse Taurique et qui devient un protectorat romain en 63 av. J.-C.
Les premiers habitants
Les mouvements migratoires de peuples exogènes sont facilités par la topographie et par la présence de grandes étendues de plaines ouvertes. Invasions successives, création d’établissements et assimilation de nouveaux éléments ethniques en sont les conséquences. C’est ainsi que, dans les premiers siècles de l’ère chrétienne, les habitants de Scythie sont remplacés par les Goths, peuple germanique venu de Scandinavie, qui créent un royaume sur la mer Noire (IIIe-IVe siècles). Ils sont ensuite expulsés par les Huns, peuple asiatique turco-mongol, qui conservent le territoire de l’actuelle Ukraine et la région de la Bessarabie jusqu’à la défaite de leur roi Attila à la bataille des champs Catalauniques en Gaule en 451. Viennent ensuite les Avars, les Magyars (Hongrois), puis, à partir du VIIIe siècle, les Khazars, qui restent dans la région jusque vers le milieu du Xe siècle.
Au cours de cette longue période d’invasions, les Slaves du nord-est du Caucase se dispersent. Au sud, ils entrent en contact avec les peuples d’origine iranienne ; au nord, ils se mêlent aux Baltes, aux Finnois, aux Scandinaves. C’est à cette époque que commence à se dessiner la carte de la répartition des populations de la région : les tribus occidentales évoluent graduellement en Moraves, Polonais, Tchèques et Slovaques ; les tribus méridionales en Serbes, Croates, Slovènes et Bulgares slavisés ; les tribus orientales en Russes, Ukrainiens et Biélorusses.
Les Slaves orientaux deviennent des commerçants renommés et le réseau des cours d’eaux qui prennent leur source dans les hauteurs du plateau du Valdaï facilite la création de postes commerciaux, en particulier les villes de Kiev au sud et Novgorod au nord. Les marchandises peuvent ainsi être acheminées de la Baltique à la mer Noire. L’expansion et la plupart des mouvements migratoires des Slaves orientaux se produisent à partir de ces collines ; le contrôle de cette région stratégique est un élément important de la domination russe sur l’est de l’Europe.
La dynastie de Riourik
Organisés en tribus perpétuellement en conflit les unes contre les autres, les Slaves ne sont dotés d’aucun système unifié. D’après la tradition russe consignée dans la Chronique des temps passés, rédigée entre le XIIe et le XIVe siècle et qui constitue la principale source sur les débuts de l’histoire russe, les conflits internes et les inimitiés entre les Slaves de la région de Novgorod deviennent si violents qu’ils décident de faire appel à un arbitre extérieur, un prince étranger qui pourra les unir en un État fort. Leur choix se porte sur Riourik, un chef scandinave, qui devient le souverain de Novgorod vers 860. Dans le même temps et toujours selon la Chronique, deux autres Vikings, Dir et Askold, prennent le pouvoir à Kiev.
Les Scandinaves, appelés Varègues ou Rous, donnent à la terre qu’ils occupent le nom Rossia ou Russie, c’est-à-dire « terre des Rous ». L’intronisation de Riourik et la dynastie qu’il fonde marquent le début d’une période de consolidation interne et d’une expansion territoriale des Slaves, surtout vers le nord-est et le nord-ouest.
Oleg le Sage et Sviatoslav
Riourik meurt en 879 et son fils Igor lui succède dans la principauté de Novgorod. Igor n’étant encore qu’un enfant, c’est Oleg, un parent de Riourik, qui assure la régence. Le prince Oleg, réalisant la valeur de Kiev, s’empare de la région vers 880 et unifie les deux principautés, établissant sa capitale à Kiev. Il agrandit considérablement le territoire sous domination russe qui, s’étendant de la Neva à la mer Noire, englobe la route commerciale des pays nordiques à la Méditerranée. Il conduit ses troupes jusqu’à Constantinople, où il conclut en 907 un traité commercial avec l’Empire byzantin, complété en 911 par un pacte de non-agression, renouvelé en 944. Les Russes exportent essentiellement de la cire, des fourrures, des esclaves et bénéficient d’une exemption de taxes. Dès lors, les relations culturelles et commerciales avec l’Empire byzantin ne cessent de se développer.
Igor assume le pouvoir à partir de 912 et, à sa mort en 945, sa veuve, Olga, lui succède. Elle commence à instaurer dans toute la Kiévie un réseau administratif pour la collecte de l’impôt que paient les tribus dominées par la principauté, parmi lesquelles les Drevlianes, qui ont assassiné Igor. Mais l’événement le plus marquant de sa régence est sa conversion au christianisme, sous le nom de baptême d’Hélène, vers 957, et l’introduction de cette religion dans la principauté de Kiev. En 964, contrainte par une réaction païenne, elle cède le pouvoir à son fils Sviatoslav, le premier prince de la dynastie riourikide à porter un nom slave.
Faisant de sa capitale, Kiev, une cité prééminente parmi les villes russes, Sviatoslav se révèle être un grand chef militaire et s’attache à renforcer les positions russes dans les régions du Sud. Ainsi, il mène des campagnes contre les Khazars au sud-est (963), contre les Bulgares de la Volga (965) et contre ceux du Danube (968), contre les Petchenègues, des nomades d’origine turque, qui assiègent Kiev en 969. Sviatoslav construit un grand État et, sur le plan intérieur, favorise le développement économique. Il s’appuie sur les boyards qui constituent dans un premier temps une armée mobile et forment progressivement une caste de propriétaires. L’économie de la principauté repose essentiellement sur l’agriculture ; les paysans sont en majorité libres mais souvent victimes d’un fort endettement et de l’arbitraire des boyards.
Vladimir le Grand
Après la mort de Sviatoslav en 972, l’empire est divisé entre ses trois fils, ce qui provoque des conflits dynastiques qui s’achèvent en 980, lorsque le plus jeune, Vladimir, prince de Novgorod, devient grand-prince de Kiev et souverain unique de la Russie kiévienne. Il se convertit au christianisme byzantin en 988 et le baptême collectif des Kiéviens qui suit fait de cette religion la religion officielle du peuple russe. Après avoir répudié plusieurs femmes païennes, Vladimir épouse Anne, sœur de l’empereur byzantin Basile II.
Pourtant, dès ses débuts, l’Église orthodoxe russe diffère de son modèle byzantin. Le culte et l’instruction religieuse y sont pratiqués en slavon, à partir de l’écriture cyrillique introduite par les évangélisateurs des Slaves, Cyrille et Méthode. Bien que placés sous l’autorité canonique du patriarche de Constantinople, le métropolite de Kiev et l’ensemble de l’Église dépendent en fait du grand-prince. Très influencée par la culture byzantine, la Kiévie trouve dans la religion le facteur d’unité politique et culturelle qui lui manque.
Iaroslav le Sage
Vladimir meurt en 1015 et le partage de ses possessions entre ses fils donne immédiatement lieu aux habituels conflits de succession. Son fils aîné, Sviatopolk le Maudit (1015-1019), obtient le pouvoir suprême et, pour affermir sa position, fait assassiner ses demi-frères Boris et Gleb, qui deviennent rapidement des martyrs importants de la religion orthodoxe. Il est à son tour déposé par son frère Iaroslav le Sage, prince de Novgorod. Ce dernier entreprend de reconstituer l’empire de son grand-père Sviatoslav et en 1036, après la mort de son frère Mstislav le Brave qui règne sur Tchernigov et toute la région située à l’est du Dniepr, il devient maître de toute la Russie. Son règne constitue l’âge d’or de la Kiévie. Il dote sa capitale d’édifices magnifiques, dont la fameuse cathédrale Sainte-Sophie, fait ouvrir de nombreuses écoles et édicte le premier code de lois russe, la Rousskaïa Pravda (« la Vérité russe »). Il noue des liens avec l’Occident et marie sa fille, la princesse Anne, au roi de France Henri Ier, en 1051.
Le déclin de Kiev
Bien que Iaroslav ait essayé de fixer des règles de succession, sa mort en 1054 marque la division de la principauté entre ses fils et le début du déclin de la Kiévie. De partage en partage, la Russie devient une mosaïque d’États insignifiants, presque continuellement en guerre les uns contre les autres. Vladimir II Monomaque, le petit-fils de Iaroslav, essaie une dernière fois d’unifier le pays mais sa mort en 1125 met fin à ses tentatives d’alliances. Ses fils doivent faire face à de nouvelles oppositions. Des principautés défient alors la suprématie de Kiev : la Galicie et la Volhynie au sud-ouest, Tver et Vladimir-Souzdal au nord-est, Smolensk au nord et Novgorod, de loin la plus puissante, située sur un territoire limité par le golfe de Finlande, le lac Peïpous, le cours supérieur de la Volga, la mer Noire et la Dvina septentrionale.
Le déclin de la Kiévie est également accéléré par la rupture des liens commerciaux avec Constantinople à la suite du sac de la ville par les croisés en 1204, ce qui a pour conséquence la migration d’une partie des habitants de Kiev vers le nord. Novgorod, ainsi renforcée, devient une principauté au commerce florissant tourné vers la mer Baltique, siège au XIIIe siècle d’un grand comptoir de la Ligue hanséatique. Kiev perdit bientôt son rôle de centre culturel, une place qui fut reprise par les cités de Souzdal, Vladimir et enfin Moscou, fondée vers 1147 par Iouri Dolgorouki, prince de Rostov-Souzdal. En 1169, André Bogolioubski, le fils de ce dernier, s’empare de Kiev et du titre de grand-prince qui est désormais affecté à sa principauté de Vladimir. L’épisode sonne le glas de la principauté de Kiev.
La Russie devient une fédération de cités-États dispersées, liées par une langue, une religion, des traditions et des coutumes communes, et dirigées par les membres de la vaste maison riourikide, généralement en guerre les uns contre les autres. La menace se trouve également aux frontières : à l’ouest, les Polonais, les Lituaniens et les chevaliers Teutoniques font des incursions régulières sur le territoire russe, constamment soumis au sud aux expéditions des Polovtses, nom donné par les Russes aux Coumans, peuple de nomades turcs. L’un de ces raids est le sujet du poème épique russe le Dit d’Igor et inspirera à Borodine son opéra le Prince Igor.
L’invasion mongole
La conquête
Au début du XIIIe siècle, un danger bien plus grave vient menacer la Russie. Venues d’Asie, les armées mongoles de Gengis Khan font leur apparition. Les Polovtses appellent les princes russes à leur aide et ceux-ci viennent les secourir contre cet ennemi commun. La coalition russo-polovtsienne subit une déroute totale sur la Kalka, près de la mer d’Azov (aujourd’hui la Kalmious), en 1223. Cependant, les Mongols sont rappelés en Asie par le khan après leur victoire et se retirent aussi vite qu’ils étaient venus. En 1237, Batu Khan, petit-fils de Gengis Khan, ramène vers la Russie orientale ses troupes qui, dans leur marche vers le nord, prennent et détruisent la plupart des villes de la région de Vladimir et Souzdal.
Les armées mongoles sont arrêtées par le terrain difficile de forêts et de marécages situé au sud de Novgorod et Batu Khan est forcé de changer de direction. En 1240, il se dirige vers le sud-ouest et prend Kiev en dépit de la défense désespérée que lui opposent les habitants de la cité. Les Mongols ravagent la Pologne, la Hongrie et s’avancent jusqu’en Moravie. En 1242, Batu Khan établit sa capitale à Saraï sur la basse Volga (près de l’actuelle Volgograd) et fonde la Horde d’Or ou khanat de Kiptchak, jouissant d’une grande indépendance vis-à-vis de l’Empire mongol.
Les modifications ethniques
L’invasion mongole ravage la Russie et est déterminante pour la suite de l’histoire du pays. La domination des Tatars, les descendants des Mongols de la Horde d’Or, détruit les éléments de gouvernement autonome par assemblée représentative qui sont apparus dans quelques cités russes, met un frein aux progrès économiques et fait prendre à la Russie deux siècles de retard par rapport aux pays d’Europe occidentale. Les coutumes, les lois et le gouvernement des Tatars sont partout imposés.
La région de Kiev est presque complètement dépeuplée en raison des massacres et de la fuite vers l’ouest des survivants. Un groupe, influencé culturellement par les Polonais et les Lituaniens, devient les Biélorusses ou Russes Blancs. Un deuxième groupe, formé par la population slave de Kiev et des régions environnantes, devient les Petits-Russes ou Malorusses. La région de la Kiévie, influencée par des langues et coutumes étrangères qui se superposent aux traditions initiales, est appelée Ukraine. Les habitants de la Russie du Nord deviennent le principal groupe de Russes slaves, les Grands-Russes, influencé par les diverses branches de la population finno-ougrienne.
Le tribut payé au khanat
Le nord-ouest de la Russie, épargné par les Mongols, se trouve menacé à la même époque par des envahisseurs venus de l’ouest. Les Suédois traversent la mer Baltique et cherchent à pénétrer dans les territoires de Novgorod. Une armée suédoise débarque sur les rives de la Neva en 1240 et le prince Alexandre prend la tête d’une armée russe pour les repousser. Il défait les Suédois si totalement qu’il est dès lors appelé Alexandre Nevski, c’est-à-dire « de la Neva ». Deux années plus tard, les chevaliers Teutoniques s’avancent à leur tour en provenance de l’ouest. Alexandre Nevski fait traverser à son armée les eaux gelées du lac Peïpous et met les envahisseurs en déroute.
Continuellement sur ses gardes à l’ouest, Alexandre Nevski préfère éviter le risque d’une invasion venant du sud et adopte une politique de soumission envers la Horde d’Or et de conciliation avec le khan. En 1246, il succède à son père André II comme grand-prince de Novgorod et, en 1252, il est investi par le khan comme grand-prince de Vladimir et Souzdal. La plupart des grands-princes russes suivent son exemple, paient un tribut et se considèrent comme vassaux des Tatars.
L’importance grandissante de Moscou
Faisant partie de la principauté de Vladimir, la ville de Moscou occupe une position stratégique au carrefour des principales routes commerciales. En 1263, Alexandre Nevski donne Moscou à son plus jeune fils, Daniel. Les ducs de Moscovie se montrent astucieux et travaillent en association étroite avec les khans. Favoris des Mongols, ils peuvent étendre graduellement leurs terres en annexant les territoires voisins. En 1328, l’un des fils de Daniel, Ivan Ier Kalita, obtient des Mongols le titre de grand-prince de Moscovie. Il semble qu’il soit à l’origine de la décision du métropolite de Kiev, Pierre, de s’installer à Moscou en 1326. Ayant ainsi reçu l’approbation de l’Église, les grands-princes de Moscovie commencent à organiser un nouvel État russe.
Au milieu du XIVe siècle, des conflits internes affaiblissent la Horde d’Or. Le grand-prince Dimitri en profite pour mener une révolte contre les Mongols, la première qui réussit. La grande victoire qu’il remporte à Koulikovo, sur les rives du Don, en 1380 et qui lui vaut le surnom de Donskoï, c’est-à-dire « du Don », marque le déclin de la puissance mongole et l’ascension de la Moscovie.
L’expansion de la Moscovie
Ivan III et Vassili III
La prise de Constantinople par les Turcs ottomans, en 1453, amène l’Église russe orthodoxe à considérer Moscou comme « la troisième Rome », héritière de Constantinople en tant que centre de l’orthodoxie chrétienne. L’aigle à deux têtes de Byzance est incorporé aux armes de la Moscovie et considéré comme le symbole de la sainte Russie. Le mariage du grand-prince Ivan III et de Sophie (Zoé) Paléologue, la nièce de Constantin XI, le dernier empereur byzantin, contribue à investir Moscou du rôle de cité sainte impériale, puisque la principauté hérite par cette alliance des droits impériaux.
Le grand-prince, souverain autocratique plutôt que chef de la noblesse, commence à être appelé tsar. Il agrandit la Moscovie en annexant les États de Novgorod (1478) et de Tver (1485). En 1480, il s’allie au khan de Crimée contre le Grand Khan et profite des conflits internes de la Horde d’Or, désormais divisée en plusieurs khanats, pour refuser de payer le tribut annuel. Trop désorganisés, les Mongols ne peuvent le contraindre à s’exécuter et la domination tatare prend fin à cette date.
Une fois débarrassé des Tatars, Ivan III porte son attention sur la partie occidentale de l’ancienne Russie kiévienne, alors sous domination lituanienne et polonaise. Profitant des troubles occasionnés par la difficile succession de Casimir IV, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, il envahit le territoire lituanien à deux reprises (1492, 1500), avec l’aide du khan de Crimée. À la fin des hostilités en 1503, Moscou contrôle une grande partie de la zone-frontière, et a pris possession de l’État de Viatka et de la principauté de Tver dont l’infortuné prince Michel a jadis conclu une alliance avec Casimir IV.
Le fils d’Ivan III, Vassili III, qui lui succède en 1505, poursuit la même politique d’expansion vers l’ouest. Il annexe Pskov en 1510, prend Smolensk au grand-duc de Lituanie en 1514 et absorbe la principauté de Riazan en 1521. Sur le plan extérieur, les souverains de Moscovie s’attachent donc à l’agrandissement territorial continu de leur principauté tandis qu’ils s’efforcent de formaliser leur pouvoir autocratique sur le plan interne.
Ivan le Terrible
Ivan IV , futur Ivan le Terrible, succède à son père Vassili III en 1533 et devient le nouveau grand-prince de Moscou à l’âge de 3 ans. La régence est d’abord assurée par sa mère, Hélène Glinskaïa. Celle-ci meurt en 1538, laissant l’État aux mains des boyards qui se déchirent en luttes intestines et cherchent à accaparer le pouvoir. Ivan IV atteint sa majorité en 1547 et il est le premier grand-prince moscovite à être officiellement couronné tsar. Il épouse la même année Anastasia Romanovna, de la famille des Romanov.
S’entourant de fidèles conseillers et tenant à l’écart la noblesse en raison des conflits qui ont marqué son enfance, il réunit en 1550 le premier zemski sobor de l’histoire russe, une assemblée représentative, sorte d’états généraux, convoquée de façon irrégulière. Son œuvre réformatrice s’attache à réorganiser le pays et à renforcer sa position autocratique en affaiblissant le pouvoir des boyards et de l’Église.
En 1550, il lance une réforme du système administratif et judiciaire : des directions unifiées sont créées pour les finances, les affaires étrangères et la guerre ; les pouvoirs des voïvodes, les gouverneurs de provinces, sont limités. En 1560, c’est l’administration locale et le système fiscal qui sont réorganisés, notamment au détriment des boyards qui se voient privés des taxes qu’ils ont toujours eu le droit de prélever sur les impôts collectés par eux pour le tsar.
En novembre-décembre 1564, se déroule la « comédie des abdications » : Ivan IV annonce qu’il a abdiqué et quitte Moscou avec une partie de la cour ; mais quelques semaines plus tard, sous la pression populaire, il accepte de remonter sur le trône après s’être assuré un pouvoir absolu. En 1565, il s’attribue la moitié de la Moscovie comme propriété personnelle. Cette réserve de terres, appelée l’opritchnina, devient une entité administrative séparée, gouvernée directement par le tsar, qui la redistribue à ses partisans en récompense de services rendus à titre personnel ou militaire, établissant ainsi un nouveau corps de fonctionnaires, les opritchniki, sorte de « noblesse de service » qui lui est toute dévouée. Lorsque les boyards, mécontents de la diminution de leur puissance, complotent contre lui, Ivan IV n’hésite pas à les mater dans une répression sanglante, ce qui lui vaut le surnom d’Ivan le Terrible.
En 1552, les armées moscovites conquièrent et annexent le royaume tatar de Kazan, et Astrakhan devient un territoire russe en 1556 : la pacification des frontières méridionales et orientales ouvre l’est à la colonisation russe. Les marches de la Moscovie sont alors de plus en plus occupées par des cosaques, pour la plupart des paysans en fuite, dirigés par un hetman, qui se concentrent tout particulièrement dans les bassins du Don et du Dniepr. En 1581, Iermak, l’hetman des cosaques du Don, organise une expédition contre le khan Koutchoum, dans les régions situées à l’est de l’Oural, pour le compte de la riche famille Stroganov, et bientôt la plus grande partie du bassin de l’Ob est sous domination russe, ce qui marque le début de la conquête de la Sibérie.
À l’ouest, Ivan le Terrible mène son armée jusqu’à la mer Baltique, se trouve en guerre contre la Pologne et la Suède à plusieurs reprises et conquiert pour un temps la Livonie. Il conclut plusieurs traités commerciaux avec l’Angleterre, autorisant en 1555 la fondation d’une compagnie commerciale anglaise à Moscou. Il fait également venir auprès de lui de nombreux experts et techniciens étrangers, une pratique qui va devenir courante chez tous les monarques russes. Souvent excessif et cruel, Ivan IV fonde une Russie forte et crée un modèle de pouvoir suprême pour les tsars.
Boris Godounov
Le fils d’Ivan le Terrible, Fedor Ier, malade et simple d’esprit, est dominé pendant son règne (1584-1598) par son oncle Nikita Romanov puis par son beau-frère, le boyard Boris Godounov, deux anciens conseillers de son père.
Boris Godounov poursuit la politique d’expansion qu’a menée Ivan IV et prend notamment aux Suédois une partie de la Carélie, ce qui donne à la Russie un débouché sur le golfe de Finlande. Cependant, le mécontentement des paysans s’accroît en 1597, après la promulgation d’une loi destinée à favoriser le développement de l’agriculture, qui les lie à la terre qu’ils cultivent, créant ainsi un nouveau type de servage.
Fedor Ier, dernier membre de la dynastie riourikide, meurt sans descendance en 1598 et Boris Godounov est élu tsar par le zemski sobor. Bien qu’il ait gouverné avec habileté, son pouvoir se trouve fragilisé par la mort en 1591, dans des circonstances demeurées inexpliquées, du jeune Dimitri, fils d’Ivan le Terrible et de Maria Nagaïa, et dernier héritier légal, mort dont la rumeur le rend responsable. Bientôt, l’apparition de nombreux imposteurs se faisant passer pour Dimitri inaugure une période d’anarchie complète, le Temps des troubles.
Le Temps des troubles
En 1604, Grégoire Otrepiev, un moine défroqué qui se présente comme Dimitri ayant miraculeusement échappé à ses assassins, obtient l’appui de nobles polonais et lituaniens. Trois mois après la mort de Boris Godounov en 1605, il entre dans Moscou, déposa Fedor II, le fils de Boris, et se proclame tsar. Prenant immédiatement des mesures en faveur des paysans, il mécontente les boyards qui l’assassinent et mettent sur le trône le prince Vassili Chouïski, le « tsar des boyards ». Leur action rencontre l’opposition des cosaques et des paysans, révoltés contre les lois de servage et craignant la sévérité du gouvernement des boyards. Ils se soulèvent en Russie du Sud et se joignent à un deuxième « Faux Dimitri », qui avance déjà sur Moscou.
Dans le même temps, le roi de Pologne Sigismond III, espérant lui aussi s’emparer du trône russe, envahit le pays par l’ouest tandis que la Suède envoie une armée en réponse à la demande d’aide de Vassili Chouïski. Ce dernier est déposé en 1610, malgré le soutien des Suédois, et le trône devient vacant. Un groupe de boyards propose la candidature de Ladislas Vasa, fils de Sigismond III, qui se fait élire tsar et entre dans Moscou accompagné par une armée polonaise. Le pays tout entier est alors en proie à la guerre civile.
Un véritable sursaut patriotique se produit : Kouzma Minine, un boucher de Nijni-Novgorod, réussit à lever au nord-est de la Russie une armée populaire, dont le prince Pojarski prend le commandement. Soutenue par les cosaques, cette armée marche sur Moscou et en expulse les Polonais en 1612. En 1613, le zemski sobor élit tsar Michel Romanov, petit-neveu d’Anastasia Romanovna, la veuve d’Ivan le Terrible. Michel fonde ainsi la dynastie des Romanov qui va régner jusqu’en 1917.
Le gouvernement des Romanov
Bien que le mécontentement social ait été l’une des principales caractéristiques du Temps des troubles, aucune réforme importante n’est entreprise. Au lendemain de cette période de chaos, les premiers Romanov trouvent un pays en ruine, complètement désorganisé, amputé d’une partie de son territoire et de 50 % de sa population. Leur règne est celui du lent redressement de la Russie.
Michel Fedorovitch (1613-1645) et son fils Alexis Ier (1645-1676) accomplissent une œuvre législative importante. Le premier fait dresser un cadastre et recenser la population dans le but de répartir plus équitablement l’impôt, tout en luttant contre les abus de pouvoir des fonctionnaires provinciaux ; il fait du zemski sobor un conseil national plus ou moins permanent qui donna à la Russie de vagues allures de monarchie parlementaire. Son fils et successeur multiplie les impôts, promulgue de nouvelles lois destinées à renforcer les pouvoirs des propriétaires terriens sur leurs serfs et doit, dans un climat de crise sociale aiguë, réprimer de nombreuses émeutes, dont l’une très violente à Moscou en 1648.
Le code adopté en 1649, qui attache définitivement les paysans à la terre, ne fait qu’augmenter le nombre de serfs en fuite, qui rejoignent pour la plupart les établissements cosaques des basses vallées de la Volga, du Dniepr et du Don. Dès 1667, une grande révolte éclate dans le sud-est de la Russie sous la direction d’un hetman des cosaques du Don, Stenka Razine. Elle est réprimée l’année suivante avec grande difficulté par les forces du tsar conduites par les princes Dolgorouki et Bariatinski. Cette première grande révolte paysanne est l’archétype des soulèvements paysans qui suivront et qui seront toujours dirigés plutôt contre la noblesse terrienne que contre le tsar.
Parallèlement, la Russie progresse en tant que puissance européenne et, dans les centres urbains, l’influence de l’Europe occidentale dissipe enfin l’isolement provoqué par la période d’occupation mongole. En 1654, les cosaques zaporogues d’Ukraine, conduits par l’hetman Bogdan Khmelnitski, se rebellent contre le gouvernement de la Pologne et offrent leur allégeance au tsar Alexis Ier. La Russie est victorieuse dans la guerre qui s’ensuit avec la Pologne. La signature du traité d’Androussovo en 1667, lui fait recouvrer Smolensk (perdue en 1611) et l’Ukraine orientale, y compris Kiev.
Le retour de l’Ukraine hâte les réformes du rituel de l’Église russe. L’Ukraine est un district métropolitain du patriarche de Constantinople et, pour mieux s’intégrer au reste de la Russie, l’Église ukrainienne est amenée à accepter l’autorité du patriarche de Moscou. Dans le but de rapprocher l’Église russe des traditions grecques, Nikon, patriarche de Moscou de 1652 à 1658, introduit des réformes du rituel et commande de nouvelles traductions des Livres saints. Ces initiatives provoquent une véritable rupture au sein de la communauté des fidèles. Lors d’un concile de l’Église en 1666, les dissidents traditionalistes, ou raskolniki, sont déclarés schismatiques. Des millions de ceux que l’on appelle les « vieux-croyants », conduits par l’archiprêtre Avvakoum, se trouvent ainsi exclus d’une participation complète à la vie russe et sont souvent déportés en Sibérie.
C’est sous le règne de Fedor III (1676-1682), fils et successeur d’Alexis Ier, que la Russie remporte sa première guerre contre l’Empire ottoman : le traité de Bakhtchisaraï, signé en 1681, fait de la région située entre le Don et le Dniestr une sorte de zone de transit, destinée à rester inoccupée.
Fedor III meurt sans héritier, et son demi-frère, Pierre, futur Pierre Ier le Grand, est désigné tsar. Mais la demi-sœur aînée de Pierre, Sophie Alexeïevna, réussit à faire nommer co-tsar son frère, le faible d’esprit Ivan V, tandis qu’elle prend le titre de régente. Après l’échec de ses tentatives pour priver Pierre Ier de son droit au trône puis de le faire assassiner avec sa mère Nathalie Narychkine, Sophie est contrainte d’abandonner tous ses pouvoirs en 1689.
L’Empire russe
L’arrivée sur le trône du tsar Pierre Ier en 1682 marque le début d’une véritable révolution : l’ouverture de la Russie sur l’Occident et l’accession du pays au rang de grande puissance européenne.
Pierre le Grand
Pierre Ier veut d’abord achever ses « années de formation » et remet le pouvoir à sa mère jusqu’en 1694. Il en profite pour voyager à travers les pays européens dont la culture l’attire particulièrement et se rend ainsi en Angleterre, en Prusse, aux Pays-Bas. Une fois au pouvoir, il s’efforce de transformer la société russe traditionnelle en l’occidentalisant.
Ses réformes, décrétées massivement vers 1718, entreprennent de réorganiser le pouvoir central en instituant des collèges ministériels et une chancellerie privée, en remplaçant la Douma (assemblée) des boyards par un Sénat en charge de la justice et des finances, tandis qu’au niveau local, l’administration est réorganisée de façon pyramidale. L’impôt cadastral est remplacé par la capitation, plus juste ; les boyards disparaissent progressivement en tant que classe et se fondent dans la noblesse de service. Le saint-synode remplace le patriarcat, faisant du clergé un corps de fonctionnaires et de l’Église une « fille de l’État ». Enfin, corollaire indispensable du succès de ces mesures, une profonde refonte du système éducatif est entreprise, incluant une réforme de l’alphabet, la mise en place de formations professionnelles, la création de différentes académies.
Parallèlement, Pierre le Grand se lance dans une ambitieuse politique d’acquisitions territoriales. Ses plus grandes campagnes militaires se font vers l’ouest et le conflit le plus important, la guerre du Nord (1700-1721), l’oppose à la plus grande puissance baltique de l’époque, la Suède. Le contrôle de la mer Baltique est nécessaire pour la création d’une marine puissante et l’expansion du commerce extérieur russe. En 1700, l’armée russe subit une grave défaite à Narva (aujourd’hui en Estonie), mais les Suédois ne poursuivent pas leur avantage, permettant ainsi à Pierre le Grand de réorganiser ses forces, de renforcer la marine qu’il a créée de toutes pièces pour l’occasion et d’attaquer les bases suédoises en Livonie.
En 1703, le tsar commence la construction de sa nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, symbole de l’ouverture vers l’ouest, située dans les territoires conquis sur la Suède. Il y transfère le gouvernement de Moscou en 1715 et contraint, par plusieurs décrets, la noblesse à s’y fixer. L’armée russe écrase les Suédois à Poltava en 1709 (voir Poltava, campagne de) et les Russes établissent leur suprématie sur la mer Baltique. Aux termes du traité de Nystad (septembre 1721), la Russie acquiert la Livonie, l’Estonie, l’Ingrie, une partie de la Carélie, la ville de Vyborg en Finlande et plusieurs îles de la Baltique. À partir de 1722, Pierre le Grand entreprend une série de campagnes contre les Perses ; dès 1723, le littoral de la mer Caspienne est contrôlé par la Russie et l’année suivante, un accord avec les Turcs entérine le partage de la zone (voir Iran).
Fondamentale, la nouvelle domination russe sur l’Europe du Nord déplace vers l’ouest le centre de gravité du pays ; une conception latine du pouvoir succède à la conception byzantine et Pierre le Grand est officiellement proclamé empereur par le Sénat en 1721. L’État moscovite est devenu l’Empire russe.
Les successeurs de Pierre le Grand
En 1725, la mort de Pierre le Grand ouvre une nouvelle crise de succession. Son héritier direct, le tsarevitch Alexis, accusé de trahison, est mort en prison en 1718. Le trône revient donc à la seconde femme de Pierre, Catherine Ire, couronnée impératrice en 1724, qui règne avec l’aide d’un conseil privé de sept membres limitant les pouvoirs du Sénat. En 1727, le trône échoit à Pierre II, le fils d’Alexis. Âgé alors de douze ans, l’enfant se trouve au cœur d’innombrables querelles de palais qui opposent les grandes familles de la vieille noblesse, de retour dans la gestion des affaires du pays.
Il meurt en 1730 et Anna Ivanovna, fille d’Ivan V, est désignée par le Conseil pour lui succéder. Veuve du duc de Courlande, elle attire à sa cour ses favoris prussiens, institue, en remplacement du Conseil, un Cabinet des ministres plus restreint encore et règne de façon despotique. Son petit-neveu, Ivan VI, un bébé, lui succède en 1740, la régence étant assurée par sa mère, Anna Leopoldovna, la nièce d’Anna Petrovna.
Cependant, une conspiration porte au pouvoir l’année suivante Élisabeth Petrovna, la plus jeune fille de Pierre le Grand, conformément au testament de Catherine Ire. Après cette période de « règne des favoris », elle reprend en main les affaires du pays et une renaissance nationale se produit sous son règne (1741-1762). Réglant la guerre avec la Suède (1742-1743), le traité d’Åbo, signé en 1743, permet à la Russie d’acquérir une partie de la Finlande. L’impératrice s’allie également à l’Autriche et à la France dans la guerre de Sept Ans (1756-1763) contre la Prusse.
Son neveu et successeur, Pierre III de Holstein-Gottorp, rompt avec sa politique extérieure. Admirateur de Frédéric II de Prusse, il conclut avec lui une paix séparée dès son avènement en 1762. Sophie d’Anhalt-Zerbst, sa femme, une princesse d’origine allemande, le fait déposer et assassiner la même année. Elle monte sur le trône sous le nom de Catherine II et demeure connue comme Catherine la Grande.
Catherine la Grande
Catherine la Grande se pose en successeur de Pierre le Grand et cherche à poursuivre sa politique. Imprégnée de l’esprit des Lumières, admiratrice et amie de Diderot et Voltaire, elle entend régner en philosophe mais ses réformes, souvent en décalage avec son discours, aboutissent de manière générale à un durcissement de la situation intérieure.
En 1763, elle fait annuler les franchises des cosaques et supprime l’hetmanat d’Ukraine ; dans un contexte de crise sociale, elle doit mater les nombreuses révoltes paysannes qui éclatent, dont celle dirigée par le cosaque Pougatchev, qui constitue une sérieuse menace pour le pouvoir. Parti de la région de l’Oural en 1773, Iemelian Pougatchev, qui se fait passer pour le tsar Pierre III, réunit autour de lui de nombreux mécontents, serfs en fuite, ouvriers des mines et des manufactures, et entreprend de suivre le tracé de la Volga, grossissant sans cesse ses rangs. Il n’est arrêté (difficilement) qu’en 1774 et est exécuté publiquement l’année suivante sur la place Rouge.
Sur le plan administratif, l’œuvre de Catherine II s’inscrit dans la lignée de celle de Pierre le Grand : institué en 1775, le découpage de l’empire en 51 gouvernements, supprimant les anciennes provinces, faisait suite aux gouvernements institués par son prédécesseur. En revanche, la tsarine libère l’industrie de la tutelle de l’État, ce qui permet une augmentation considérable des différentes productions et place, au début des années 1780, la Russie au premier rang mondial des producteurs de fonte et de fer. En 1785 est promulguée la Charte de la noblesse, qui a pour effet de renforcer les privilèges de cet ordre et d’accabler les paysans : exemptés d’impôts, dégagés de toute obligation envers l’État, les nobles ont désormais un pouvoir absolu sur leurs paysans, ces derniers étant soumis au règne du plus total arbitraire puisqu’ils se retrouvent privés de tout recours devant l’administration impériale.
Sa politique extérieure sert avec succès les velléités d’expansionnisme de la Russie. Catherine tourne d’abord ses forces contre l’Empire ottoman afin d’acquérir sur la mer Noire les ports en eau libre nécessaires au commerce russe. Les guerres russo-turques de 1768-1774 et de 1787-1791 lui permettent de prendre possession d’une partie de la Crimée puis de tout le territoire à l’ouest du Dniestr ; la Géorgie est annexée en 1783 tandis que Potemkine, favori en titre de la tsarine, est fait prince de Tauride après l’annexion de la Crimée qui a été reconnue indépendante par les Turcs au traité de Kutchuk-Kaïnardji (1774).
La seconde phase des guerres menées par Catherine II se déroule à l’ouest : à l’issue de conventions secrètes conclues avec Frédéric II de Prusse et des trois partages de la Pologne (1772, 1793, 1795), la Russie annexe un territoire de 468 000 km2 et 6 millions d’habitants ; sur le front suédois, le statu quo territorial auquel parviennent les deux pays en 1788 permet de signer enfin la paix en 1790.
Le début de la Révolution française marque un tournant dans la pensée politique de Catherine II et lui fait totalement abandonner ses vues libérales ; en 1793, l’exécution de Louis XVI l’amène à annuler tous les traités signés jusque-là avec la France. En cette fin de XVIIIe siècle, celle qui a été un modèle de « despote éclairé » apparaît comme un véritable rempart de l’absolutisme.
Paul Ier et Alexandre Ier
En 1796, Paul Ier succède à sa mère. Écarté du pouvoir par Catherine, tenu pour faible, il est animé du désir de venger la mort de son père et commence par prendre des mesures très libérales. Ainsi, il fait abolir la Charte de la noblesse de 1785, améliore le sort des paysans et libère les prisonniers politiques polonais, dont Kosciuszko, arrêté après l’insurrection de 1794. En politique extérieure, il se joint à l’Autriche, à la Grande-Bretagne et à l’Empire ottoman dans la deuxième coalition qui se forme contre la France après la prise de Malte par Bonaparte. Mais il est assassiné dans son palais en 1801 à la suite d’une conspiration de la noblesse.
Son fils, Alexandre Ier, a été le petit-fils favori de Catherine la Grande. Acquis aux idées libérales et instruit par le penseur suisse Frédéric César de La Harpe, il débute son règne en amnistiant tous les prisonniers politiques, en rouvrant les frontières et en autorisant les livres étrangers, interdits par son père dans un accès de paranoïa.
Son conseiller Speranski travaille à un projet de réforme de l’État et présente en 1809 un plan préconisant la séparation des pouvoirs et l’établissement d’une monarchie constitutionnelle. Mais devant l’hostilité de la noblesse, dont la Charte de 1785 a été remise en vigueur en 1801, Speranski est écarté en 1812. Alexandre Ier, entraîné dans les guerres étrangères, doit d’ailleurs renoncer à sa politique intérieure libérale.
En 1805, la Russie se joint à la Grande-Bretagne, à l’Autriche et à la Suède dans la troisième coalition contre Napoléon Ier. Après que les armées françaises eurent écrasé la Prusse à la bataille d’Iéna le 14 octobre 1806 et la Russie à Friedland le 14 juin 1807, le tsar opère un renversement d’alliance et conclut avec Napoléon le traité de Tilsit en juillet 1807. Aux termes de cet accord, Alexandre Ier reconnaît la création du grand-duché de Varsovie (voir Pologne), obtient toute liberté d’action contre la Suède et la Turquie en échange de l’aide qu’il apporte à la France contre la Grande-Bretagne. Ainsi, la guerre russo-turque de 1806-1812 lui permet d’obtenir la Bessarabie, la guerre russo-suédoise de 1808-1809 s’achève par l’acquisition des îles d’Åland et de toute la Finlande. En 1813, une guerre contre la Perse (voir Iran) permet à la Russie de s’emparer notamment du Daguestan.
Entre-temps, les relations avec la France se sont détériorées. Prenant prétexte de l’annexion par Napoléon du duché d’Oldenbourg, Alexandre Ier rompt l’alliance de 1807 et la Grande Armée est lancée dans la campagne de Russie en 1812. Les troupes françaises franchissent le Niémen le 24 juin, remportent la bataille de la Moskova le 7 septembre et entrent dans Moscou, abandonnée par les troupes de Koutouzov, le 14 septembre. Mais la ville, défendue par ses habitants, est incendiée dès le lendemain, probablement sur les ordres du général Rostopchine, le gouverneur militaire, et les Français doivent faire retraite. En butte à la faim, au froid et aux attaques continuelles de guérilla, dans un pays dévasté par la politique russe de la terre brûlée, la retraite est une véritable déroute.
Les Français franchissent en catastrophe la Berezina le 27 novembre, poursuivis par les troupes russes qui atteignirent Varsovie en février 1813 et entrent dans Paris le 30 mars 1815, faisant d’Alexandre Ier la figure de proue de l’alliance qui a réussi à renverser Napoléon. En 1815, au congrès de Vienne, la plus grande partie du duché de Varsovie est attribuée à la Russie, qui dote alors le royaume de Pologne d’une Charte constitutionnelle.
La fin du règne d’Alexandre Ier marque le divorce entre les intentions affichées les premières années et la réalité (faite dans les années 1820 de mesures répressives comme la dissolution des loges maçonniques, le renforcement de la censure, l’épuration des milieux universitaires). Pourtant, ces années sont aussi celles d’un rapprochement intellectuel avec l’Europe occidentale, qui se traduit par l’émergence d’une jeune génération nobiliaire et militaire acquise aux idées libérales. Considérant la Russie comme un État despotique à la bureaucratie compliquée et corrompue, peu concerné par la situation des masses opprimées, ces intellectuels se font à former des sociétés politiques secrètes, mettant ainsi en branle le lent processus révolutionnaire.
Nicolas Ier
Lorsqu’Alexandre Ier meurt — sans descendance — en 1825, le trône revient à son jeune frère, Nicolas Ier. Prenant avantage des hésitations qui se produisent lors de la succession, un groupe de jeunes officiers organise le complot des décabristes pour essayer d’instaurer une monarchie constitutionnelle. Nicolas Ier écrase rapidement la révolte et prend de nouvelles mesures réactionnaires qui ont pour effet d’accroître le mécontentement général, comme l’institution d’une police secrète ou le renforcement de la censure sur toutes les publications et les programmes scolaires.
Après les révolutions de 1848 qui se produisent dans toute l’Europe, Nicolas Ier se lance dans une campagne vigoureuse contre les idées libérales : les chaires universitaires d’histoire et de philosophie, potentiellement dangereuses, sont abolies et le nombre d’étudiants limité à 300 dans chaque université. De nombreux écrivains sont arrêtés, dont certains, comme Fedor Dostoïevski, qui participe au cercle politique de Petrachevski, sont exilés et condamnés aux travaux forcés.
Nicolas Ier s’intéresse également à l’expansion de son empire. Ses activités s’exercent dans trois directions : le sud-ouest, vers la Méditerranée, avec des interventions dans les provinces balkaniques de l’Empire ottoman ; le sud, vers le Caucase et l’Asie centrale ; l’est, en direction de l’océan Pacifique. Une guerre avec la Perse (voir Iran) éclate en 1826 et s’achève deux ans plus tard par l’annexion d’une partie de l’Arménie, dont la ville stratégique d’Erevan. À la même époque, le tsar épouse la cause des révolutionnaires grecs et une flotte russe se joint aux vaisseaux britanniques et français qui détruisent la flotte turque à la bataille de Navarin, le 20 octobre 1827. L’Empire ottoman est défait lors de la guerre russo-turque de 1828-1829 qui s’ensuit et à l’issue de laquelle le traité d’Andrinople (14 septembre 1829) donne à la Russie la suzeraineté sur les peuples du Caucase, et à l’empereur un protectorat et un droit d’intervention sur la Moldavie et la Valachie. Enfin, l’indépendance de la Grèce, acquise en 1830, est d’emblée garantie par la France, la Grande-Bretagne et la Russie.
À la fin de la même année, une importante révolte contre l’autorité russe éclate en Pologne. Le 25 janvier 1831, une Diète polonaise dépose le tsar et met en place un gouvernement provisoire. L’armée russe oblige les rebelles à capituler à Varsovie en septembre et une vague terrible de répression s’abat sur la Pologne jusqu’en 1833 : les universités sont fermées, de nombreux intellectuels sont déportés et le nouveau statut donné à la Pologne en 1832 lui fait perdre toute autonomie et en fait une part intégrante de la Russie.
L’accroissement de la puissance russe dans les Balkans et au Moyen-Orient est bientôt considéré comme une menace par les autres puissances européennes, surtout lorsque les forces russes font leur apparition dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, conformément à un accord secret conclu avec l’Empire ottoman en 1833. La Grande-Bretagne, la France, la Prusse et l’Autriche font bloc pour contrer les projets russes de s’emparer de Constantinople. Lorsque Nicolas Ier envahit les principautés danubiennes en 1853 (voir Roumanie), l’Empire ottoman lui déclare la guerre. Dans la guerre de Crimée (1854-1856) qui s’ensuit, la Russie doit faire face à la coalition des armées britannique, française, sarde et turque et subit une défaite totale.
Alexandre II
Nicolas Ier meurt en 1855 et la paix est conclue l’année suivante par son fils, Alexandre II, au traité de Paris. La Russie est obligée d’abandonner Kars, dans le Caucase, et une partie de la Bessarabie ; le protectorat russe sur les principautés danubiennes est aboli (voir Roumanie). Cet échec au sud-ouest n’empêche pas l’avancée russe vers l’océan Pacifique et le golfe Arabo-Persique. En 1850, un établissement russe a été installé sur l’estuaire de l’Amour et la partie nord de l’île de Sakhaline est occupée en 1855. Trois ans plus tard, toute la vallée de l’Amour et la côte au sud de la ville de Vladivostok (fondée en 1860) sont annexées. En Asie centrale, avec l’annexion de Tachkent (1865), Samarkand, Kokand, Boukhara (1868) et Khiva (1873), l’empire s’avance presque jusqu’à la frontière de l’Inde.
En politique intérieure, le règne d’Alexandre II est une ère de réformes, nécessaires après la débâcle de la guerre de Crimée. Dans les campagnes, on comptabilise en moyenne 80 révoltes annuelles depuis le début de son règne et une amélioration du statut des paysans devient inévitable. C’est ainsi qu’en 1861, s’appliquant à la moitié de la population rurale, un « statut des paysans libérés du servage » est décrété, libérant près de 20 millions de serfs des domaines privés. Une réforme du gouvernement local devient nécessaire, et les zemstvos ou assemblées de district sont créées en 1864 pour régler les problèmes locaux tels que l’éducation, la santé publique ou les problèmes de transports. Le système judiciaire est réformé, instituant l’égalité de tous devant la loi, le jugement par un jury pour les délits criminels, et garantissant l’indépendance des juges.
Le tsar refuse cependant d’accorder une Constitution ou de mettre en place une assemblée représentative. Les mouvements révolutionnaires, globalement rassemblés sous l’appellation de « nihilistes », prennent de l’importance, adoptent des programmes et des politiques de plus en plus précis. Les narodniki, adhérents du premier mouvement social-révolutionnaire de Russie, travaillent au soulèvement des paysans dans le but de renverser le tsarisme et d’instaurer un communisme agraire ; dans le même courant populiste apparaissent Zemlia i Volia (« Terre et Volonté ») puis, après la scission de 1879, Narodnaïa Volia (« la Volonté du peuple »), dont les membres prônent des méthodes plus radicales, n’hésitant pas à entreprendre des actions terroristes, alors que le groupe Partage noir poursuit la propagande au sein du peuple.
Les activistes révolutionnaires sont également nombreux en Pologne et préparent depuis l’avènement du tsar une deuxième révolte massive contre la Russie, qui éclate en 1863. Violemment réprimée, elle fait perdre à la Pologne les derniers vestiges de son autonomie et donne lieu à une politique de russification encore intensifiée. En Russie, malgré la sévérité de la répression, les revendications sociales s’expriment désormais au grand jour : en 1870, la première grande grève ouvrière du pays éclate à Saint-Pétersbourg, à la Filature de coton de la Neva, tandis que la même année une section russe de la Ire Internationale est formée à Genève, événement qui ne reste pas sans répercussion.
En 1871, la chute en France de Napoléon III, principal adversaire de l’intervention russe dans les Balkans, permet à la Russie d’étendre sa sphère d’influence dans la région. Lorsque la Serbie et le Monténégro se révoltent contre l’Empire ottoman en 1876, la Russie intervient en leur faveur. Alexandre II sort vainqueur de la guerre russo-turque de 1877-1878 et obtient d’importantes concessions lors du traité de San Stefano (mars 1878), dont la création d’une Grande Bulgarie, autonome au sein de l’Empire ottoman mais en fait directement contrôlée par la Russie, ce qui augmente la mainmise russe sur les détroits. Inquiètes de cette situation, les grandes puissances européennes réunies en conférence à Berlin en juillet 1878 refusent de reconnaître la plupart des dispositions du traité de San Stefano.
La fin de l’Empire
Alexandre III
Alexandre II, victime à plusieurs reprises de tentatives d’assassinat, périt le 13 mars 1881 dans l’attentat qu’organisent les membres de Narodnaïa Volia. Son fils, Alexandre III, lui succède et, entouré de ministres conservateurs, institue une censure rigide et une surveillance policière des activités intellectuelles grâce à la création de l’Okhrana, une nouvelle police secrète. Dès août 1881, une loi, qui va rester en vigueur jusqu’en 1917, permet d’imposer l’état de siège.
Les lois de censure amènent, à partir de 1882, à la disparition progressive de la plupart des périodiques de tendance libérale, tandis que le nouveau statut des universités, mis en place en 1884, supprime l’autonomie des établissements et limite l’accès des femmes à l’enseignement supérieur.
Dans le même temps, des programmes de russification sont imposés aux nombreuses minorités ethniques de l’empire, particulièrement en Pologne. Les premières grandes vagues de pogroms contre les juifs éclatent, notamment en Ukraine, durant l’été 1881. La communauté juive est progressivement marginalisée : en 1882, un nouveau statut des juifs est promulgué, leur interdisant la possession de terres et limitant leur droit de résidence ; en 1887, un numerus clausus restreint l’accès à l’université des étudiants juifs ; en 1892, les juifs perdent leurs droits d’électeurs aux doumas.
Par ailleurs, les attributions des zemstvos sont fortement réduites par l’institution, dans les districts de campagne, d’un chef rural qui détient les pouvoirs administratifs et judiciaires (1889), et une loi électorale modifie la représentativité des assemblées au profit des nobles (1890).
Cependant, dans les années 1890, après s’être formés à l’étranger, les premiers cercles marxistes se constituèrent dans la clandestinité en Russie ; déjà le Manifeste du parti communiste de Marx et Engels avait été traduit en russe en 1882. Le programme d’industrialisation intense lancé à partir de 1892 par le ministre des Finances, Sergueï Witte, provoque une forte augmentation du nombre d’ouvriers, public tout trouvé pour les leaders révolutionnaires.
Sur le plan extérieur, la Russie cherche de nouveaux partenaires après que l’Alliance des trois empereurs, conclue en 1873 par Alexandre II avec Guillaume II (Allemagne) et François-Joseph (Autriche-Hongrie), n’est plus renouvelée après l887 pour cause de désaccord entre la Russie et l’Autriche-Hongrie dans les Balkans. Sous l’impulsion du ministre des Affaires étrangères de Giers s’opère un rapprochement avec la France. La visite de la flotte française à Kronstadt en 1891 est suivie d’accords politiques et militaires ; en 1893, la flotte russe vient à Toulon. L’alliance franco-russe est scellée, elle s’accompagne d’investissements de capitaux français en Russie et d’emprunts russes sur le marché financier français destinés à accélérer la modernisation de l’empire.
Nicolas II
Nicolas II, fils aîné d’Alexandre III, accède au trône en 1894 après la mort de son père, et poursuit la même politique. La Russie offre alors le visage contrasté d’un pays entre progrès et inertie. Au tournant du siècle, les indicateurs économiques sont à la hausse : la Russie est la 5e puissance industrielle mondiale, le 2e producteur mondial de pétrole, la balance commerciale du pays est excédentaire, le Transsibérien en passe d’être achevé (1902), la croissance démographique forte et les grandes villes en pleine expansion.
Cependant, avec
85 % de sa population en milieu rural, le pays demeure essentiellement
agricole ; la communauté villageoise, le mir, propriétaire
collectivement de la terre et de son exploitation, domine dans les campagnes,
appliquant des méthodes archaïques et ne laissant guère
de place à l’initiative individuelle. De même, si la croissance
industrielle est incontestable, elle est très inégale et
laisse à l’écart des pans entiers de l’empire. En outre,
la majorité des secteurs les plus modernes dépend des capitaux étrangers.
Enfin, si une petite classe de propriétaires terriens fortunés,
les koulaks, a pu émerger en milieu rural comme une bourgeoisie
aisée l’a fait en milieu urbain, la société russe
demeure figée, dominée par un souverain autocrate s’appuyant
sur une Église dont il est le chef, une armée la plus nombreuse
d’Europe, une noblesse attachée à ses privilèges,
une bureaucratie et une police omniprésentes.
Dans le même temps, les oppositions à l’autocratie se renforcent.
Au niveau social, les soulèvements paysans et les grèves
ouvrières se multiplient. Au niveau politique, les libéraux,
partisans d’une monarchie constitutionnelle, qui trouvent un public dans
les classes sociales nouvellement apparues, bourgeoisie et classes moyennes,
se font plus puissants, tandis que l’opposition socialiste, elle aussi
face à un nouveau public, mais souvent en exil et divisée
en de nombreux courants, se renforce autour de leaders comme Lénine.
Dans ce climat, Nicolas II s’avère être un monarque faible, facilement dominé par son entourage. Sa femme, Alexandra, née Alice de Hesse, fille du grand-duc de Hesse-Darmstadt Louis IV, lui donne quatre filles et un fils, Alexis, qui souffrait d’hémophilie. Dans leurs vaines tentatives pour trouver un traitement, les monarques sont la proie de charlatans et de fanatiques religieux, parmi lesquels Raspoutine, qui prend à partir de 1905 un véritable ascendant sur la famille impériale, contribuant à la discréditer.
La guerre russo-japonaise et la révolution de 1905
En politique extérieure, les intérêts russes en Mandchourie se heurtent de plus en plus à ceux de l’Empire japonais en pleine expansion, et les frictions aboutissent à une attaque-surprise de la flotte japonaise à Port-Arthur les 8 et 9 février 1904 (voir Russo-japonaise, guerre). Sûr de son armée et de la puissance de son empire, Nicolas II ne redoute pas cette guerre dont il pense même tirer parti pour mater les oppositions intérieures. Néanmoins, dans le souci de s’assurer le soutien populaire, il autorise le zemstvo à se réunir à Saint-Pétersbourg en novembre 1904.
Les demandes de réformes formulées par l’assemblée restent sans écho auprès du gouvernement mais elles sont reprises par les groupes de l’opposition. Les syndicats appellent à une grande manifestation et, le 22 janvier 1905, des dizaines de milliers de personnes se dirigent pacifiquement vers le palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg, la résidence du tsar, pour présenter leurs revendications. L’armée ouvre le feu, tuant et blessant des milliers de manifestants. À la suite de ce « Dimanche rouge », des grèves et des émeutes éclatent dans toutes les régions industrialisées de Russie.
Ces événements, combinés aux désastres de la guerre au cours de laquelle la flotte russe est anéantie, amènent le gouvernement à faire des concessions. En octobre, le tsar publie un manifeste rédigé par Witte garantissant les libertés civiques et annonce la convocation d’une Douma législative élue.
Cependant, la vague révolutionnaire ne s’arrête pas pour autant. Des soldats et des marins, dont ceux du cuirassé Potemkine (juin-juillet) à Odessa et de la flotte de Kronstadt (octobre), se mutinent (voir Potemkine, mutinerie du) et une grève générale, accompagnée d’un soulèvement nationaliste paralyse le pays en octobre-novembre. Des soviets ouvriers (conseils) sont formés à Saint-Pétersbourg (26 octobre) et à Moscou (5 décembre) pour poursuivre le mouvement et renverser le tsar dont l’armée a subi une défaite totale face au Japon. Des leaders de l’opposition, comme Lénine en novembre, rentrent d’exil. Le gouvernement lance l’armée contre les révolutionnaires. L’arrestation des membres du soviet de Saint-Pétersbourg, le 16 décembre, provoque, à l’appel du soviet de Moscou dominé par les bolcheviks, une insurrection des ouvriers de la ville qui est écrasée par les contingents de l’armée revenus du front d’Extrême-Orient. Dès le début de 1906, le gouvernement a repris la situation en main.
Les Doumas
Le 6 mai 1906, à la veille de la réunion de la première Douma, le gouvernement publie les Lois fondamentales, ensemble de mesures qui préservent les pouvoirs autocratiques du tsar et restreignent les pouvoirs de la future Douma devant laquelle les ministres ne seront pas responsables.
La Douma, qui se réunit le 10 mai, est dominée par les forces d’opposition : le parti KD (constitutionnel-démocrate), créé peu de temps auparavant par les libéraux, et l’aile modérée des SR (socialistes-révolutionnaires). L’assemblée, qui exige des réformes vigoureuses, est dissoute au bout de deux mois.
Une deuxième Douma, qui enregistre un recul des KD au profit des oppositions de gauche et de droite, se réunit en mars 1907, mais est à son tour dissoute en juin, dans un climat de recrudescence des attentats terroristes.
Une nouvelle loi électorale est alors promulguée. Véritable régression, elle favorise la noblesse terrienne, faisant de 1 % de la population 64 % de l’électorat. Une troisième Douma est élue en novembre 1907, puis une quatrième en novembre 1912, consacrant le renforcement des conservateurs et marginalisant l’opposition d’un point de vue institutionnel.
Pendant ce temps, Stolypine, Premier ministre depuis juillet 1906, entreprend de moderniser l’agriculture. Les différentes mesures prises en 1906-1907, autorisant notamment les paysans à sortir du mir et à partager les terres communautaires, visent à encourager la formation d’une classe de petits propriétaires terriens : le nombre de propriétés privées passe ainsi de 2,8 millions en 1905 à 5,5 millions en 1914. Mais le ministre réformateur est assassiné en septembre 1911, laissant une œuvre inachevée.
La Première Guerre mondiale
« Protectrice des Serbes », la Russie se trouve entraînée dans la Première Guerre mondiale après la déclaration de guerre de l’Autriche à la Serbie qui suit l’assassinat de l’archiduc d’Autriche François-Ferdinand à Sarajevo, le 28 juin 1914. La quatrième Douma, alors en session, se rallie globalement à l’Union sacrée.
Dès le début de la guerre, l’armée russe, encore désorganisée par la guerre russo-japonaise, subit de graves revers, notamment en Prusse orientale où elle est totalement écrasée à Tannenberg (août 1914). La situation s’aggrave en 1915 et la guerre, supposée être brève, commence à faire ressentir ses effets dans l’empire. Sur le front, les difficultés d’approvisionnement et la mauvaise logistique jointes à l’incurie des chefs militaires encouragent les désertions massives.
La guerre devient franchement impopulaire : l’empereur, qui décide de prendre en personne le commandement des armées, arrive sur le front en septembre 1915, accentuant l’impression générale de vacance du pouvoir. L’impératrice Alexandra, guère populaire du fait de ses origines allemandes, est sous l’emprise complète de Raspoutine, qui devient le personnage le plus influent de l’empire, contrôlant jusqu’aux décisions militaires. Sa conduite provoque tant de haine qu’un groupe d’aristocrates, conduit par le prince Ioussoupov et le grand-duc Dimitri, l’assassine en décembre 1916.
De violentes manifestations, liées au manque de charbon et de pain, éclatent à Moscou en février 1917 et les soldats envoyés pour tirer sur les émeutiers se joignent à eux.
À Saint-Pétersbourg, rebaptisée, depuis le début de la guerre, Petrograd en raison de la consonance germanique de son nom, les ouvriers se mettent en grève, paralysant complètement la ville, bientôt rejoints par les soldats mutins. Cette « révolution de février » marque la fin de l’Empire russe : un gouvernement provisoire mis en place quelques jours auparavant par la Douma contraint Nicolas II et son fils à abdiquer le 15 mars 1917. Moins d’une semaine plus tard, la famille impériale est arrêtée.
La Russie depuis la fin du communisme
La difficile mise en place de la démocratie
En décembre 1991, l’URSS cesse d’exister : le 8 décembre, les présidents russe, ukrainien et biélorusse entérinent le fait en instituant à sa place une Communauté des États indépendants (CEI), officiellement constituée le 21 décembre par onze des anciennes républiques de l’Union soviétique (à l’exception de la Lituanie, de la Lettonie, de l’Estonie et de la Géorgie). Le 24 décembre, la Russie est reconnue par les Occidentaux comme État continuateur de l’URSS et lui succède au Conseil de sécurité des Nations unies. Dès le lendemain, Mikhaïl Gorbatchev démissionne de la présidence de l’URSS et transmet à Boris Eltsine, président de la Russie, le contrôle de l’armement nucléaire.
Boris Eltsine, leader des réformateurs, est élu président
de la Russie au suffrage universel en juin 1991, avec 57 % des voix
dès le premier tour, tandis qu’Alexandre Routskoï, ouvertement
plus conservateur, est devenu vice-président. Les conservateurs,
regroupés autour du président du Parlement, émanation
du Congrès des députés du peuple (CDP), Rouslan Khasboulatov,
cherchent à contrer Eltsine après le lancement de son programme
de réformes économiques radicales au début de l’année
1992.
En décembre 1992, le Parlement refuse de confirmer dans son poste
Iegor Gaïdar, principal architecte des plans de réformes gouvernementaux,
Premier ministre en exercice depuis juin 1992, et désigne à sa
place le « pragmatique » Viktor Tchernomyrdine, membre de longue
date du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS), apparaissant
comme partisan d’une politique économique moins radicale. Le même
mois, la Cour constitutionnelle revient sur la décision prise par
le Soviet suprême de l’URSS, avant son autodissolution en août
1991, de suspendre les activités du PCUS, redonnant au parti la
possibilité officielle de reconquérir une nouvelle audience.
La Russie se trouve dans une véritable impasse politique, entre
une équipe gouvernementale engagée sur la voie d’indispensables
réformes et un organe législatif se référant
sans cesse à la Constitution de 1977, mise en place durant l’ère
brejnévienne et devenue complètement inadaptée. Conservateurs
et réformistes arrivent pourtant à un accord sur la tenue
d’un référendum en avril 1993, vivement souhaité par
Boris Eltsine.
Le 25 avril 1993, 58 % des votants expriment leur soutien à Eltsine, qui remporte ainsi une victoire retentissante, mais demeure empêtré dans les mêmes luttes de pouvoir. En septembre 1993, il suspend de ses fonctions le vice-président Routskoï, accusé de corruption, décision à laquelle s’oppose le Parlement. Le même mois, il publie un décret de dissolution du Soviet suprême en raison de l’obstruction des députés conservateurs aux travaux de l’Assemblée constituante, convoquée après le référendum pour élaborer un nouveau projet de Constitution.
Le Parlement juge contraires à la Constitution les décisions du président et nomma Routskoï à sa place. Une centaine de députés et plusieurs centaines de partisans armés avec à leur tête Khasboulatov et Routskoï occupèrent le siège du Parlement, la « Maison-Blanche », et refusèrent de se disperser. La situation, qui semblait complètement bloquée, évolua le 3 octobre : la tentative des rebelles d’attaquer la mairie et la tour de la télévision d’Ostankino permit au gouvernement de riposter. La Maison-Blanche fut bombardée par les forces loyalistes qui donnent ensuite l’assaut, le 4 octobre. Routskoï et Khasboulatov sont faits prisonniers et accusés « d’organisation de désordre de masse ». Plus de 140 personnes sont tuées au cours de la rébellion.
La recomposition du paysage politique russe
Cependant, la victoire
de Boris Eltsine sur les forces conservatrices est de courte durée. Si le référendum de décembre
1993 sur la nouvelle Constitution, qui augmente ses pouvoirs de président,
lui est favorable, les élections législatives qui se tiennent
parallèlement voient le triomphe inattendu des partis communistes
et ultranationalistes — notamment le Parti libéral-démocrate
de Vladimir Jirinovski —, qui forment une opposition « bruns-rouges » aux
forces démocratiques. En février 1994, les putschistes
de 1991 et les insurgés d’octobre 1993 sont amnistiés par
la Douma d’État.
Le gouvernement de Boris Eltsine, déjà affaibli par de
nombreuses « affaires » et
cherchant à participer au règlement du conflit yougoslave,
se trouve bientôt confronté à un nouveau problème
en Tchétchénie, dont la situation géographique est
stratégique, puisqu’elle contrôle, avec le pipeline en provenance
de la mer Caspienne, la route du pétrole de la Russie. Les Russes
refusent de reconnaître l’indépendance de la Tchétchénie,
proclamée en octobre 1992 par le général Djokhar Doudaïev,
qui, devenu président, apparaît de plus en plus comme une
menace. Le blocus économique décrété par Boris
Eltsine restant sans effet, la Russie entre en guerre avec la Tchétchénie
en décembre 1994. L’opération militaire, contre toute attente,
entraîne le pays dans un véritable désastre et la violence
de l’armée russe suscite l’émotion de l’opinion nationale
et internationale. Après avoir fait des milliers de morts dans les
deux camps, le conflit ne trouve un règlement provisoire, sous la
forme d’un cessez-le-feu, qu’à la veille de l’élection présidentielle,
en juin 1996.
Arrivé en tête au premier tour du scrutin (34,8 % des
voix, puis 52 % à l’issue du second tour) et talonné par
Guennadi Ziouganov, le leader communiste (32,1 %), Boris Eltsine fait
alliance avec le général Alexandre Lebed (14,7 %), le
nomme secrétaire du Conseil de sécurité, puis le limoge
en septembre de la même année. Ces élections révèlent
ainsi la fragilité de la position de Boris Eltsine et de ses alliances
politiques, ainsi que les profondes divisions d’une société russe
en pleine mutation.
Une situation économique et politique préoccupante
La situation du pays demeure très préoccupante. Malgré la signature, en octobre 1996, d’un accord de paix avec les nationalistes, les tensions restent vives en Tchétchénie. Les retards importants dans le paiement des salaires des fonctionnaires alimentent une forte agitation sociale, tandis que les problèmes de criminalité, liés à l’essor de la mafia russe, entretiennent un climat d’insécurité. Sur le plan politique, la santé précaire du président ravive les rivalités entre le clan Tchernomyrdine, les réformateurs — Tchoubaïs, Nemtsov — et les « oligarques », dont le financier Berezovski.
Sur le plan extérieur, la Russie, devenue membre du G8 (composé des pays du G7 et de la Russie), enregistre certains succès, notamment lors de la résolution de la crise irakienne en 1997. Ses tentatives de rapprochement avec la Chine et le Japon ne donnent, en revanche, guère de résultats et elle doit accepter, en juillet 1997, l’extension de l’OTAN à certains pays de l’ancien pacte de Varsovie — Pologne, Hongrie et la République tchèque. Avec l’Alliance atlantique, la Russie signe un acte fondateur prévoyant la création d’un conseil conjoint afin de discuter des problèmes de sécurité communs aux deux partenaires. Elle réussit également à renforcer son influence parmi les États de l’ex-URSS, notamment la Biélorussie et l’Ukraine, et à défendre les intérêts des russophones de Lettonie, mais doit faire face, en Asie centrale et en Transcaucasie, à la concurrence, principalement économique (pétrole de la Caspienne) des États-Unis, désormais très présents dans ces régions.
Limogé en mars 1998, Viktor Tchernomyrdine est remplacé par Sergueï Kirienko, membre du courant réformateur, lui-même limogé dès le mois d’août, tandis que les postes sont redistribués entre les différents clans. En mai 1998, le nouveau gouvernement doit affronter une crise sociale (mouvement des mineurs de Sibérie réclamant le paiement de leurs salaires) et financière (chute du rouble et hausse brutale des taux d’intérêt) qui conduit le FMI, la Banque mondiale et le Japon à accorder à la Russie, contre l’engagement de réduire de moitié le déficit budgétaire, une aide de 22,6 milliards de dollars, étalée sur 1998 et 1999, dont l’objectif est d’éviter la dévaluation du rouble (qui s’effondre les mois suivants).
En juillet 1998, les restes du tsar Nicolas II et d’une partie de sa famille, exécutés par les Bolcheviks en 1917, sont inhumés dans la forteresse Pierre-et-Paul de Saint-Pétersbourg.
La Russie et les pays occidentaux
En août 1998, la crise s’accentue avec la chute de la Bourse et la crise bancaire. Rappelé par Boris Eltsine, Viktor Tchernomyrdine n’est pas investi par la Douma qui lui préfère Evgueni Primakov, ministre des Affaires étrangères depuis janvier 1996 et ancien chef du contre-espionnage ; celui-ci lance un plan anti-crise et obtient un accord de réaménagement de la dette avec le Club de Londres. Toutefois, les retards de paiement entraînent une mise en garde des créanciers privés et publics et la suspension de l’aide par l’Union européenne, qui veut protester contre les blocages administratifs. Le troc et le paiement en nature deviennent pratique courante, notamment pour remplacer les salaires.
En politique intérieure, les problèmes de santé de Boris Eltsine, par ailleurs mis en cause avec sa famille dans des « affaires », relancent les spéculations sur son remplacement. Devenu trop populaire, Primakov est remplacé en mai 1999 par Sergueï Stepachine, plus docile. Au même moment échoue une tentative d’impeachment (destitution) du président par la Douma. En politique étrangère, des discussions sur les Kouriles laissent la situation en l’état, tandis qu’une déclaration est signée avec la Biélorussie en vue d’une union entre les deux pays. Lors de la crise du Kosovo (printemps 1999), la Russie condamne fermement l’« agression » de l’OTAN, avec qui elle gèle sa coopération et tente une médiation politique, menée par Tchernomyrdine. Un plan de sortie de crise préparé au sein du G8 est finalement accepté par Slobodan Miloševic en juin 1999.
L’ère
Poutine
Un succès électoral sur fond de guerre en Tchétchénie
Limogé en août 1999, Stepachine est remplacé par le chef des services secrets Vladimir Poutine. Parallèlement, la tension monte au Daguestan où des fondamentalistes islamistes, infiltrés de Tchétchénie (voir guerres de Tchétchénie), s’affrontent aux forces fédérales. Attisé par une série d’attentats en Russie, attribués aux Tchétchènes, le conflit s’étend en septembre sur leur territoire. Refusant toute ingérence internationale dans ce qu’elle considère comme une « opération anti-terroriste », Moscou se livre à une guerre sans merci et s’empare de Groznyï, la capitale tchétchène, en février 2000. Les Russes ne contrôlent pas pour autant la Tchétchénie, où les rebelles indépendantistes continuent leur guérilla en attendant l’ouverture des négociations.
Condamnée par la communauté internationale en raison des atrocités commises contre la population civile, cette guerre vaut pourtant à Poutine, inconnu jusqu’à sa nomination, une forte popularité dans son pays, qui lui assure la victoire aux élections législatives de décembre 1999. Le Parti communiste (24,5 % des voix) devance la liste « Unité » soutenue par le Kremlin (23,8 %), mais celle-ci, grâce aux voix de « l’Union des forces de droite » (SPS) et à celles d’une bonne partie des 105 « indépendants », dispose de la majorité à la Douma, pour la première fois depuis 1991. Lors de l’élection présidentielle de mars 2000, anticipée en raison de la démission de Boris Eltsine en décembre 1999, Vladimir Poutine remporte 52,52 % des suffrages, dès le premier tour.
Les premiers pas de Vladimir Poutine
Le deuxième président élu de Russie, dont le slogan de campagne affiche « la démocratie, c’est la dictature de la loi », entend bien préserver l’intégrité territoriale du pays — en décembre 1999, des accords frontaliers historiques sont passés avec la Chine — et profiter d’une situation économique (en apparence) assainie, quoique la population russe souffre toujours d’une grande pauvreté. En mai 2000, Mikhaïl Kassianov, ancien ministre des Finances et vice-Premier ministre, est nommé Premier ministre.
Vladimir Poutine s’efforce de mettre en place un régime plus centralisé en créant, en juin 2000, 7 « super-régions », qui viennent chapeauter les 89 subdivisions administratives existantes. Cette réforme de la structure fédérale, qui réduit le rôle et le pouvoir des gouverneurs de régions et des présidents des républiques autonomes en les plaçant directement sous le contrôle du Kremlin, vise aussi à contrôler l’application de la loi fédérale et à empêcher ses violations.
Au plan international, la Russie renoue ses relations avec l’OTAN, ratifie le traité START II et celui d’interdiction des essais nucléaires, tout en réaffirmant avec force sa doctrine de dissuasion nucléaire et en rejetant le projet américain de bouclier antimissiles présenté par Bill Clinton lors d’une visite officielle du président américain à Moscou. L’opposition à ce projet accélère l’évolution de la politique étrangère du pouvoir russe, qui privilégie les liens avec l’Asie, en mettant notamment l’accent sur les relations avec l’Inde et la Chine, face à la « domination des États-Unis ».
En Tchétchénie, le pouvoir fédéral entend « normaliser » une situation qui demeure cependant très critique. La pression des rebelles tchétchènes reste forte tandis que des attentats ont lieu en Russie, attribués par Moscou aux indépendantistes. Le conflit tchétchène vaut d’ailleurs au Kremlin d’être condamné par l’ONU. Officiellement, la région est pacifiée. Akhmad Kadyrov, chef religieux tchétchène pro-russe, est nommé au poste d’administrateur en juin 2000.
Une popularité à toute épreuve
Le naufrage dans la mer de Barents d’un sous-marin nucléaire en août 2000 (qui a entraîné la mort des 118 marins) met au jour la précarité de la Flotte du Nord russe, qui, selon certains spécialistes, ne fait plus l'objet de contrôles réguliers par manque de moyens financiers. Les médias russes et une partie de l'opinion dénoncent l'opacité et le caractère contradictoire des informations officielles données sur cette catastrophe, l'inaction et le manque de sensibilité du chef de l'État et l'incapacité de la Flotte du Nord à porter secours au sous-marin. Surtout, ce naufrage marque symboliquement un déclin de la puissance militaire russe tout comme, en mars 2001, la destruction programmée de la station Mir est apparue comme un affaiblissement de la Russie dans le domaine de la conquête spatiale.
En janvier 2001, Vladimir Poutine confie aux services de sécurité russes la direction des opérations en Tchétchénie. Le FSB (ex-KGB dont est issu Poutine) est ainsi censé remplacer progressivement une armée en pleine crise. Toutefois, face à l’enlisement du conflit, la réduction des troupes russes en Tchétchénie doit être suspendue dès le mois de mai 2001. Loin d’être défaits, les indépendantistes tchétchènes continuent de harceler les forces fédérales par de nombreuses actions de guérilla. En juillet 2001, à la suite de la découverte et de la dénonciation d’exactions commises par les militaires russes (exécutions sommaires, torture, enlèvements, disparitions), Vladimir Poutine doit reconnaître les « abus » de son armée.
Sur le plan de la politique intérieure, le président russe poursuit sa lutte « anti-corruption » en s’attaquant aux oligarques de l’ère Eltsine, ces hommes d’affaires qui ont amassé des fortunes lors des privatisations opaques des années 1990. Il s’en prend en particulier aux magnats de l'économie des médias, tels que Vladimir Goussinski, directeur de la chaîne de télévision indépendante NTV, particulièrement critique sur la guerre de Tchétchénie, et Boris Berezovski, propriétaire de la chaîne TV6. En avril 2001, le géant gazier Gazprom, dont l’actionnaire majoritaire est l’État, prend le contrôle de NTV, entraînant aussi la fermeture du journal Segodnya et le renvoi des journalistes du magazine Itogy. La chaîne TV6 est contrainte de fermer en janvier 2002. Opérée au nom de la stabilité économique et de la lutte contre la corruption, cette mainmise sur les médias porte gravement atteinte à la liberté et au pluralisme de l’information en Russie. Elle s’accompagne en outre d’un renforcement du contrôle du Kremlin sur les partis politiques par l’adoption en juillet 2001 d’une loi limitant le nombre de partis politiques. Visant à assurer la stabilité politique dans un pays caractérisé par le fractionnement des forces politiques, cette loi aboutit à l’interdiction d’environ 90 % des quelque 180 formations politiques existantes.
En dépit de ces mesures contestables, de la gestion catastrophique du drame du Koursk, des difficultés économiques et de l’enlisement de la guerre en Tchétchénie, Vladimir Poutine continue de bénéficier globalement du soutien d’une majorité de la population.
La Russie dans le concert des nations
La place de la Russie au sein de la communauté mondiale change fondamentalement au lendemain des attentats du 11 septembre. Engagées totalement dans la campagne internationale menée contre le terrorisme, les autorités russes collaborent étroitement avec les États-Unis en Afghanistan. L’engagement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme international prend toutefois essentiellement la forme d’une guerre acharnée contre les nationalistes tchétchènes, accusés d’être liés au réseau Al Qaida. Alors que la diplomatie occidentale tend à retirer son soutien à la cause indépendantiste tchétchène, la Russie se rapproche fortement des pays occidentaux. En mai 2002, les États-Unis et la Russie signent plusieurs accords, portant notamment sur la réduction de leurs arsenaux nucléaires, tandis qu’est créé un conseil conjoint OTAN-Russie.
Alors qu’en janvier 2002, l’état-major russe affirme avoir remporté la victoire en Tchétchénie, les attaques des rebelles tchétchènes contre les forces russes et les responsables tchétchènes pro-russes se multiplient tout au long de l’année qui suit, de même que les opérations militaires menées contre la guérilla. En août 2002, notamment, plus de 100 soldats sont tués dans le crash d’un hélicoptère russe abattu par les indépendantistes. Le conflit tchétchène se radicalise encore en octobre 2002, lorsqu’un commando tchétchène prend en otage plus de 700 spectateurs dans un théâtre de Moscou. Dirigé par Movsar Baraïev (23 ans), le commando, composé d’une cinquantaine de membres, réclame la fin des combats et le retrait des troupes russes de Tchétchénie. La prise d’otages se conclut tragiquement dans la nuit du 25 au 26 octobre par l’assaut des forces spéciales russes. Tous les preneurs d’otages sont tués ainsi que plus de 100 otages, décédés des suites de l’inhalation d’un gaz paralysant utilisé lors de l’assaut. Les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’assaut créent de vives polémiques en raison notamment de la brutalité de l’opération, de la nature du gaz utilisé et de l’inefficacité des secours.
La mainmise du gouvernement sur la vie politique russe
À l’approche des élections législatives de décembre 2003 et du scrutin présidentiel de 2004, Vladimir Poutine entend consolider son pouvoir. Afin de normaliser la situation en Tchétchénie, il organise en mars 2003 un référendum auprès de la population de la république séparatiste sur l’adoption d’une nouvelle Constitution qui affirme l’appartenance de la république à la fédération de Russie. Caractérisé par un taux de participation massif (plus de 85 %) et par un plébiscite en faveur de la nouvelle Constitution (96 % de « oui »), ce référendum suscite de vives critiques parmi les observateurs russes et étrangers quant à sa légitimité (irrégularités, pressions exercées sur les électeurs).
Le pouvoir de Vladimir Poutine sort renforcé des élections législatives de décembre 2003, qui voient la formation pro-présidentielle, Russie unie, obtenir près de la moitié des sièges à la Douma. Ce scrutin est marqué par la défaite du Parti communiste qui, pour la première fois dans l’histoire du pays, n’est pas en tête des élections. Il est également marqué par le net recul des partis libéraux et par une percée remarquable des partis nationalistes. Pour les observateurs internationaux, ces élections, qui n’ont pas assuré à toutes les formations politiques un accès équitable aux médias audiovisuels (désormais contrôlés par l’État), constituent une régression du processus démocratique en Russie.
À quelques semaines de l’élection présidentielle de mars 2004, Vladimir Poutine crée la surprise en annonçant la dissolution de son gouvernement et la nomination d’un nouveau Premier ministre, Mikhaïl Fradkov, inconnu du grand public. Le limogeage de Mikhaïl Kassianov, ancien ministre des Finances sous Boris Eltsine, peut s’inscrire dans la « chasse aux oligarques » menée par le président russe. Il s’agit aussi de constituer autour de lui une équipe d’hommes fidèles.
C’est avec 71,91 % des suffrages que Vladimir Poutine est réélu le 14 mars 2004 pour un second mandat de quatre ans. Son principal rival, le communiste Nikolaï Kharitonov, recueille seulement 13,80 % des suffrages. Le président sortant peut certes faire valoir des résultats économiques très satisfaisants dans la mesure où l’économie de la Russie a progressé d’au moins 5 % durant chaque année de son premier mandat. Les observateurs internationaux et l’opposition russe dénoncent toutefois une campagne électorale biaisée par une couverture médiatique qui a considérablement favorisé le candidat Poutine.

Russie, [fédération de Russie (en russe, Rossia, Rossiiskaïa Federatsia)] pays d’Europe orientale et d’Asie septentrionale.
La Russie est bordée au nord par l’océan Arctique (mer de Barents, mer de Kara, mer des Laptev, mer de Sibérie orientale, mer de Tchoukotka) ; à l’est, par l’océan Pacifique via le détroit de Béring (qui sépare la Russie de l’Alaska), la mer de Béring, la mer d’Okhotsk et la mer du Japon ; au sud, par la Corée du Nord, la Chine, la Mongolie, le Kazakhstan, la mer Caspienne, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la mer Noire ; à l’ouest, par l’Ukraine, la Biélorussie, la Lettonie, l’Estonie, la mer Baltique (golfe de Finlande), la Finlande et la Norvège. La Russie possède l’enclave de Kaliningrad, située entre la Lituanie et la Pologne, ainsi qu’un certain nombre d’îles, dans l’océan Arctique (terre François-Joseph, Novaïa Zemlia, Severnaïa Zemlia, archipel de la Nouvelle-Sibérie, île Wrangel), et dans l’océan Pacifique (îles Kouriles, île de Sakhaline).
Avec une superficie de 17 075 200 km², la Russie est le plus vaste pays du monde. Elle forme un État-continent, étendu sur près de 3 000 km du nord au sud et sur près de 9 000 km d’ouest en est (11 fuseaux horaires). Sa capitale est Moscou.
La fédération de Russie est une république fédérale comprenant 21 républiques (dont la Tatarie et la Tchétchénie), 6 territoires (kraï), 49 régions (oblast), 10 districts autonomes (avtonomnyi okroug), la région autonome juive du Birobidjan (sur l’Amour, en Extrême-Orient) et deux villes de statut fédéral, Moscou et Saint-Pétersbourg. Certaines frontières suscitent des contestations (Crimée, îles Kouriles) tandis que la montée des régionalismes, depuis la fin de l’URSS, menace la cohésion interne du pays.
Née du démantèlement de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) en 1991, la fédération de Russie correspond à l’ancienne République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR), créée en 1918. Elle est devenue un État souverain le 25 décembre 1991. Elle a perdu les colonies d’Asie centrale et de Transcaucasie, les pays baltes et surtout l’Ukraine et la Biélorussie, noyau historique de l’État russe. La Russie post-soviétique maintient toutefois, dans le cadre de la Communauté des États indépendants (CEI), instituée en 1991, des liens privilégiés avec les anciennes républiques soviétiques.
La Russie a vu disparaître, avec l’effondrement de l’empire communiste, un régime totalitaire. Elle est aujourd’hui confrontée à une difficile transition vers la démocratie et l’économie de marché. Un vaste programme de réformes économiques a été lancé début 1992. Toutefois, dans cet État qui fut la deuxième puissance économique du monde, la libéralisation de l’économie s’accompagne d’une crise profonde et durable. L’instabilité économique et politique reste grande dans une société désemparée, voire désabusée.
La Russie est à cheval sur les deux continents européen et asiatique, la frontière conventionnelle étant constituée par les monts Oural, avec 25,3 % du territoire est en Europe et 74,7 % en Asie (Sibérie). Elle possède 37 653 km de côtes, le long de l’océan Arctique et de l’océan Pacifique.
La Russie peut être divisée en quatre grandes régions
géographiques : la Russie d’Europe, à l’ouest de l’Oural,
la Sibérie occidentale, la Sibérie orientale et l’Extrême-Orient
russe. Le relief général consiste en de vastes plaines
et plateaux, bordés au sud et à l’est par une ceinture
discontinue de hautes montagnes périphériques. Immensité et
platitude générale donnent aux paysages un caractère
fortement monotone.
La Russie d’Europe (Russie occidentale) est une vaste plaine dont
l’altitude moyenne est de 180 m environ. Il existe toutefois quelques
hauteurs :
montagnes de Khibiny (1 191 m), dans la presqu’île de Kola ; plateau
des Valdaï (321 m), à l’ouest de Moscou. C’est sur ce dernier
que prend naissance le réseau hydrographique de la plaine européenne
(Dniepr, Volga, Daugava). Les glaciations du quaternaire y ont laissé leur
empreinte, notamment au nord-ouest où elles sont à l’origine
de nombreuses cuvettes lacustres (lac Ladoga, lac Onega). La dernière
glaciation, qui s’acheva il y a environ 14 000 ans, a laissé une
longue moraine frontale, depuis la frontière biélorusse
jusqu’à la côte arctique, à l’ouest de l’embouchure
de la Petchora. La partie méridionale de la plaine européenne
se caractérise par des sols de terres noires (tchernoziom) très
fertiles, notamment dans les bassins du Don, de la Volga et du Kouban.
Au sud, entre la mer Noire et la mer Caspienne, se dresse la barrière
montagneuse du Caucase, montagne jeune, fortement sismique. Le Grand
Caucase au nord forme la frontière avec la Géorgie et l’Azerbaïdjan.
Il culmine à 5 642 m d’altitude au sommet du mont Elbrouz, volcan éteint
et plus haute montagne d’Europe. À l’est, la Russie d’Europe est
bordée par les monts Oural, massif ancien très érodé d’altitude
moyenne (Narodnaïa, 1 894 m). Ce sont des montagnes riches en gisements
minéraux.
À
l’est de l’Oural s’étend, sur plus de 2 000 km, la vaste plaine
de Sibérie occidentale, ouverte sur l’océan Arctique, dont
le soubassement est constitué par un socle ancien. Elle est formée
de basses terres (moins de 200 m d’altitude), extrêmement plates
et mal drainées. Couverte de dépôts glaciaires, héritages
des glaciations quaternaires, la région est parsemée de
lacs et de marécages.
À l’est de l’Ienisseï s’étendent les plateaux de Sibérie centrale, qui culminent entre 300 et 1 200 m d’altitude. La région, accidentée par des fossés (lac Baïkal) et de profonds canyons, possède de nombreux gisements minéraux. Aux frontières méridionales se dresse une haute barrière montagneuse formée par l’Altaï (mont Beloukha, 4 506 m) et les monts Saïan (Mounkou Sardyk, 3 491 m).
À l’est de la Lena s’élèvent les massifs montagneux de l’Extrême-Orient russe (Sibérie orientale), avec au nord les monts de la Kolyma (1 962 m), au centre les monts de Verkhoïansk (2 389 m), au sud-ouest les monts Stanovoï (2 999 m) et les monts Iablonovyï (1 680 m) et au sud-est les monts Sikhote-Aline (2 077 m). À l’est, en bordure de l’océan Pacifique, se dressent des chaînes plus récentes et plus élevées. L’activité volcanique est importante dans cette région qui fait partie de la « ceinture de feu du Pacifique ». La péninsule du Kamtchatka comporte 120 volcans dont 23 sont encore en activité. Le plus élevé, le mont Klioutchevskaïa, culmine à 4 750 m. La chaîne volcanique du Kamtchatka se prolonge vers le sud dans les îles Kouriles qui possèdent également une centaine de volcans dont 35 en activité.
 |
||
 |
 |
La Fédération de Russie
est un état souverain héritier de l'ancienne Russie,
de la République Socialiste Fédérative Soviétique
de Russie (R.S.F.S.R.) et de l'U.R.S.S. En décembre 1991,
la R.S.F.S.R. a cosigné les traités créant la
C.E.I. (Communauté des Etats Indépendants) et a adopté le
nom de Fédération de Russie. La plupart des autres
nations de l'Union Soviétique sont devenues des états
unitaires égaux dans la C.E.I. Dans cette communauté,
la Russie est le plus grand des états membres. Le drapeau marchand russe fut conçu par le tsar de Russie, Pierre le Grand (Moscou 1672 - Saint-Pétersbourg 1725), en 1699, et devint drapeau national le 7 mai 1883. En 1918, il fut remplacé par un drapeau rouge aux initiales dorées RSFSR dans le guindant supérieur. Depuis 1990, le tricolore blanc-bleu-rouge a été de nombreuses fois arboré au cours de manifestations pour la démocratie. Il fut officiellement réadopté le 11 décembre 1993. La version russe du tricolore reçut une interprétation conforme à l'histoire nationale. Certains y virent les couleurs de Saint-Georges-le-Victorieux, avec son manteau bleu et son cheval blanc. Le blanc symbolisait, la noblesse et la franchise ; le bleu la véracité, l'honneur, la droiture et la chasteté ; le rouge l'amour, le courage, la hardiesse et la générosité. On remarque également que le blanc était traditionnellement associé à la Russie blanche (la Biélorussie), le bleu à la petite Russie (l'Ukraine) et le rouge à la grande Russie (la Russie proprement dit). Une autre interprétation nous dit que selon la tradition byzantine, le rouge symbolise la dignité impériale, le bleu évoquait la Vierge, protectrice de la Russie et le blanc signifiait liberté et indépendance. |
 |
 |
Officialisées le 25 novembre 1993. Sur fond de gueules, aigle doré bicéphale (symbolisant l'Orient et l'Occident), surmontée de 3 couronnes (pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire), enserrant le spectre royal de la souveraineté nationale et le globe terrestre coiffé de la croix pattée de l'Eglise orthodoxe ; sur le portrail, le blason de Moscou (saint Georges victorieux du dragon). |
 |
Russia - sacred our impire, Russia - favourite our country. Mighty will, great glory - Yours virtue on all times ! CHORUS Sing to the Fatherland, ours free, From the southern seas up to polar edge CHORUS Wide open space for dream and for life |
L'hymne de la Russie tsariste, qui commençait par "Dieu, protège le tsar", adopté par Nicolas I en 1834, a été abrogé par les bolcheviques en 1918, et remplacé par l'Internationale, l'hymne du communisme mondial composé par un Français pendant la Commune de Paris. En 1943, en plein milieu de la Seconde guerre mondiale et pour soutenir son idéologie patriotique, Staline décide d'abandonner l'Internationale pour donner aux Soviétiques leur propre hymne. De nombreux poètes et musiciens sont alors invités au Kremlin. Les travaux ont duré plusieurs mois, le "petit père des peuples" rejetant tour à tour 27 textes et 10 mélodies. En septembre 1943, Staline finit par approuver la mélodie du compositeur Alexandre Alexandrov et le texte du poète officiel de l'époque, Sergueï Mikhalkov, le père des cinéastes russes Nikita Mikhalkov ("Soleil Trompeur") et Andreï Mikhalkov-Kontchalovski ("Maria's Lovers"). C'est un texte de Mikhalkov qui a de nouveau été choisi pour accompagner la musique de l'hymne national.
|
 |
|||
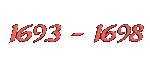 |
 |
 |
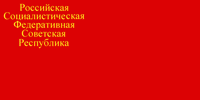 |
 |
 |
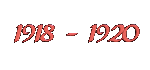 |
 |
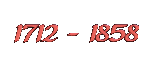 |
 |
 |
 |
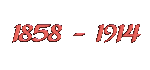 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
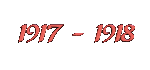 |
 |
 |
 |
 |
||
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
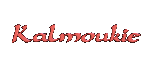 |
 |
 |
 |
 |
 |
||
Certains
des éléments de cette page proviennent des sites suivants:
|



