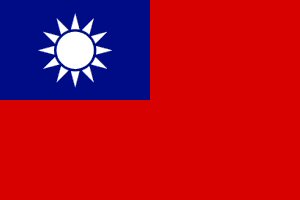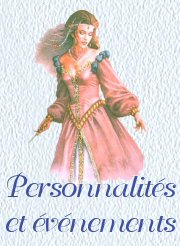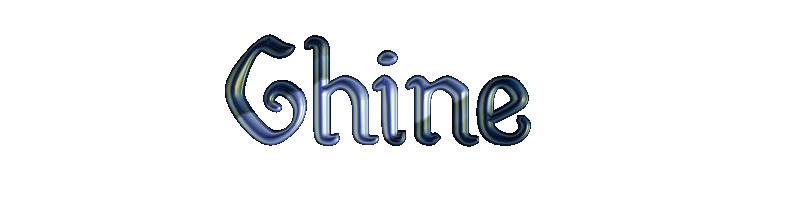
Dans cette époque de confusion, la pensée chinoise crée les grands systèmes de valeur yni vont durer jusqu'à nos jours, avec Lao-tseu, fondateur du taoïsme, et Confucius (VIe-Ve siècle av. J.-C.). Le souverain Qin met fin à l'anarchie des Royaumes combattants». Shi Huangdi (221-210 av. J.-C.) crée, pour la première fois, un empire chinois unifie qu'il veut mettre à l'abri des nomades turco-mongols en édifiant la Grande Muraille. En 206 av. J.-C. est fondée la dyn. des Han qui dure jusqu'en 220 ap. J.-C. Se fixe alors l'organisation d'une Chine confucéenne, au corps de fonctionnaires recrutés par concours ; l'expansion militaire en Chine centrale permet l'ouverture de la Route de la soie.
Du IIIe au VIe, le morcellement de la Chine en de nombreux royaumes favorisa les invasions étrangères ; endant cette période troublée, le bouddhisme pénétra profondément la Chine. La réunification fut l'muvre de la dynastie Sui (581-617), qui réorganisa le pays et prépara la renaissance Tang (618-907), sous laquelle de grandes réformes (agraires, fiscales, administratives, économiques) et de vastes conquêtes (Asie centrale, Mongolie, Viêt-nam) assurèrent l'épanouissement d'une civilisation brillante : âge d'or de la poésie, invention de la xylographie (méthode d'impression par planches gravées). Après un demi-siècle d'unité perdue (907 - 906), la période Song (960-1279) fut marquée par de nombreux progrès : généralisation de l'imprimerie, invention de l'aiguille magnétique, de la boussole, de la poudre.
A la fin du XIIIe siècle, à la tête des tribus mongoles, Gengis Khan conquit toute la Chine ; son petit-fils Koubilaï Khan fonda la dynastie des Yuan (1261-1368) et fit de Pékin sa capitale, où il accueillit Marco Polo.
Sous la dynastie des Ming (1368-1644), les grands travaux d'irrigation et de drainage s'accompagnèrent d'une forte croissance démographique (de 60 millions à 150 millions d'habitants). Au XVIIe siècle, les Mandchous profitèrent de la sclérose du régime des Ming pour imposer leur dynastie, celle des Qing (1644-1911). Après avoir suscité une importante expansion territoriale (Mongolie, Tibet, Yunnan, Asie centrale, Taiwan, Corée, Viêt-nam, Népal, Birmanie), elle ne put résister au choc du contact avec les, pays industrialisés (pays européens, États-Unis, puis Japon) au XIXe siècle.
Conclusion de la guerre de l'Opium avec l'Angleterre (1839-1842), le traité de Nankin (1842) ouvrit des ports aux Occidentaux. Dès lors, les grandes puissances européennes et les États-Unis exigèrent l'accès aux ports chinois, notant après la révolte des Taiping (1853-1864) qui fut le prétexte d'une intervention franco-anglaise. Toutes les puissances établirent des concessions dans les grandes villes chinoises et obtinrent des territoires à bail. À l'issue de la guerre sino-japonaise (18941895), la Chine perdit Taiwan et la Corée. La révolte des Boxers (1900), nationalistes et xénophobes, encouragée par l'impératrice Ci Xi, fut matée par un corps expédi tionnaire occidental.
En 1912, les Mandchous abdiquèrent face au Guomindang nationaliste et républicain de Sun Zhongshan (Sun Yat-sen), dont l'alliance avec le parti communiste (1921) fut rompue en 1925, après la mort de Sun Zhongshan ; son successeur, Jiang Jieshi (Tchang Kaï-chek), s'empara du pouvoir. Après avoir subi une sanglante répression en 1927 à Canton et à Shanghai, les communistes, sous la direction de Mao Zedong, s organisèrent et fondèrent en 1931 une « République soviétique chinoise » dans les montagnes du Jiangxi, d'où ils devaient atteindre, au terme de la Longue Marche (1934-1935), le Shanxi. La guerre sino-japonaise (1937-1945) rovoqua une alliance tactique de rang Jieshi et des communistes, rompue en 1945, après la défaite du Japon. La guerre civile (1945-1949) entre nationalistes et communistes aboutit à la victoire des partisans de Mao Zedong, qui, en promulguant la réforme agraire, se rallièrent les masses paysannes. Jiang Jieshi se réfugia à Taiwan ; le 1er octobre 1949 fut proclamée à Pékin la république populaire de Chine. Après la signature d'un traité d'amitié avec l'U.R.S.S. (1950), les relations se tendirent puis se rompirent en 1960. Par la suite, l'opposition sinosoviétique a subsisté, provoquant même de sanglants incidents en 1969 sur l'Oussouri.
A l'intérieur, la révolution ininterrompue connut plusieurs phases : campagne de critiques du Parti, dite des « Cent Fleurs », suivie d'une « rectification » (1956-1957); « grande révolution culturelle » (1966-1967), qui renouvela les cadres (destitution de Liu Shaogi) ; campagne commune contre Lin Biao (ancien ministre de la Défense) et contre la pensée de Confucius (1974) ; enfin campagne contre Deng Xiaoping accusé d'économisme, après la mort de Zhou Énlai (1976).
Malgré ces luttes, le rôle de la Chine dans le monde n'a cessé de s'affirmer entrée dans le «club nucléaire» (1964), admission à l'ONU (1971), voyage de Nixon (février 1972). Après la mort de Mao (1976) et avec la défaite de la gauche (condamnation de la « bande des quatre » dont la veuve de Mao) et, implicitement du maoïsme, Deng Xiaoping (réhabilité en 1977) est revenu au pouvoir par personne interposée : Zhao Ziyang a succédé à Hua Guofeng au poste de Premier ministre. D'importants changements politiques et économiques s'ensuivirent ; une nouvelle constitution fut adoptée en 1982 et un président de la République (honorifique), Li Xiannian, élu en 1983.
Les relations avec l'U.R.S.S. s'apaisèrent mais la tension demeura longtemps vive avec le Viêt-nam (soutenu par l'U-R.S.S) avec qui un conflit armé éclata en février 1979. En 1987, Hu Yao bang, secrétaire du Parti, fut mis à l'écart et 95 membres du Comité central (sur 279) laissèrent la place à une génération plus jeune. Zhao Ziyan nommé secrétaire général du Parti, devint le successeur officiel de Deng Xiaopin tandis que Li Peng était nommé Premier ministre. En mai 1989, alors qu'une visite officielle de M. Gorbatchev mit fin à trente ans de brouille entre Moscou et Pékin, des étudiants réclamèrent la réhabilitation de Hu Yaobang sur la place Tien Anmen Manifestations et troubles affectèrent l'ensemble du pays, mais l'armée réprima la contestation au début de juin (plusieurs milliers de morts, des dizaines de milliers d'arrestations). Zhao Ziyanp fut remplacé par Jiang Zemin à la tête du parti.
La loi martiale ne fut levée à Pékin qu'en janvier 1990, tandis que Deng Xiaoping demandait en mars à être déchargé de ses dernières fonctions officielles. Les frontières occidentales de la Chine sont troublées par la résistance à la sinisation forcée dans le Tibet nationaliste et, depuis 1990, dans le Xianjiang musulman.
La normalisation des relations sino-vietnamiennes depuis 1988 a rendu possible le réglement du conflit opposant les factions khmères au Cambodge.

Officiellement République populaire de Chine, en chinois Zhonghua Renmin Gongheguo. État d’Asie orientale, délimité par 15 000 km de frontières terrestres, partagées avec 14 pays, et une façade maritime de 14 500 km. La Chine est bordée, au nord, par la Russie et la Mongolie ; au nord-est, par la Russie et la Corée du Nord ; à l’est, par la mer Jaune et la mer de Chine orientale ; au sud, par la mer de Chine méridionale, le Viêt Nam, le Laos, la Birmanie, l’Inde, le Bhoutan et le Népal ; à l’ouest, par le Pakistan, l’Afghanistan et le Tadjikistan ; au nord-ouest, par le Kirghizistan et le Kazakhstan. La Chine possède 2 900 îles, dont Hainan (33 991 km²), la plus importante, située en mer de Chine méridionale. Au sud-est de la Chine, séparée du continent par le détroit de Taïwan, se trouve Taïwan, revendiquée par la Chine comme 23e province du pays.
La République populaire de Chine est la troisième nation du monde par sa superficie (après la Russie et le Canada) et la première par sa population. La superficie totale du pays est d’environ 9 571 300 km². La capitale est Pékin (Beijing), la plus grande ville, Shanghai.
Milieu naturel
Véritable État-continent, la Chine s’étend entre 18° et 54° de latitude nord, et entre 74° et 135° de longitude est. Ce pays immense, en forme de croissant échancré, s’étire sur une longueur maximale de 5 200 km d’est en ouest, et atteint une largeur de 5 500 km du nord au sud. Une telle extension longitudinale et latitudinale explique la grande diversité des milieux naturels. La majeure partie du pays possède un relief montagneux : 84 % du territoire se trouvent à plus de 500 m d’altitude et près de 43 %à plus de 2 000 m. Les plateaux occupent 26 % de la superficie du pays ; les bassins, généralement accidentés et situés dans les régions arides, environ 19 p. 100 ; les plaines ne couvrent que 12 % du territoire.
Le pays présente un étagement des reliefs, l’altitude s’abaissant, par gradins successifs, d’ouest en est, jusqu’à la mer. Les reliefs les plus élevés se trouvent dans la partie occidentale du pays (Tibet, Xinjiang) où sont situées certaines des chaînes de montagnes les plus hautes du monde : le Tian shan oriental et l’Altaï au nord-ouest ; le Pamir et le Karakorum à l’extrême ouest ; les monts Kunlun au centre ; l’Himalaya au sud-ouest. Elles montrent, pour la plupart, une orientation est-ouest. Dans cette zone ont été recensés près de 45 000 glaciers occupant 58 000 km².
L’orogenèse du Tian shan, des monts Kunlun, ainsi que du Qin ling, dans le centre du pays (province du Shaanxi), a commencé durant le paléozoïque, à la fin du carbonifère, et s’est achevée au Permien. L’Himalaya, qui longe le sud du Tibet, est de formation plus récente. Le soulèvement himalayo-alpin a débuté au cours de l’oligocène, pendant l’ère tertiaire, il y a environ 40 millions d’années. Il est dû à la rencontre de la plaque indienne et de la plaque tibétaine.
Au cours du quaternaire, l’activité tectonique s’est manifestée par de violents séismes. La sismicité est toujours très active, surtout le long d’une diagonale nord-est / sud-ouest s’étirant depuis le « Bassin rouge » du Sichuan jusqu’au golfe de Bohai, sur la mer Jaune, et, au-delà, jusqu’au Grand Hinggan (ou Da Hinggan ling), en Mandchourie.
On distingue, d’ouest en est, trois grands paliers topographiques, en fonction de leur altitude moyenne, présentant chacun une grande diversité géomorphologique.
Le
plateau tibétain
Le palier le plus élevé, d’une altitude moyenne de 4 500
m, englobe, au sud-ouest, le haut plateau montagneux et désertique
du Tibet, au sol gelé en profondeur (permafrost), qui s’étend
sur la région autonome du Tibet et sur une partie des provinces
du Qinghai, du Sichuan et du Gansu. Il est bordé par l’Himalaya
au sud, le Pamir et le Karakorum à l’ouest, les monts Kunlun,
les Altun shan et les Qilian shan au nord, et les « Alpes » du
Sichuan au sud-est. Les principaux fleuves d’Asie orientale et méridionale
(Indus, Gange, Brahmapoutre, Mékong, Yang-tseu-kiang, Huang he,
Salouen) y prennent leur source.
Le Pamir, qui marque
la frontière avec le Tadjikistan, culmine en Chine à 7
719 m d’altitude, au sommet du Kongur Tagh. Le Karakorum, qui forme
la frontière avec l’Inde et le Pakistan, culmine au sommet du
K2 (ou mont Godwin Austen), le deuxième plus haut sommet du
monde (8 611 m),sur la frontière sino-pakistanaise.
Les monts Kunlun et les Altun shan marquent la frontière entre
les régions autonomes du Tibet et du Xinjiang. Les monts Kunlun
s’étirent sur 3 000 km de long et se prolongent dans le Qinghai.
Le sommet le plus élevé est l’Ulugh Muztag (7 723 m). Les
Altun shan s’étirent sur 800 km. Culminant à 7 439 m d’altitude,
elles se prolongent à l’est par les Qilian shan (point culminant
: 5 547 m) et les Nan shan. Au nord-est du plateau tibétain se
trouve le bassin fermé de Qaidan, entre les monts Kunlun au sud
et le système montagneux Altun shan-Qilian shan au nord.
L’Himalaya, qui forme la frontière avec l’Inde, le Népal et le Bhoutan, s’étire sur près de 2 400 km de long et 250 km de large. Il comprend, dans sa partie septentrionale, une centaine de montagnes de plus de 7 000 m d’altitude, dont le plus haut sommet du monde, l’Everest (8 850 m) partagé entre le Tibet (faces nord et nord-ouest) et le Népal. Le soulèvement de l’arc himalayen se poursuit de nos jours au rythme de 5 mm par an.
La Chine du Nord-Ouest et la Chine centrale
Les hauts reliefs du Tibet dominent, au nord et à l’est, un second palier, d’une altitude moyenne de 1 500 m environ, correspondant à la Chine du Nord-Ouest et à la Chine centrale.
La Chine du Nord-Ouest
est une région aride, aux paysages souvent désertiques
et à la topographie très compartimentée. Elle
correspond au Xinjiang et à une partie du Qinghai. Elle comprend
une suite de bassins ou dépressions presque entièrement
fermés, enserrés entre de hautes montagnes (Altaï,
Tian shan oriental, Pamir, monts Kunlun, Altun shan) : bassin de Djoungarie
au nord, bassin du Tarim au sud, et bassin de Turfan à l’est.
Le Tian shan oriental, partie chinoise du système montagneux du
Tian shan (environ 2 500 km de long), culmine à 7 439 m d’altitude
au sommet du pic Pobedy, à la frontière avec le Kirghizistan. À l’extrême
nord, l’Altaï chinois culmine à 4 374 m d’altitude.
Le bassin du Tarim, entouré par le Tian shan oriental au nord, le Pamir à l’ouest, et les monts Kunlun au sud, comprend la région du Lob nor (marais salants) et, surtout, l’immense désert de sable du Taklamakan (environ 360 000 km²), désert de type continental, le plus sec de toute l’Asie, dont les dunes peuvent atteindre 100 m de hauteur.
Le bassin semi-désertique de Djoungarie, lieu traditionnel de passage entre la Chine et l’Asie centrale, est enserré par les massifs montagneux de l’Altaï au nord et du Tian shan oriental, au sud, tout comme la dépression de Turfan, plus au sud, située en dessous du niveau de la mer (- 154 m).
À l’est s’étendent
les hauts plateaux de la Chine centrale depuis les marches mongoles
au nord (Mongolie-Intérieure, Shaanxi, Shanxi, Ningxia, Gansu),
jusqu’aux plateaux de la Chine du Sud (Yunnan, Guizhou, Guangxi). Ils
sont limités à l’est par la diagonale montagneuse formée
par les chaînes du Grand Hinggan (au nord-est), des Taihang shan,
des Wu shan et des Xuefeng shan (au sud).
Les plateaux septentrionaux, limités au sud par le Qin ling, correspondent à la
bordure méridionale et orientale du désert de Gobi (plateau
Mongol) et aux hauts plateaux du Shaanxi, du Shanxi, du Ningxia, du Hebei
et du Henan, parmi lesquels le plateau désertique de l’Ordos,
circonscrit dans la boucle du Huang he. Excepté le plateau Mongol
et la partie nord du plateau de l’Ordos, ils sont recouverts d’un fin
limon d’origine éolienne, le lœss. Peu compact, le lœss, épais
de 200 m, est très sensible à l’érosion (ravinement),
la surface des plateaux étant incisée par de nombreux ravins
aux parois verticales.
Débordant sur
le Xinjiang, la Mongolie-Intérieure et le Gansu, le désert
de Gobi est un désert de sable et de pierres de type continental.
Il s’étend sur le plateau Mongol, situé entre 800 et
1 200 m d’altitude. La végétation devient steppique sur
ses marges.
La chaîne du Grand Hinggan, au nord-est, couverte de forêts,
s’étend sur 1 200 km du nord-est au sud-ouest et culmine à 2
091 m d’altitude.
Plus au sud, le Qin ling s’étend d’ouest en est sur près de 1 500 km. D’une altitude moyenne de 2 000 m, il culmine au sommet du Taibai shan (3 767 m). Ce massif marque, avec la moyenne et la basse vallée du Yang-tseu-kiang, la frontière naturelle entre le nord et le sud de la Chine.
Région de collines relativement isolée, vouée à la riziculture intensive, le bassin intramontagneux du Sichuan (« Bassin rouge ») sépare les plateaux lœssiques septentrionaux des plateaux calcaires de la Chine du Sud. Très érodés, ceux-ci se caractérisent par leur relief karstique. Le plateau du Yunnan-Guizhou est bordé à l’ouest par une succession de chaînes montagneuses séparées par des gorges profondes et abruptes (vallées du Salouen et du Mékong). L’est du Guizhou et le Guangxi (région de Guilin notamment) comporte certains des plus beaux paysages du monde (karst à tourelles).
La Chine orientale et insulaire
Les hauts plateaux de la Chine centrale dominent à l’est un ensemble de collines (au sud-est) et de plaines alluviales (au nord-est et à l’est), caractérisé par de larges vallées, d’une altitude moyenne de 500 m.
Au nord-est se trouve la Mandchourie (provinces du Heilongjiang, du Jilin et du Liaoning), ensemble de plaines (350 000 km2) aux sols noirs très fertiles (tchernoziom), bordées par les massifs du Grand Hinggan, à l’ouest, du Petit Hinggan, au nord, et des Changbai shan, au sud-est, et qui se prolongent, au sud, par les collines de la péninsule du Liaodong. La taïga y est le paysage végétal dominant. Mal connue jusque dans les années cinquante, cette région est la plus grande réserve forestière de la Chine. Le Petit Hinggan (ou Xiao Hinggan ling) est un massif peu élevé d’une altitude moyenne de 600 à 800 m. Les Changbai shan, qui forment une partie de la frontière avec la Corée du Nord, constituent un système montagneux dominé par le volcanisme. Ce vaste plateau basaltique (500 km sur 250 km) supporte le volcan le plus élevé de la Chine du Nord-Est, le Paektu shan (2 744 m).
Au sud de la Mandchourie s’étend la Grande Plaine du Nord (provinces de : Hebei, Henan, Shandong, Jiangsu, et Anhui), la plus vaste plaine de Chine, construite par les alluvions du bas Huang he. Cette plaine alluviale, aux sols très fertiles (lœss, limons), est occupée par des cultures intensives. On distingue au nord le bassin du Hai he, au centre la plaine et le vaste delta du bas Huang he, qui se jette dans le golfe de Bohai, et au sud le bassin de la Huai. À l’est s’élèvent les collines de la péninsule du Shandong, à une altitude comprise entre 400 et 1 000 m.
Plus au sud, la plaine centrale, formée par la vallée du bas et du moyen Yang-tseu-kiang (Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Hubei), est une succession de bassins aux sols alluviaux fertiles. Ces basses terres sont drainées par de nombreux cours d’eau naturels et artificiels, et parsemées de lacs, comme dans le Hubei.
Au sud du Yang-tseu-kiang, la Chine du Sud-Est présente un relief accidenté de collines, entaillées par des vallées étroites et encaissées. On distingue plusieurs chaînes montagneuses de faible altitude (Nan ling, Wuhi shan, Donggang shan), d’orientation nord-est / sud-ouest. Parallèles à la côte, elles se caractérisent par un relief de type appalachien.
Au sud des Nan ling, fortement déboisées et érodées, s’étend le bassin du Xi jiang et le large delta du Zhu jiang (la rivière des Perles), faisant face à l’île de Hainan. La côte méridionale, très accidentée, est découpée, jusqu’à la hauteur de Shanghai, par de nombreuses baies et bordée par une multitude d’îles et d’îlots.
|
|
||||||||||
|
|
|
La notion de
plénitude et de perfection, que la philosophie chinoise
associe traditionnellement au chiffre 5, se retrouve dans les
cinq étoiles du drapeau de la République populaire
de Chine, laquelle leur a évidemment attribué une
autre signification, la plus grosse étoile représentant
le parti communiste, proposé comme guide aux quatre classes
sociales du pays : paysans, ouvriers, employés et capitalistes
patriotes.
Le rouge lui-même a également une origine traditionnelle, puisqu'il faisait partie des cinq couleurs des anciens drapeaux chinois, les autres étant le bleu, le blanc, le noir et le jaune. |
||||||||
 |
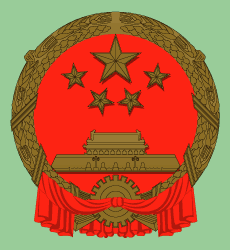 |
|||||||||
 |
La
Marche des volontaires
|
|
||||||||
 |
Rouge
et Jaune
|
|||||||||
 |
 |
C'est l'un
des plus anciens symboles de la Chine, il remonte aux époques
dites mythiques.
D'après certains auteurs, il se confondrait avec le Dragon-Flambeau, emblème de la seconde dynastie, celle des Yin. Il est l'emblème de la foudre, il figurait sur les étendards royaux. Il est l'oiseau consacré aux forgerons et aux solstices ; dans les temps archaïques, il présidait les jours où les forgerons fabriquaient les épées et les miroirs magiques. |
||||||||
 |
 |
Le dragon,
c'est la Chine. C'est la figure symbolique la plus étrange
et la plus répandue, tout en restant la moins connue.
Il n'a jamais été fait symbole national.
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
Les éléments
de cette page proviennent des sites suivants :
|