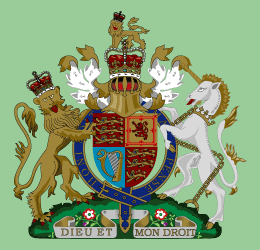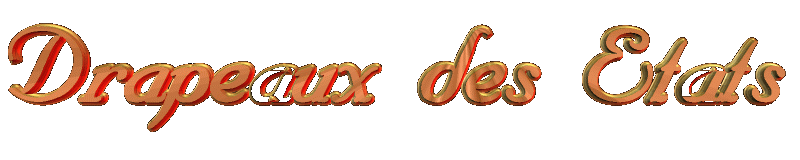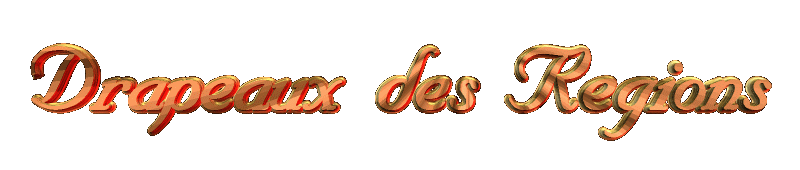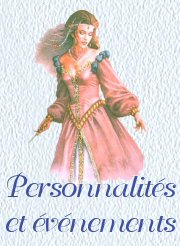Le temps des Celtes et des Romains
Avant l’arrivée des Romains, la Grande-Bretagne n’est pas véritablement
entrée dans l’histoire : il appartient aux archéologues
d’aujourd’hui de compléter les renseignements prodigués par
les conquérants et leurs successeurs. On a clairement établi
que l’Angleterre avait connu une préhistoire très riche,
dont les phases sont en partie liées à la venue de groupes
plus ou moins nombreux d’immigrants du continent. D’audacieuses extrapolations
ont fixé à quelques milliers le nombre des hommes à l’âge
paléolithique, à une vingtaine de mille celui des Britanniques
du Néolithique, à une large « fourchette » de
cinquante à cinq cent mille la population à l’âge du
fer. On a mis en évidence l’existence de peuples de chasseurs et
de nomades il y a quelque quatorze mille ans, reconnu la naissance de l’agriculture
près de quatre mille ans avant notre ère, souligné l’importance
de premiers établissements dans le Sud-Ouest, en Cornouailles et
dans le Wiltshire, étudié les strates successives du site
majeur de Stonehenge , dans ce dernier comté, depuis trois mille
ans avant J.-C. jusqu’à l’arrivée des Romains, et fait apparaître
la diversité des civilisations révélées par
les coutumes funéraires et les objets dans les tombes.
Répartis en tribus au Ier siècle avant notre ère,
dont les Trivonantes au nord de la Tamise et les Brigantes dans les Pennines
et au nord de l’Angleterre, tantôt dispersés entre des fermes,
tantôt réunis en villages, les habitants étaient alors
devenus des agriculteurs de qualité, des artisans capables de tisser
des étoffes de valeur et de fabriquer une poterie bien décorée ;
leurs sociétés étaient ouvertes vers l’extérieur,
comme en témoignent des importations de vin de la Méditerranée.
La toponymie favorise les tentatives d’établissement d’une carte
de la Grande-Bretagne celtique : nombreux sont les noms gaéliques
en Cornouailles ; on citera aussi des rivières et fleuves (Mersey,
Severn, Tamise), des noms de cités comme Leeds. Les Romains, qui,
avec César, en 55 et 54, pénètrent en Grande-Bretagne,
et vont la baptiser Albion, du fait des falaises blanches des côtes
de Douvres, insistent surtout, ainsi Tacite, sur la « barbarie » des
habitants, et sur leur désunion. Strabon, encore trop jeune pour
avoir participé à l’expédition de César, décrit
une île très diversifiée par son relief de plaines,
de montagnes et de collines, par les bois dominants ici, les défrichements
prépondérants dans l’Est, plus plat et plus sec. César
lui-même a insisté sur la qualité de la population
du Kent, où il débarqua, mais aussi sur l’aspect redoutable
des guerriers celtes, armés de longues épées, et combattant
sans armure. Selon lui, au moins douze tribus auraient partagé le
sol anglais, gouvernées par une aristocratie appuyée sur
des druides à la religion sanguinaire. Des femmes auraient participé aux
combats, d’où l’image mythique de Boadicea, qui aurait dirigé une
révolte dans l’Est en 59-60 après J.-C. L’occupation romaine
ne prend véritablement corps qu’au Ier siècle de notre ère,
avec l’expédition de Claude, en 43 : sa victoire sur des peuples
redoutés lui vaut un immense prestige à Rome.
Les siècles de la Grande-Bretagne romaine semblent avoir été ceux
d’une croissance remarquable de la population. Des calculs fondés
sur les capacités de production agricole et des densités
probables ont permis l’hypothèse récente d’une population
de quatre à six millions d’habitants au lieu du million généralement
avancé auparavant : rappelons qu’à la fin du XVIe siècle,
dans l’Angleterre d’Élisabeth, on n’allait pas au-delà de
quatre millions de sujets ! De toute manière, la romanisation
a connu ses limites : du firth de Solway à l’ouest à South
Shields à l’est, on peut aujourd’hui encore reconnaître la
frontière fortifiée édifiée en six années à partir
de 122 par Hadrien et qui constitue un « mur » portant
son nom : long de plus de 100 kilomètres, hérissé de
tourelles d’observation, il fut dépassé, un peu plus au nord,
par le mur d’Antonin, le successeur d’Hadrien ; son intérêt
est de marquer la frontière entre Angleterre et Écosse, mais à l’époque,
menacé constamment par les incursions de Pictes et les rébellions
des Brigantes, il dut rapidement être abandonné.
Partout où Rome est passée, son héritage a été fait
de routes et de villes. Le réseau routier, édifié à partir
de Londres, s’articulait en trois directions stratégiques, vers
York au nord, vers Chester et Carlisle plus au nord-ouest, et vers Gloucester
et le pays de Galles à l’ouest. Les branches principales étaient
reliées entre elles ou prolongées par des voies secondaires.
Sous la protection de troupes qui atteignirent un effectif de soixante
mille soldats, une économie commerciale nouvelle, alimentée
par une circulation monétaire plus abondante, se développe,
entraînant l’Angleterre dans la grande sphère des échanges
du monde méditerranéen. Des villes comme York, Saint Albans,
Carlisle, Cirencester... et Londres plongent leurs racines dans l’époque
romaine. Dans les campagnes, les défrichements nouveaux se sont
accompagnés de l’édification de villas, maisons commandant
un vaste domaine, et dont certaines, comme Fishbourne, près
de Chichester (Sussex), mise au jour en 1960, ont connu le luxe d’un
palais.
Le christianisme s’est répandu dès le IIe siècle,
a eu ses martyrs anglais (le soldat Alban), mais, malgré les efforts
missionnaires, ne semble pas avoir réussi à éliminer
le paganisme. En 410, Honorius, empereur d’Occident, devant les dangers
qui menacent Rome, que les Goths envahissent la même année,
rappelle la garnison romaine et abandonne la Grande-Bretagne à son
sort... en encourageant les indigènes à veiller eux-mêmes à leur
défense : ainsi se trouvent confirmées des craintes
nées déjà d’une incursion de Francs et de Saxons en
367. Tous liens rompus avec Rome au milieu du Ve siècle, des
chefs celtes locaux croient habile de s’entendre avec certains Saxons pour
arrêter les ambitions des Pictes et d’autres Germains. C’est le début
d’une période nouvelle.
Le Moyen Âge britannique
Le temps des invasions
Jusqu’en
1066, la Grande-Bretagne est une proie offerte à la tentation
d’envahisseurs successifs et une entité qui ne découvre que rarement
son unité. Jutes, Angles et Saxons, entre les Ve et VIIe siècles,
ont ruiné l’œuvre romaine, anéanti la première christianisation,
transformé les villes en déserts, refoulé vers l’ouest et
le nord montagneux les restes de civilisation celtique. Cela malgré la
vigueur de résistances locales, dont témoigne la légende
d’Arthur, qui concerne la fin du Ve et le début du VIe siècle. À partir
du début du IXe siècle, les Vikings prennent le relais et,
après des incursions de pillards, occupent des établissements permanents
sur la côte orientale, ici encore en dépit de résistances
héroïques, dont le règne d’Alfred le Grand, entre 871 et 899,
a été le théâtre le plus remarquable. En 1016, un
souverain nordique, Canut, unifie Angleterre, Danemark et Norvège dans
un grand ensemble qui suscite aujourd’hui les nostalgies de certains nationalistes écossais ! À partir
de 1042, la rivalité est permanente entre ducs français
de Normandie et rois scandinaves.
On ne s’étonnera pas que les États aient connu alors une histoire
particulièrement instable et divisée. On ne compte pas moins de
sept royaumes au VIIIe siècle. Certains sont « unificateurs » :
la Mercie du roi Offa dans le Sud-Est à la fin du VIIIe siècle,
le Wessex du roi Ecgbert, à partir de 825, dont hérite Alfred,
et le royaume de Canut, déjà mentionné. Les royaumes sont
en principe électifs, du moins jusqu’au VIIIe siècle ;
ils sont toujours dominés par une aristocratie guerrière, dont
les membres plus notables siègent dans un « conseil des sages »,
ou Witenagemot, mais connaissent aussi, au bénéfice des hommes
libres des villages, une autonomie judiciaire et fiscale remarquable. L’époque
saxonne a vu naître les shires, confiés à des « comtes » et
superposés aux hundreds et aux boroughs, toutes circonscriptions appelées à être
pérennisées. Les souverains ont su conserver le droit au service
militaire et à l’impôt, ils ont promulgué des lois et des
codes qui se sont ajoutés aux coutumes, en particulier à l’époque
alfrédienne. Nombre de découvertes archéologiques témoignent
de la survivance de liens commerciaux avec le continent, et aussi de leur resserrement
grâce aux envahisseurs scandinaves ; à la fin du XIe siècle,
quand le premier souverain normand fait procéder à un véritable
recensement des richesses, le Domesday Book (1086), l’Angleterre est pourtant
surtout rurale, peuplée encore d’un million et demi d’habitants dont 90 %
de campagnards, bien peu de citadins (Londres aurait eu moins de vingt mille
habitants) et aux densités surtout fortes dans le Sud ; la moitié du
pays était rendue ou réservée aux friches, landes et forêts.
Siècles de recul de la culture romaine, la période saxonne est
pourtant celle d’une évangélisation neuve, dont témoignent
les chroniques des moines Bède le Vénérable, à la
fin du VIIe siècle, et, au début du IXe siècle,
Asser, mort en 910 ; elle a été permise par les initiatives
de Rome, mais aussi par l’ardeur des Irlandais saint Colomban et les moines d’Iona ;
elle est triomphante à la fin du VIIIe siècle, où s’organisent
les diocèses et se développent les grands foyers du monachisme
bénédictin, confirmée grâce à l’action d’Alfred
après une crise de paganisation liée aux invasions « danoises ».
La langue saxonne, à côté du latin propagé par les
gens d’Église, atteint à la dignité d’une langue de culture,
dont l’intérêt apparaît dès le début du VIIIe siècle
dans le grand poème anonyme en trois mille vers Beowulf , long récit
héroïque de la vie d’un « chasseur de monstres »,
mais surtout transcription admirable d’une mentalité faite de l’exaltation
des liens du sang, de l’amitié, du courage et du goût du combat.
L’apport de la langue et des cultures scandinaves est moins considérable,
mais d’une importance qu’on ne saurait négliger.
L’Angleterre normande
Vainqueur à Hastings, en
1066, d’un autre prétendant, Harold de
Wessex, lui-même tout juste victorieux de Harold Hardrada
de Norvège,
Guillaume le Conquérant succède au dernier
roi saxon, Édouard
le Confesseur. Il a réussi la dernière invasion
du sol britannique de l’histoire, et son expédition
est immortalisée par la tapisserie
de Bayeux. Les Normands apportent avec eux un système
féodal qui
a atteint, en Normandie plus tôt qu’ailleurs, une
perfection. La nouvelle pyramide du pouvoir, qui court
du vassal au seigneur jusqu’au suzerain suprême,
le roi lui-même, est édifiée au bénéfice
des compagnons du Conquérant, aux dépens
de l’aristocratie indigène
qui s’est révélée rétive. De
là la naissance
d’un « joug normand » qui a nourri
les idéologies,
en particulier lorsque le XVIIe siècle invente la
thèse de l’écrasement
des vieilles « libertés saxonnes » et
de leur lente restauration par l’effort du peuple, des
juristes et du Parlement...
La monarchie évolue, sous les coups de boutoir d’aristocrates contraints
de se liguer pour arracher au souverain des concessions, sous la forme de chartes
de droits et libertés : outre celles de 1100, 1258-1259 et 1266,
il faut évoquer la Grande Charte de 1215, extorquée à Jean
sans Terre, qui énumère les droits et privilèges de certains
corps, le principe du consentement de l’impôt, le droit à l’insurrection ;
sa portée réelle réside dans le mythe qui en dérive
plusieurs siècles après. Le « Conseil du roi » se
développe très progressivement en un Parlement, des administrations
prennent corps, le droit et la législation sont en constante évolution
et, peu à peu, la monarchie féodale se mue en une force plus moderne.
Ce qui a parfois hâté les évolutions, c’est l’ambition continentale
des souverains : aux Normands succèdent, en 1154, les Plantagenêts,
ou « Angevins », qui, avec Henri II , vers 1180, contrôlent
la Normandie, l’Anjou, le Maine, la Touraine, l’Aquitaine, une moitié de
la France associée à l’Angleterre dans un impressionnant « Channel
State » ; effondrements, reconquêtes aboutissent, au temps
de la guerre de Cent Ans, qui commence en 1337, à la revendication de
toute la France. Les grandes familles s’épuisent à suivre le souverain,
mais savent aussi monnayer leur appui. Les rois, dans leur besoin permanent de
ressources considérables, se tournent vers conseils et parlements, font
des concessions, sont parfois victimes de leurs excès.
Des conspirations, des révoltes, des changements dynastiques ont marqué les
siècles, alimentant plus tard le génie de Shakespeare de l’exemple
de Richard II, détrôné par Henri Bolingbroke de Lancastre
en 1399, de celui de Richard III, vaincu en 1485 par Henri Tudor, après
avoir lui-même mis à mort les « enfants d’Édouard »,
son prédécesseur, qui avait usurpé en 1470 le trône
de Henri VI : la « guerre des Roses » (rose rouge
des Lancastre contre la blanche des York), de 1455 à 1485, a marqué de
son empreinte sanglante des querelles dynastiques exacerbées par les défaites
en France devant Charles VII et Louis XI.
L’Église a tenu une place irremplaçable tout au long de ces siècles.
Soumise au pape, elle est à l’écoute aussi de tous les courants
spirituels du continent ; Cisterciens au XIIe siècle, Franciscains
et Dominicains ensuite s’y rattachent. Archevêques et évêques
sont en même temps des politiques écoutés. De redoutables
querelles les opposent pourtant à l’autorité royale : elles
coûtent la vie à l’archevêque Becket, sous Henri II,
en 1170 ; elles valent à Jean sans Terre interdit et excommunication
avant que le souverain reconnaisse sa défaite et se proclame le vassal
du pape – l’une des origines de l’« anglicanisme » au sens
nationaliste du terme. Autour des deux archidiocèses d’York et de Canterbury,
l’apaisement se fait et, pendant que les monastères, défricheurs
au nord, prospèrent, les deux clergés régulier et séculier
prennent leur part à la renaissance intellectuelle, font construire de
splendides édifices, supervisent les deux universités d’Oxford
et de Cambridge, nées au début du XIIIe siècle. L’élite
aristocratique est encore surtout attentive aux chansons de geste et aux romans
courtois ; le grand public est conquis vers 1200 par la révélation
de la légende du roi Arthur, avant qu’au XIVe siècle Chaucer
fasse naître la littérature nationale en langue anglaise ;
la pensée philosophique de Duns Scot et de Guillaume d’Occam au XIVe siècle,
les audaces théologiques de John Wyclif, qui, dans les années 1370-1380,
fait naître le mouvement des lollards sur un fond d’antipapisme, de rejet
de la tradition et de précoce affirmation du droit des
princes et du libre-arbitre des individus, font de la Grande-Bretagne
un foyer
majeur
de
l’esprit.
Aucun développement intellectuel de cette ampleur n’aurait été concevable
sans l’accroissement de la population et des richesses. On serait
passé de
trois à quatre millions d’habitants au début du XIVe
siècle,
et cette relative accumulation d’hommes a permis les défrichements,
favorisé la
hausse des productions dans le cadre des « manoirs » ou
seigneuries, contribué à la reprise de la vie urbaine à partir
du XIIe siècle : ports comme Newcastle, Hull, Bristol,
villes-marchés
comme Canterbury, Leeds, Salisbury, Londres (qui atteint près
de 35 000 habitants
en 1377 contre moins de 10 000 à 11 000 pour les autres).
Les industries de la mine, de la laine, le commerce avec la Scandinavie
et la France surtout
et parfois par l’intermédiaire de marchands hanséates,
italiens, flamands, et jusqu’à l’expulsion de 1290 (précédée
d’horribles massacres à Londres, Norwich, Lincoln) grâce à la
finance des juifs, ont fait naître les bourgeoisies et créé de
nouvelles différenciations sociales. La grande coupure,
après une
longue croissance, est liée aux pestes du XIVe siècle,
peste noire en 1348-1349, « mortalité des enfants » en
1369 :
elles tuent au moins un habitant sur cinq et entraînent par
ailleurs un déficit démographique durable qui réduit
la population d’un tiers à une moitié dans les dernières
décennies du
siècle. Une désertion d’un millier de villages s’ensuit,
les friches reconquièrent une partie du sol, quand, ailleurs,
le mouton ne vient pas remplacer les cultures. La pénurie
de main-d’œuvre a une contrepartie positive pour les humbles :
la fin du servage, l’allotissement de terres à des
tenanciers auxquels des droits précis sont garantis, la
crise de l’institution seigneuriale. Mais le désespoir et
la faim poussent aussi à des
révoltes, dont la jacquerie de 1381 dans l’Essex et le Kent,
connue sous le nom de « révolte des artisans
et paysans », conduite
par le prêtre John Ball et l’ouvrier Wat Tyler,
et animée
par une doctrine égalitaire :
Quand Adam bêchait et qu’Ève filait
Qui, alors, était un noble ?
La vie commerciale comme la vie industrielle sont évidemment touchées
par la crise des exportations vers un continent également décimé.
Les redressements sont progressifs, accompagnés par un transfert partiel
des productions textiles vers les campagnes, moins soumises à l’activisme
des corporations, et placées sous la coupe de marchands-fabricants venus
d’York, de Bristol, de Londres, de Leeds. Le commerce de la laine renaît
avec le développement de l’« étape » obligatoire
de Calais ; les marchands anglais recherchent des débouchés
nouveaux, à l’instar des Marchands aventuriers, qui se portent vers la
mer du Nord et la Méditerranée ; un nationalisme économique
joue contre les Hanséates qui, en 1447, sont une première fois
les victimes de la xénophobie de Londres.
C’est au milieu de ces mutations sociales que se
développent des crises :
de la foi, avec la lutte nécessaire des souverains du XVe siècle
contre l’hérésie lollarde et aussi pour la rénovation d’une Église
parfois indigne ; des mentalités, avec le souci poignant d’une mort
toujours proche ; de l’ordre politique : l’affrontement des maisons
de Lancastre et d’York, rose rouge contre rose blanche, « éruption
cutanée sur la surface de la vie anglaise », traduit aussi
une redoutable crise de confiance dans des souverains qui ont perdu le royaume
de France et entraîne, par l’effet des morts, des exécutions, des
dépossessions, un profond renouvellement de l’aristocratie et son affaiblissement
en tant que corps. Aucune coupure visible ne sépare ce qu’on est convenu
d’appeler le moyen âge des Temps modernes. Dans la mémoire collective,
le premier lègue, positivement, le souvenir de communautés villageoises
cohérentes sous la tutelle parfois paternaliste de seigneurs, des cathédrales
gothiques et de la foi la plus profonde, d’une institution monarchique nationale,
certes autoritaire, mais associée à un Parlement plus ou moins
périodiquement réuni et respectueuse des lois et coutumes, d’une
nation qui a su amalgamer les apports extérieurs au fonds saxon et se
doter de la langue originale qui exprime son génie.
Ce bilan idyllique nourrira les nostalgies romantiques.
L’Écosse voisine, peuplée sans doute de moins d’un million d’habitants
au sortir de l’âge féodal, a su préserver son indépendance
grâce à la vigueur de David Ier en 1124-1153 et, surtout, à la
résistance que Robert Bruce, vainqueur en 1314 à la bataille de
Bannockburn, sut opposer aux ambitions d’Édouard Ier. Plus chanceuse
que le pays de Galles, annexé à l’Angleterre en 1284, que l’Irlande,
dont la côte orientale a été acquise par Henri Ier dès
1171-1172, l’Écosse, refuge de la civilisation celte, connaît son
destin spécifique, la gloire d’universités et d’écoles de
grande valeur, une législation et des coutumes conformes à son
génie : elle n’hésite pas à l’occasion à s’allier à la
France pour se protéger des avidités
anglaises.
Les débuts des Temps modernes
Les Tudors, qui règnent sur l’Angleterre de 1485 à 1603, ont justement donné leur nom dynastique au début des Temps modernes, que, souverains exceptionnels, ils ont marqués de leur personnalité en même temps qu’ils en ont opportunément incarné les aspirations.
La prospérité
Leur chance a été de régner dans une époque exceptionnellement
favorisée par une série de facteurs positifs. Après les
pestes, et avec la menace chronique de l’épidémie, la population
se relève progressivement, et l’Angleterre passe de moins de trois millions à plus
de quatre millions d’habitants au cours du XVIe siècle. À l’inflation
toute relative des hommes s’ajoute, surtout après 1540, celle des espèces
monétaires que le commerce mais aussi la guerre de course font passer
d’Espagne et du Portugal vers les îles Britanniques : elle favorise
les échanges, stimule la production et, promettant plus de profits, encourage
tous les producteurs au moment même où ils peuvent compter sur plus
de bras. Les conditions climatiques générales s’améliorent
aussi, écartant, jusqu’à la mauvaise décennie de 1590, la
peur de la véritable famine. La demande extérieure en produits
métalliques et en laine semi-travaillée ou en lainages de qualité s’additionne à la
poussée de consommation interne, par ailleurs liée, comme partout
en Europe, aux nouveaux goûts de luxe de l’élite sociale. Les désordres
civils n’ont jamais atteint les proportions des guerres religieuses dans l’Empire
germanique ou en France, aucune invasion étrangère n’a été possible.
Des phénomènes d’ordre spirituel ont peut-être contribué à la
prospérité : on est parfois tenté de lier éthique
protestante et esprit capitaliste, individualisme religieux et capacité d’initiative
dans le domaine économique, exaltation de la valeur travail, réhabilitation
du profit et levée des interdits sur les taux excessifs d’intérêt ;
qu’on suive ce type de raisonnement ou qu’on lie au contraire le succès
des idées de réforme à un changement préalable de
la société, le fait demeure qu’une bourgeoisie de marchands, de
fabricants, d’armateurs, d’hommes de loi, à laquelle correspondent, dans
les campagnes, la gentry et le groupe des petits propriétaires,
les yeomen, a su saisir les occasions et
participer aux mutations.
Les souverains ont apporté leur contribution à l’essor économique.
Ils ont pratiqué un mercantilisme intelligent. Henri VII fait voter
les premiers Actes de navigation en faveur des navires marchands anglais, pousse
au commerce avec la Méditerranée, recourt aux frères Cabot
pour reconnaître des routes transocéaniques et leur permet d’explorer
la Nouvelle-Écosse et la baie d’Hudson. Ses successeurs suivent son exemple,
encouragent l’exploration maritime et, au temps d’Élisabeth, Hawkins,
Drake, Frobisher, Raleigh abordent les côtes d’Afrique et des deux Amériques ;
des chartes sont octroyées à des compagnies de commerce et de colonisation,
celles de Moscovie (1553), de la Baltique (1579), du Levant (1581) et, après
bien d’autres, des Indes orientales en 1600. Cette expansion maritime a supposé le
rejet de toutes les prétentions monopolistiques d’autres États,
un soutien sans faiblesse aux entreprises les plus audacieuses sans que le risque
de guerre soit écarté. Dans le domaine industriel, on vit l’âge
d’une réglementation, ainsi de l’apprentissage et de la maîtrise
par le Statut des apprentis et artisans de 1563, mais aussi le recours au monopole
offert aux inventeurs ou à des immigrants du continent pour encourager
les implantations neuves. Destinée à aider les producteurs, la
politique économique des Tudors n’exclut pas un effort méritoire
pour limiter les clôtures, chères aux éleveurs de moutons,
et, en particulier sous Élisabeth, à la fin du XVIe siècle,
inclut les premières lois des pauvres qui aboutissent au grand texte de
1601 d’assistance publique généralisée. Et, au bénéfice
de tous, ils font un effort intermittent d’abord, systématique à partir
de 1560, pour faire triompher une « bonne monnaie », instrument
d’échanges accrus et de contrats sûrs. Du coup, l’essor économique
contribue à la popularité de la dynastie. Certains historiens s’extasient
devant ce qu’ils veulent considérer comme une véritable révolution
industrielle au temps d’Élisabeth, avec le grand essor des mines de charbon,
d’étain, de plomb, la poussée des hauts-fourneaux, la production
textile croissante. Sans les suivre dans leurs expressions, on est frappé par
le flux remarquable de richesses, le développement concomitant des villes,
Londres atteignant deux cent mille habitants à la fin du règne
d’Élisabeth, quelques centres comme Bristol ou Norwich croissant jusqu’à vingt
ou trente mille habitants. L’impôt ne tue pas la prospérité.
En partie parce que la réforme religieuse, dès ses premiers temps,
a connu la confiscation des biens des monastères (1536 et 1539) avant
celle, plus tardive, de biens de chanteries et fabriques, et que, par la vente
d’une grande partie des terres, par la distribution gratuite d’autres biens,
la monarchie a couvert nombre de ses besoins sans avoir recours exagérément à la
fiscalité. Une immense mutation foncière a ainsi servi les intérêts
de l’État.
Siècle de l’ouverture vers le grand large, l’âge des Tudors est
donc évidemment celui de la grande révolution
religieuse.
L’âge des réformes
Rien
n’annonce l’âge des réformes sous Henri VII ou dans les
premières décennies du règne de Henri VIII , monté sur
le trône en 1509. Au contraire, ces souverains ont lutté contre
les héritiers des lollards et contre les thèses luthériennes,
au moment où elles se sont propagées en provenance du continent :
Henri VIII les a personnellement réfutées dans un écrit
qui lui vaut en 1521, du pape Léon X, le titre de « défenseur
de la foi » toujours présent dans la titulature royale depuis
lors. Humanistes étrangers, comme Érasme, ou anglais, comme John Colet
et surtout Thomas More, auteur de l’Utopie, en 1516, dénoncent des
imperfections et des abus, mais espèrent une réforme au sein de
l’Église romaine ; on reproche davantage à l’Église
son mode de vie, les abus de ses princes, que les insuffisances de sa théologie.
Tout bascule en fait avec l’affaire du divorce : Henri VIII veut se
séparer de Catherine d’Aragon , non pas seulement par lubricité,
mais surtout parce qu’elle ne lui a pas donné de fils et ne peut plus
en espérer ; il souhaite se remarier avec Anne Boleyn. Le refus
de Clément VII s’explique par sa peur de représailles de Charles Quint,
neveu de Catherine, dont les troupes ont déjà pillé Rome
en 1527 : le pape n’accepte pas le prétexte canoniquement acceptable
du mariage de Henri VIII avec la veuve de son frère Arthur (en 1509 !).
Une guerre de théologiens et de juristes débouche sur une stratégie
d’intimidation, qui devant l’obstination pontificale se transforme en une série
de gestes définitifs. En 1531-1532, le roi s’impose à la tête
de l’Église d’Angleterre et obtient la « soumission du clergé » ;
le 23 mai 1533 le divorce du roi est prononcé en Angleterre, ce qui
aboutit en juillet à l’excommunication de Henri, et, en 1534, l’Acte de
suprématie fait du souverain le chef de l’Église. Peu osent résister, à la
notable exception de l’ancien chancelier Thomas More et de l’évêque
John Fisher, exécutés en 1535 et ultérieurement béatifiés
par Rome.
De 1534 à 1547, la « réforme henricienne » s’en
prend essentiellement aux monastères, qui sont peu à peu supprimés
et dont les biens sont confisqués ; elle tente de restaurer la discipline
dans l’Église, mais, menée par Thomas Cromwell et l’archevêque
Thomas Cranmer, ne déborde guère
sur le terrain de la foi, qui
reste largement romaine.
Entre 1547 et 1553, la « réforme édouardienne » (du
nom d’Édouard VI, roi à neuf ans , en fait subordonné à ses
oncles régents successifs) radicalise dans un sens protestant et calviniste
les mutations amorcées ; Cranmer, instrument docile, est l’auteur
d’un premier Rituel ou Livre de la prière commune, imposé en 1549
par l’Acte d’uniformité, puis, en 1552, de Quarante-Deux Articles de foi,
ou credo, qui sont résolument réformés. Les prêtres
sont invités à se
marier, on ne conserve que
deux des sept sacrements,
le
culte
des images
et des saints est interdit.
Le règne de Marie Ire (dite la Sanglante) constitue un intermède
du fait de sa brièveté : 1553-1558. Dès 1554, la reine
a ramené son royaume au catholicisme et, épouse de Philippe II
d’Espagne, fait exécuter quelque trois cents « hérétiques »,
dont Cranmer : ces « martyrs » protestants sont immortalisés
dans une œuvre majeure de la littérature protestante anglaise, Le Livre
des martyrs de John Foxe (1560), qui devient un instrument capital de la
polémique antipapiste.
La réforme élisabéthaine est opérée à partir
de 1559, lorsque la nouvelle reine, fille d’Anne Boleyn, « bâtarde » aux
yeux des catholiques, obtient du Parlement le vote d’un Acte de suprématie
qui lui confère le titre, toujours en vigueur, de « suprême
gouverneur de l’Église d’Angleterre » ; au schisme correspond
la formation d’un nouvel épiscopat, dont la création, sous la houlette
de Matthew Parker, promu archevêque de Canterbury, fonde le refus contemporain
de la papauté de reconnaître la validité des ordinations
anglicanes en cas de réunification des deux Églises. En 1563, un
credo, les Trente-Neuf Articles, définit la foi anglicane, plus que marquée
par le calvinisme. Mais la hiérarchie épiscopale est préservée,
par souci de conserver une école de discipline sociale et politique, en
vertu de l’adage « plus d’évêques, plus de roi ».
De même, la pompe des cérémonies demeure. La réforme
correspond au choix d’une voie moyenne, à un compromis par ailleurs décevant
aux yeux des plus farouches réformateurs. Ceux-ci ont sous les yeux l’exemple
de l’Écosse, où John Knox mène, à partir de
1560, une réforme presbytérienne déniant aux évêques
tout pouvoir spécifique et confiant à des synodes hiérarchisés
le gouvernement de l’Église. Dès lors, la reine est contrainte
d’imposer ses choix en se battant sur deux fronts : contre les « papistes »,
soupçonnés de préparer complots et conspirations avec l’aide
de l’Espagne et de se comporter comme les soldats de l’« évêque
de Rome » ; contre les puritains ou « presbytériens »,
sensibles aux écrits et paroles de Thomas Cartwright, admirateur de l’Écosse,
ou, dans les années 1580, de Robert Browne, dont les convictions
vont jusqu’à prôner la séparation de l’Église et de
l’État et l’autonomie des congrégations (d’où le nom ultérieur
de « congrégationalisme »). La répression
est souvent sévère, menée énergiquement sous l’égide
de théologiens et d’évêques à poigne, comme Whitgift,
archevêque de Canterbury de 1583 à 1604, et grâce à la
juridiction de la Cour de haute commission, chargée de poursuivre et de
condamner les mauvais pasteurs. On se refuse (articles de Lambeth, 1595) à toute « diversité dans
l’unité ». Quoi qu’il en soit, l’époque d’Élisabeth
demeure celle de la naissance réelle du bastion protestant de l’Europe ;
celle aussi où le peuple anglais, « nouvel Israël »,
prétend être un modèle et un guide : prétention
servie par l’offre à tous, simples fidèles ou prêtres, de
lire directement, s’ils le peuvent, la Bible traduite en anglais, dont la version
de base est, en 1568, la Bible des évêques (relayée en 1611
par l’admirable « version autorisée », ou Bible
de Jacques Ier).
Ces évolutions capitales n’ont pas provoqué de guerre de religion
dévastatrice. En 1536, le « pèlerinage de la grâce » a
constitué la révolte, vite avortée, de comtés du
Nord contre la suppression des premiers monastères. En 1569, une révolte
aristocratique, en partie déterminée par les partisans de Marie
Stuart, revêt le caractère d’une guerre féodale menée
par quelques grandes familles du Nord et aisément gagnée par les
forces royales. La profondeur du sentiment antiespagnol, le patriotisme qui s’incarne
en Élisabeth et culmine en 1588 avec l’affaire de l’Invincible Armada
contribuent à réunir la grande majorité des sujets autour
du trône.
Le système de gouvernement
Ce trône est apparu singulièrement consolidé par une succession
de grandes transformations politico-administratives que d’aucuns n’hésitent
pas à qualifier de révolutionnaires. On a eu tendance, dans les
années 1980, à mettre davantage l’accent sur la continuité des
changements et leur complémentarité, et on a nié qu’une
période quelconque, en particulier le règne d’Élisabeth
, ait connu une rupture décisive avec les orientations antérieures.
Le grand paradoxe de l’époque réside dans la consolidation considérable
de la monarchie en même temps que dans la sauvegarde décisive de
l’institution parlementaire, dans un respect affirmé de larges pouvoirs
des notables locaux. Équilibre miraculeux qui, à lui seul, justifie
l’admiration de la postérité... d’autant plus qu’il survient après
les désordres du XVe siècle et avant l’âge des révolutions !
La dynastie a paru
parfois fragile.
Des lois ont
dû fixer l’ordre de succession
sous Henri VIII entre Marie, fille de Catherine d’Aragon, Élisabeth,
fille d’Anne Boleyn, et Édouard, fils de Jane Seymour. Les droits
d’Élisabeth lui ont été contestés par Philippe II
d’Espagne et Marie Stuart d’Écosse. Le refus de la « reine
vierge » de prendre époux a inquiété plusieurs
Parlements et conduit à faire de Jacques VI d’Écosse l’héritier
légitime du trône d’Angleterre. Les souverains sont de droit divin.
Henri VIII a été le premier, en 1525, à faire inscrire
son « numéro d’ordre » dans la titulature royale,
de même qu’il est le créateur, en 1541, du titre de « roi
d’Irlande » (au lieu de « seigneur »). Souverains
sacrés, engagés par leur serment à gouverner en bons chrétiens,
dotés de pouvoirs thaumaturgiques par leur sacre même, ils ne connaissent
de limites théoriques à leur bon vouloir que la tradition, les
coutumes et les lois qu’ils entendent respecter. Ils gouvernent en conseil. Henri VII
et le jeune Henri VIII ont recours à un Grand Conseil nombreux, formé de
notables et de magnats, d’où on a détaché, en 1487, une
section judiciaire, la Chambre étoilée. Thomas Cromwell systématise
le recours à un « Conseil privé » de dix-neuf membres,
en 1536, et dont il est le secrétaire principal. Remise en question sous Édouard
et Marie, qui accroissent le nombre de conseillers aux dépens de l’efficacité du
système, la réforme est à nouveau en honneur sous Élisabeth,
qui restreint le nombre de conseillers à une douzaine (n’en recrutant
que cinquante-huit au cours de son long règne) et dote l’organisme des
moyens administratifs qui en font un instrument majeur de gouvernement. D’autre
part, toujours au niveau central, on voit décliner les offices de chancelier
et de lord du Sceau privé, mais se développer les fonctions de
secrétaire d’État : de 1533 à 1540, Cromwell a joué un
rôle essentiel ; William Cecil, en 1550-1553 et 1558-1572, a été des
plus puissants avant de céder la charge, mais non pas l’influence, à sir
Francis Walsingham, qui la conserve de 1573 à 1590 en étroite
coopération avec son prédécesseur, devenu lord Burghley
– le secrétaire principal, parfois assisté d’un deuxième
secrétaire, devient le véritable pivot de l’exécutif, chargé des
rapports avec le Conseil et le Parlement et de l’ordre intérieur, ainsi
que de la direction des services diplomatiques. La centralisation extrême
s’avérant difficile, Henri VIII rend vie à une institution
qui avait connu une existence à éclipses depuis 1484 : un
Conseil du Nord, devenu permanent en 1537, dont le siège est bientôt à York,
et dont la tâche est de représenter l’autorité royale et
de garantir administration et justice ; dans le pays de Galles, complètement
réuni à l’Angleterre par l’Acte d’union de 1536, un Conseil des
Marches remplit les mêmes
fonctions.
Tous les conseils
et tous les organes
de
l’exécutif sont superposés à une
administration locale plus efficace : elle repose essentiellement sur des
commissaires, dont la fonction est apparue au XIVe siècle, et qui portent
le titre de juge de paix. Ils sont des notables locaux, servant pour l’honneur ;
leur nombre peut varier, généralement quelques dizaines par comté,
et, collégialement ou individuellement, ils exercent de grands pouvoirs
de gestion et de justice. Au temps d’Élisabeth, on leur confie le devoir
d’appliquer les réglementations économiques et sociales et, très
particulièrement, de s’occuper de veiller à la charité publique.
Dans les comtés, à partir d’Édouard VI, les pouvoirs
militaires, dont la réunion et le commandement de la milice, sont confiés à des
lords-lieutenants, eux aussi recrutés localement. Des shérifs sont
responsables de la police, des prisons, mais aussi de la tenue des élections
sur ordre (writ) du
souverain.
Les principaux tribunaux
siégeant à Londres, des cours aux pouvoirs
de justice gagnés progressivement, Chambre étoilée et Haute
Commission, permettent par ailleurs, en vertu du droit régalien d’évocation,
de juger plus rapidement les rebelles ou, dans le second cas, les réfractaires à l’ordre
religieux. Leur trésor alimenté par des taxes douanières
qu’une loi de 1534 leur permet de faire varier à leur gré, par
les « dons » des convocations ecclésiastiques, le
revenu des monopoles, les emprunts forcés et les impôts directs
votés en Parlement, leurs ressources domaniales accrues par le produit
des confiscations aux dépens des monastères et de sujets rebelles,
les Tudors disposèrent
des moyens d’un pouvoir
de plus en
plus absolu.
Pourtant, le Parlement
survit. Il le doit,
après de longues années
où il paraissait condamné, à la volonté de Henri VIII
de faire ratifier ses résolutions religieuses et confirmer l’ordre successoral, à la
sécurité relative que procure, aux souverains, le patronage d’un
nombre grandissant de sièges de bourgs (mais cela vaut aussi pour des
familles puissantes de l’aristocratie), à celle, plus réelle, que
fournissent les diverses pressions possibles : dissolution, nomination du
speaker (président) des Communes, contrôle de l’ordre du jour, emprisonnement
de députés trop audacieux. Les souverains sont représentés
dans les deux Chambres par des conseillers qui défendent leur politique.
Il n’existe pas de parti organisé, les recherches les plus récentes
ayant démontré l’inanité de la thèse « classique » de
l’historien J. Neale selon laquelle un parti puritain aurait siégé dans
les Communes d’Élisabeth. Le patriotisme a joué en faveur de l’autorité royale,
par ailleurs mieux acceptée parce qu’exercée au bénéfice
des intérêts du grand nombre. De toute manière, le Parlement
n’est que rarement réuni ; la durée des sessions sous Élisabeth
se limite à trois ans et demi pour quarante-cinq années de règne !
Objet d’une véritable adulation, encensée par les poètes,
dont Shakespeare n’est que le plus notable, représentée par les
peintres sous des traits que l’âge cesse de modifier à la fin de
son règne, Élisabeth a incarné à la perfection la
réussite des Tudors en matière de relations publiques. Leur ère,
si brillante dans les lettres et les arts, connaît, à partir de
1560, les débuts d’une véritable « révolution
culturelle » avec la multiplication des écoles, des collèges
universitaires, des facultés de droit de Londres (Inns of Court), la diffusion
généralisée de la lecture au moins ; elle correspond à une
Renaissance que rien ne conduisit sur les chemins du pessimisme et de la morosité comme
dans la France voisine.
Le siècle des révolutions
L’ère des Stuarts est celle du « siècle des révolutions ». Dans un XVIIe siècle généralement assombri en Europe, l’Angleterre n’a pas connu les misères de l’Empire germanique, ni le destin en dents de scie de la France. On termine au contraire sur un apogée. Mais les Anglais acquièrent alors la réputation du peuple le plus remuant et le plus sanguinaire du Vieux Continent.
Jacques Ier et Charles Ier
Les deux
premiers
Stuarts,
Jacques Ier, de 1603 à 1625, Charles Ier,
son fils et successeur, qui périt sur l’échafaud en 1649, ont uni,
en leur personne, les trois royaumes d’Irlande, d’Écosse et d’Angleterre.
Ils ont été des souverains désireux d’absolutisme et persuadés
qu’ils devaient, paternellement, guider leurs sujets dans la politique comme
dans l’accomplissement de leurs devoirs religieux. Ils ont échoué à collaborer
avec des Parlements dont la docilité est devenue de plus en plus incertaine,
au point de persuader Charles Ier de ne plus en convoquer entre 1629 et
1640 (la « tyrannie de onze ans »). Lors des sessions, à l’affirmation
hautaine de la prérogative royale (comme en 1610), les parlementaires
répondent par une mauvaise volonté évidente à voter
des impôts, allant en 1625 jusqu’à dénier à Charles Ier
la possibilité de lever librement des droits de douanes sa vie durant,
et par l’affirmation de droits : ainsi en 1628, la pétition du Droit,
en six articles dus surtout à la plume de John Pym, revendique l’habeas
corpus et, pour les députés et lords, le privilège d’autoriser
levée et logement des gens de guerre et de voter les taxes fiscales. Depuis
1616, due au juriste Edward Coke, la théorie du « joug
normand » fait des libertés une reconquête de droits
saxons qu’aucun souverain ne devrait altérer et que devraient protéger
tribunaux et Parlement. Impliquée dans ce conflit d’autorité, qui
a ses prolongements dans l’administration locale, toute une élite sociale,
de la gentry et de la bourgeoisie, se retrouve souvent contre le roi, dont la
politique économique et sociale est loin de gagner l’approbation des propriétaires
(paternalisme contre les enclosures, faiblesse des ambitions coloniales, distribution-vente
de monopoles, de titres, d’offices sans justification). Certains conflits sont
hautement symboliques : ainsi la résistance à l’impôt
illégal quand, en 1635, le ship-money, taxe destinée à équiper
la flotte de guerre, est étendu arbitrairement de quelques ports et régions
maritimes à tout le royaume ; John Hampden, ancien député,
gentleman, se laisse traîner en justice en 1637 plutôt
que de
payer.
L’évolution religieuse ne favorise pas non plus les souverains. Ceux-ci
ont refusé l’un et l’autre de soutenir les puritains : Jacques Ier
a repoussé en 1603 la « pétition des mille » (pasteurs),
il persécute les sectes « dissidentes », dont le
nombre s’accroît de baptistes, d’indépendants, et dont les plus
menacées ont le choix entre l’exil en Hollande ou l’émigration
vers l’Amérique, à l’instar des voyageurs du Mayflower en 1620 ;
Charles Ier suit l’exemple de son père et, dans les années
1630, conseillé par l’archevêque Laud, multiplie les poursuites,
faisant traduire les dissidents pour rébellion devant la Chambre étoilée,
suscitant à leur encontre des peines d’emprisonnement, mais aussi d’exposition
au pilori et d’essorillement. L’affirmation de plus en plus obstinée de
l’autorité spirituelle des évêques conduit même à vouloir étendre
le système anglican à l’Écosse, qui y trouve le prétexte
d’une révolte en 1638. Dans les villes et ports, sensibles aux idées
venues de Hollande, dans une gentry parfois recrutée dans le monde du
commerce ou soucieuse de son avenir économique et d’un bon contrôle
des sociétés villageoises, les idées séparatistes,
le droit à l’autonomie des congrégations ont cheminé ;
les écrits puritains qui insistent sur la sainteté des individus
touchés par la grâce et sauvés par leur foi renforcent l’esprit
de résistance. Le catholicisme romain est laminé, réduit à ne
représenter que de 2 à 5 p. 100 de la population vers
1630 ; il n’en continue pas moins de faire peur, d’autant que des conspirations
occasionnelles confirment la menace : ainsi la conspiration des Poudres
de 1605, où, sous la conduite de Guy Fawkes, des catholiques voulaient
faire sauter Westminster, Parlement et roi mêlés ; condamnés à toutes
sortes de discriminations, les catholiques sont des boucs émissaires permanents :
Charles Ier, époux de la catholique Henriette-Marie de France, a
rétabli en 1635 les relations diplomatiques avec Rome, son conseiller
Laud favorise dans l’Église anglicane un courant laxiste arminien et le
retour à des rites romains. D’où des craintes et suspicions qui
rassemblent contre le trône nombre de protestants de tous bords, encore
irrités par ailleurs par les excessives pressions financières du
clergé (dîmes
et rentes).
Le marasme économique s’est progressivement installé à partir
des années 1610, lié à un climat plus rigoureux, à la
perte de marchés, à la concurrence de producteurs d’étoffes étrangers,
silésiens notamment, lorsque éclate, sur le continent, la guerre
de Trente Ans (1618). Aux rois on reproche de freiner l’individualisme dans les
campagnes, de multiplier des monopoles stérilisants, de ne pas pousser
activement la lutte sur mer contre les pirates, de ne mener que des actions sporadiques
contre les Espagnols alors que les Hollandais se lancent hardiment dans l’aventure
coloniale, de prélever trop de taxes et de susciter des embarras aux commerçants
par leurs emprunts forcés
sur les
villes.
La politique
extérieure ne permet pas à Jacques ni à Charles
de redorer leur blason. Parcimonieux, soucieux de ne pas trop demander à des
Parlements, ils sont souvent pacifiques. Leur guerre contre l’Espagne, après
1625, tourne court, l’expédition
de La Rochelle
au secours
des huguenots,
sous
la direction
du
favori
Buckingham,
se termine
par un
fiasco,
l’Angleterre
est sur
la marge
de
l’histoire
qui se
fait en
Europe.
Les souverains
ont de
moins en
moins
pu compter
sur les
forces
vives de
leur nation,
quand
s’affaiblissait
le pouvoir
militaire
de grands
aristocrates :
ceux-ci préservent ou reconstituent leur fortune au détriment de
leurs anciennes ambitions féodales, mais aussi des forces armées
de nature à aider le roi. Le mécontentement n’est pas général
vers 1640, mais il est largement répandu dans les groupes de la bourgeoisie
et de la gentry, vigoureux là où les mutations socio-économiques
suscitent le plus d’anxiété et déstabilisent les vieilles
communautés.
La Grande Rébellion (1640-1660)
Sortant
de
ces
tensions,
la
Grande
Rébellion naît immédiatement
de la nécessité pour Charles Ier de répondre à la
révolte de l’Écosse par l’appel à un Parlement censé lui
voter les subsides nécessaires. En 1640, le « Court Parlement »,
réuni le 13 avril, est dissous dès le 5 mai ; le
3 novembre, on est obligé de réunir un nouveau Parlement auquel
sa longévité fait donner par l’histoire le surnom de « Long ».
Au fil des années, le conflit s’étoffe d’idéologies et de
mouvements inédits. Jusqu’en janvier 1642, l’affrontement est pacifique.
Le Parlement obtient l’exécution de Strafford, l’arrestation de Laud,
deux des principaux conseillers du roi, la suppression de la Chambre étoilée
et de la Haute Commission, des conseils régionaux, du ship-money. Mais,
en présentant à Charles, le 1er décembre 1641, la Grande
Remontrance, exposé de griefs et exigence d’un contrôle sur l’exécutif,
il rend la rupture inévitable : le 5 janvier suivant, Charles
tente de faire arrêter cinq députés, dont Pym et Hampden ;
ils s’enfuient dans la Cité, qui se révolte et contraint le roi à abandonner
sa capitale et à se réfugier à Oxford.
De
1642 à 1645, le conflit tourne à l’affrontement armé,
mais est marqué par l’hésitation des armées parlementaires
et par une division de fait du pays entre le Sud riche, et ses ports et flottes,
et un Nord et un Centre acquis de plus ou moins bon gré au camp royaliste.
En 1645, inspiré par l’efficacité du régiment des Côtes
de fer de Cromwell à la bataille de Marston Moor (2 juillet 1644),
le Parlement organise une armée du Nouveau Modèle, de type suédois,
recrutée parmi des protestants déterminés, commandée
par des officiers choisis et promus pour leurs mérites, animée
par des pasteurs aux armées, véritables commissaires politiques,
dotée d’une cavalerie nombreuse ; sous le commandement de Fairfax,
cette armée remporte la victoire décisive de Naseby (14 juin
1645), et Charles Ier, livré par les Écossais,
est
le
prisonnier
du
Parlement
en
avril
1646.
De
1646 à 1649, la révolution se radicalise. Des idéologies
plus révolutionnaires se développent, en particulier à Londres
et dans l’armée (où existent des conseils élus) : les « niveleurs »,
sous la direction de John Lilburne, songent à une véritable
démocratie, sans convaincre, au cours des débats décisifs
de Putney, en novembre 1647, les généraux Fairfax, Cromwell
et Ireton de confier le gouvernement à la « populace » et
risquer ainsi des atteintes à la propriété. Les combats
religieux sont aussi fort vifs : ayant adopté le système presbytérien
en 1646, à la suite du Covenant passé avec les Écossais
en 1643 et des colloques d’une assemblée de Westminster, le Parlement
ne réussit pas à imposer son idée d’un nouveau type de monopole
religieux, en particulier devant les résistances des « indépendants »,
dont le poète Milton et Oliver Cromwell lui-même. La solution politique
se dessine mal : le roi ne sait pas profiter de la possibilité de
négocier que lui confèrent les doutes de la majorité modérée
du Parlement, il s’enfuit de l’île de Wight en 1648, relance la guerre,
est capturé à nouveau. L’armée, devenue la force principale
dans l’État, épure le Parlement, réduisant l’assemblée à un « croupion » (Rump
Parliament), exige et obtient le jugement de Charles Ier. La dignité du
souverain, sa fermeté, son exécution le 30 janvier 1649 en
font un martyr . La dissolution de la Chambre des lords et la décision
de ne pas proclamer roi le fils du défunt entraînent la fin du régime
et le passage à la république pendant onze ans d’« interrègne ».
La République, ou « Commonwealth et État libre »,
réunit les trois royaumes à la suite de dures expéditions
militaires contre les Écossais et surtout les Irlandais, victimes de véritables
massacres et dépossédés de beaucoup de terres remises à des
colons britanniques (les « plantations »). Le système
ne cesse de chercher à se définir. Après le gouvernement
du Rump, on assiste en 1653 à la vaine tentative de réunir un « Parlement
des saints », composé de puritains déterminés,
mais surtout bavards. En décembre, Cromwell se résigne à prendre
lui-même le pouvoir avec le titre de lord-protecteur, qu’il refusera constamment
d’échanger contre celui de roi, mais qu’il laisse évoluer vers
l’hérédité au profit de son fils Richard. Le pouvoir de
l’armée rend impossible tout compromis sous la forme d’un recours à des
Parlements pour assurer un fonctionnement harmonieux du législatif :
ceux qui sont réunis sont promptement dissous. En 1658, la mort d’Oliver
enlève au régime son seul élément de stabilité et
d’efficacité. Richard, vite découragé, abdique en avril 1659,
et l’anarchie militaire s’instaure. Du conflit des généraux, le
vainqueur, en 1660, est Monck : il rappelle le Rump, lui fait prononcer
la dissolution du Long Parlement dont il était l’émanation, fait
convoquer l’ancien Parlement dans ses formes, lords inclus, et, ayant obtenu
du prétendant la déclaration de Breda, fait reconnaître,
le 1er mai 1660, les droits de Charles II et le retour à la
monarchie.
La
République a duré assez longtemps pour marquer l’histoire du
pays. Déchirée entre « cavaliers », réduits à la
défensive, et « têtes rondes » au pouvoir,
elle s’est voulue « puritaine » : un ordre moral oppressant
s’instaure, accentué par Cromwell, qui partage la vision d’une Angleterre « nouvel
Israël » ; les théâtres, les cabarets, les
maisons de prostitution sont fermés, les danses et certaines distractions
(combats de coqs, de chiens et d’ours) interdites, les dimanches réservés
strictement à l’adoration divine. Compensation certaine : la tolérance
la plus grande est accordée à tous les non-anglicans et non-catholiques ;
même les juifs sont réadmis en 1655 ; les sectes prolifèrent,
des diggers, ou bêcheurs, auxquels Gerrard Winstanley prêche un communisme
agraire et chrétien, aux quakers de George Fox en passant par les plus
folles ; au point d’obliger l’État à se faire le juge du recrutement
des clergés paroissiaux et, en 1657, à encourager à nouveau
une Église nationale non obligatoire. Révolution en partie « bourgeoise »,
elle accorde une pleine liberté d’entreprise, met fin à la féodalité en
créant le véritable droit de propriété, met l’État
au service des intérêts marchands (Acte de navigation, 1651 ;
efforts coloniaux et acquisition de la Jamaïque, riche en sucre ; vente
de terres d’Église et dotation foncière à des créanciers
et à des soldats en Irlande). L’anarchie finale comporte la leçon
durable du refus de remettre un pouvoir politique quelconque à l’armée
et de la défiance
envers
une
grande
force
militaire
permanente.
La Restauration
Avec Charles II de 1660 à 1685, puis avec son frère Jacques II
d’York, la Restauration brise le carcan de l’ordre moral antérieur et
rétablit rapidement le monopole anglican en Angleterre. Les discriminations
frappent à nouveau les « non-conformistes », par
ailleurs victimes d’une législation dirigée, en 1673 et en 1678,
contre les catholiques : les lois du Test interdisent toute fonction publique, élective,
parlementaire à celui qui n’aurait pas communié dans l’Église
nationale. De même que la loi de 1661 sur les corporations (municipales)
avait auparavant interdit l’exercice d’une fonction municipale aux non-anglicans.
Charles II, prudent, essaye de faire bon ménage avec un Parlement
qui est, un temps, plus royaliste que le roi (Parlement cavalier de 1661), mais
se heurte de plus en plus fréquemment à lui : le conflit dit
de l’exclusion voit un parti nouveau, les whigs, tenter de faire exclure le catholique
Jacques d’York de la succession et, venant après le vote de l’habeas
corpus en 1679, cette lutte convainc le roi de ne plus en réunir entre
1681 et 1685. La politique extérieure de Charles lui attire d’autres ennemis,
car il est personnellement le client de Louis XIV, et il hésite toujours à prendre
franchement parti contre la France, en particulier lors des guerres de Hollande ;
il a revendu à la France, dès
1662, Dunkerque,
acquise par
Cromwell en
1658.
Mais
le règne de Charles est aussi le temps d’une grande « révolution
commerciale », d’un élan maritime qui enrichit considérablement
Londres, de valeureux efforts pour reconstruire la capitale après le grand
incendie de 1666 selon les plans de l’architecte Christopher Wren, d’une
floraison littéraire exceptionnelle avec la renaissance du théâtre
où brillent les œuvres de John Dryden ; bien des riches sont
satisfaits dont la mentalité apparaît bien dans le journal de Samuel
Pepys ; l’aristocratie a retrouvé son rôle ; au Parlement,
un fort parti tory agit contre les whigs en 1680-1681 et soutient la prérogative
royale. Charles, qui n’a jamais révélé sa conversion secrète
au catholicisme, meurt paisiblement. Son frère Jacques anéantit
aisément la rébellion du prétendant protestant Monmouth,
essaye un temps de s’entendre avec le Parlement, mais commet trop d’erreurs.
Il mécontente les notables locaux en privant un grand nombre d’entre eux
des fonctions de juge de paix, il s’efforce de se doter d’une armée permanente
ouverte aux catholiques, multiplie à nouveau les monopoles injustifiés,
a la maladresse, quand l’Angleterre protestante entière vit le drame voisin
de la France, où l’on révoque l’édit de Nantes, de vouloir
favoriser les catholiques : deux Déclarations d’indulgence, en 1687
et 1688, veulent leur rendre leurs droits civiques ; la résistance
est forte ; des évêques, arrêtés sur l’ordre du
roi, sont acquittés par un jury. Tories et whigs, anglicans et puritains
font cause commune. Quand est annoncée, en juin 1688, la naissance d’un
prince héritier immédiatement baptisé dans la foi romaine,
la révolution
se profile.
La Glorieuse Révolution
La « Glorieuse Révolution » naît d’une conspiration d’aristocrates et d’évêques, de leur appel à un prince étranger, Guillaume d’Orange, gendre de Jacques, qui débarque ses troupes à Torbay, dans le Devon, le 7 novembre 1688, et de la prompte désertion de la plupart des soutiens escomptés du roi. Celui-ci, arrêté, s’enfuit en France, laissant le champ libre à Guillaume : on convoque (illégalement) un Parlement, qui assimile le départ de Jacques à une abdication, adopte une Déclaration des droits qui devient le fondement de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif, proclame Guillaume (III) et Marie (II) roi et reine d’Angleterre à égalité de pouvoirs (23 février) et résout le problème religieux par l’Acte de tolérance, conférant aux seuls protestants la liberté de culte... tout en maintenant les lois du Test et la loi sur les corporations. Courte et peu sanglante, la révolution est d’autant plus populaire dans la mémoire anglaise qu’elle a eu un idéologue de génie en John Locke, qui définit en 1690 les théories du contrat, de la souveraineté populaire, des droits naturels des hommes. Seule l’Irlande, où les « jacobites » trouvent un terrain favorable, est en marge : la guerre y sévit en 1690-1691 et Guillaume doit y remporter les victoires décisives de Londonderry et de la Boyne avant d’imposer le traité de Limerick, tous événements aujourd’hui encore commémorés de manière opposée par les communautés catholiques et protestantes de l’île d’Érin. La révolution est aussi glorieuse parce qu’elle ouvre une période de plus de vingt ans d’expansion et de grandeur internationale.
Les derniers Stuarts
Le
temps des
Stuarts est
encore, en
effet, celui
de Marie
(morte en
1694), de
Guillaume, qui
lui survit
jusqu’en 1702,
d’Anne,
jusqu’en
1714. Sous
leur règne,
les libertés anglaises se consolident (loi de 1693 pour la convocation
obligatoire d’un nouveau Parlement tous les trois ans au moins ; Acte d’établissement
de 1701 exigeant un souverain protestant sur le trône), l’union avec l’Écosse
est réalisée par l’Acte de 1707. Whigs et tories se disputent tour à tour
le pouvoir, mais les luttes se déroulent davantage entre les clans familiaux
qu’entre des partis organisés. L’ombre de Jacques II et de ses successeurs
plane, faisant soupçonner à plusieurs reprises les tories de sympathies
jacobites. Mais, au temps des guerres, ce sont tantôt les intérêts
marchands, favorables à l’expansion maritime, tantôt les plaintes
des propriétaires du sol, victimes de l’effort fiscal et plus pacifistes,
qui dominent. L’attachement des tories à la prérogative royale
leur vaut des faveurs et un pouvoir que les whigs, pourtant partisans des libertés
et de la tolérance, se voient dénier en raison aussi de leurs ambitions
personnelles et de leur avidité. Les grandes victoires sur Louis XIV
et Philippe V d’Espagne, en particulier celles de Marlborough sous la reine
Anne, les conquêtes et acquisitions coloniales (dont Gibraltar) et, en
1713, le victorieux traité d’Utrecht, qui donne à l’Angleterre
d’immenses avantages dans l’Amérique espagnole, valent une popularité considérable à la
monarchie.
Le
temps des
derniers Stuarts
a été la suite aussi de l’essor économique
amorcé sous la Restauration, le moment du développement bancaire
avec la création, en 1694, de la Banque d’Angleterre, l’époque
des grandes entreprises commerciales individuelles ou collectives (Compagnie
des mers du Sud, 1711). Les intérêts financiers peuvent ainsi accepter
la domination politique continue de l’aristocratie foncière. La pauvreté reste
grande, qui aurait affecté, selon les calculs de Gregory King pour 1688,
la moitié des cinq millions d’Anglais ; la charité individuelle
est en baisse, l’assistance publique en accusation, malgré ou à cause
de l’apparition des premiers asiles de pauvres. L’atmosphère générale
demeure optimiste, marquée aussi par un mouvement intellectuel vigoureux ;
Henry Purcell, mort en 1695, a été le plus brillant des compositeurs. À côté de
Locke, l’autre grand génie mondial est le savant Isaac Newton, bénéficiaire
en partie de recherches astronomiques menées en particulier par Edmund Halley,
et parfois dans le cadre de l’observatoire de Greenwich fondé en 1676.
Le tout sur fond d’apaisement des conflits religieux, de déclin du non-conformisme,
abandonné par les élites sociales, du recul décisif des
presbytériens, de l’essor relatif des baptistes et quakers, de la croissance
des unitariens, qui, en rejetant le dogme de la Trinité,
s’affirment
de
leur temps,
qui est
celui du
rationalisme.
Le XVIIIe siècle
Le XVIIIe siècle ne constitue pas une unité et son étude est à prolonger jusqu’au début des années 1830, moment de l’achèvement d’une première phase de la révolution industrielle et, en 1832, de la grande réforme parlementaire.
Le régime politique
Le
régime politique demeure relativement stable de 1714, date de l’avènement
des Hanovre en vertu de l’Acte d’établissement de 1701, à cette
victoire relative du courant « radical ». Entre-temps,
les évolutions ont été « silencieuses »,
bien
que
souvent
importantes.
George Ier et, à partir de 1727, George II ont vu leur légitimité contestée à l’occasion
des deux grands soulèvements jacobites en faveur de « Jacques III »,
en 1715, et surtout en 1745, date d’une grande entreprise partie d’Écosse
sous le commandement du prince Charles-Édouard (« Bonnie prince
Charlie ») : la bataille de Culloden du 16 avril 1746,
véritable « boucherie », permet au vainqueur, le
duc de Cumberland, de mater définitivement les rebelles et ouvre la voie à la
réduction du pouvoir des clans écossais.
É
lecteurs de Hanovre, les deux souverains, souvent inattentifs aux affaires britanniques,
ont permis le développement du cabinet, dirigé de fait par le premier
lord de la Trésorerie, Premier ministre sans le titre : Robert Walpole
donne tout son lustre au nouveau système en exerçant le pouvoir
de 1721 à 1742, souvent grâce à des manœuvres de corruption,
parfois, sous George II, de 1727 à 1737, grâce à l’appui
de la reine Caroline. Après lui, le plus éclatant est William Pitt
l’Aîné, qui sert sous les ducs de Devonshire, puis de Newcastle,
avec le titre de secrétaire d’État, mais exerce en fait la fonction
de Premier ministre (1756-1761). Le Parlement, dominé par les clans familiaux,
est renouvelé au moins tous les sept ans (depuis 1717) ; il représente
surtout les propriétaires du sol, la moitié des députés
au moins. La Chambre des communes, issue d’élections où l’argent
joue le rôle majeur et où le corps électoral
doit
tout
aux
hasards
de
l’histoire,
ne
l’emporte
toujours
pas
sur
la
Chambre
des
lords.
Sous
George III , premier Hanovre réellement anglais, on assiste
au réveil d’un vieux conflit d’autorité ; le souverain entend
gouverner lui-même en s’appuyant sur des Premiers ministres à sa
dévotion, John Stuart Bute, puis Frederick North. Les gouvernements
usent sans vergogne d’une corruption que dénoncent, en 1769, les anonymes
Lettres de Junius ; les plus fragiles des ennemis politiques, comme le journaliste
John Wilkes, sont en butte aux persécutions les plus déterminées.
L’autoritarisme s’exerce aussi bien à l’encontre des colons d’Amérique
du Nord : leur révolution est dirigée expressément
contre George III, et leurs succès scellent l’échec de la
monarchie. À partir des années 1780, et surtout du premier ministère,
en 1783, de William Pitt le Jeune , le souverain doit s’effacer ; la
fin du siècle voit coïncider une majorité parlementaire et
les orientations du gouvernement, sans que celui-ci soit responsable devant les
Chambres. La maladie mentale de George, bien qu’à éclipses, renforce
encore l’évolution, et aboutit en 1810 à la régence
du
prince
de
Galles.
Pour
l’essentiel,
on
ne
procède pourtant à aucune grande réforme.
Le mouvement « radical » s’est développé dans
les années 1770 parmi les amis de « Wilkes et [de] la liberté » ;
il a trouvé son assise géographique dans le Yorkshire, son appui
idéologique parmi des non-conformistes comme John Jebb, Robert Price,
Joseph Priestley. Il use du droit ancestral à la pétition,
demande une redistribution des sièges, la suppression des « branches
pourries » du système qu’avait dénoncées Pitt
en 1780 au sein de l’opposition (bourgs pourris, bourgs de poche), une extension
du droit de suffrage ; toujours en vain. Le relais est pris ensuite par
les jacobins anglais, inspirés par la Révolution française,
mais aussi par les traditions anglaises exaltées en 1788 par la Société des
amis de la révolution (de 1688). Le jacobinisme englobe d’abord aussi
des aristocrates, comme lord Grey, mais l’exemple français effraye les
possédants, et la principale Société dite de correspondance,
avec Thomas Hardy et Horne Tooke, puise ses effectifs dans les classes
populaires et prône rapidement une complète démocratie. Les
idéologues s’enflamment de part et d’autre : l’idole des révolutionnaires,
Thomas Paine, auteur en 1791 des Droits de l’homme, s’oppose avec un certain
succès au prophète européen de la contre-révolution,
Edmund Burke, auteur des Réflexions sur la Révolution française
(1790) ; la pensée est riche d’œuvres de poètes, comme Samuel
Taylor Coleridge ou Robert Burns, de philosophes comme William Godwin
et sa compagne, la féministe Mary Wollestonecraft, qui revendique
les « droits de la femme ». Pitt s’effraye de l’épidémie
révolutionnaire. Des poursuites de plus en plus dures sont engagées
contre les jacobins, l’habeas corpus est régulièrement suspendu à partir
de 1795, le droit de réunion et d’association sévèrement
limité par les lois « sur les coalitions » de
1799-1800.
La
revendication
politique,
un
long
moment
réprimée, renaît
après Waterloo, à nouveau sous le drapeau du radicalisme et en
prenant appui sur les victimes des mutations économiques, ouvriers, artisans,
petits paysans. Les rassemblements de masse et les pétitions connaissent
de dramatiques incidents – ainsi le « massacre de Peterloo » (St.
Peter, près de Manchester) en 1819 –, des lois de répression
sévères et aucun succès parlementaire. Il faut attendre
1828 et 1829 pour voir procéder à des réformes devenues
indispensables pour d’autres raisons et accorder aux protestants, puis aux catholiques,
l’égalité civique. Dans la vague des révolutions européennes
de 1830 et au milieu d’immenses mouvements populaires dans les campagnes, Guillaume IV
finit par accepter que lord Grey fasse voter une réforme limitée
du régime.
Pendant
tout
le
XVIIIe siècle, période « du Parlement
non réformé », on avait souvent exalté les vertus
de la séparation de pouvoirs équilibrés, le juriste William Blackstone
se faisant en 1765 l’écho des réflexions de Montesquieu. Pourtant,
ce régime autorise bien des abus et des politiques de force, y compris
sur les marges : les Irlandais, d’abord satisfaits dans les années
1780 de quelques concessions et décidés, sous l’impulsion de protestants
comme Henry Grattan, à lutter pour une réelle autonomie, subissent
le contrecoup du succès du plus radical mouvement des Irlandais-Unis,
sous Theobald Wolfe Tone, dans la population, et de ses intrigues avec la France
révolutionnaire. Après l’échec d’une tentative révolutionnaire
en 1798, Pitt force, à coups de menaces et de corruption, le Parlement
de Dublin à accepter l’union avec la Grande-Bretagne, qui entre en vigueur
le 1er janvier 1801 !
Les « révolutions » économiques
L’héritage des mutations économiques décisives compte davantage
que les luttes politiques. À la révolution commerciale qui se poursuit,
gonflée par les succès coloniaux, s’en ajoutent d’autres. La révolution
agricole, née dans le Norfolk des années 1730 et 1740, ne se limite
pas aux enclosures accélérées et à l’adoption de
multiples plantes nouvelles qui viennent diversifier les méthodes d’assolement ;
elle voit aussi mettre en culture des friches, enrichir des sols par le marnage
et le chaulage, rénover l’élevage par le recours à l’alimentation
en étable, le croisement des espèces, la qualité des soins ;
elle permet d’énormes gains de production et de productivité et
enrichit les classes foncières tout en procurant un emploi à de
nombreux journaliers qui, privés par ailleurs de lopins de terre, sont
requis pour la plantation de clôtures, la réfection des chemins
vicinaux et bien d’autres travaux domestiques. L’agronomie brille d’un vif éclat,
illustrée par Arthur Young à la fin du siècle. Une révolution
des transports est liée à la construction de nombreuses routes à péage,
dès les années 1740, et, entre 1760 et 1790 notamment, par la « fièvre
des canaux » : la voie d’eau permet désormais des convois
lourds et bon marché. Partout main-d’œuvre et consommateurs se multiplient
sous l’effet de la révolution démographique : la moindre mortalité,
alors que les taux de natalité sont encore forts, porte la population
anglo-galloise de six à neuf millions d’habitants entre 1750 et 1790, à près
de quatorze millions en 1831 date du troisième recensement depuis 1801,
et cette croissance a, dès 1798, inquiété fortement Malthus,
auteur de l’Essai sur la population. La révolution industrielle est la
fille de la machine et de l’utilisation du charbon de terre dans l’industrie
métallurgique comme pour la production de la vapeur (premier brevet de
James Watt en 1769, première application de la machine à vapeur à une
machine industrielle en 1786-1789) ; surtout, elle doit tout, au début, à l’introduction
massive du coton dans le textile et à l’invention de machines à filer
et à tisser. Elle se développe dans les contrées de l’Ouest
et du Nord, autour de Liverpool et de Manchester, dans le Lancashire ; à proximité de
Glasgow aussi : par exemple, dans la localité de New Lanark,
où David Dale et son gendre Robert Owen deviennent les pionniers
d’une industrie cotonnière moderne et d’un paternalisme exemplaire, avant
le glissement progressif d’Owen, dans le cours des années 1820, vers le
socialisme, dont il devient le seul grand prophète britannique de l’époque.
La
révolution industrielle ne s’impose pas aisément. Outre la résistance
de tous les hommes de tradition, elle se heurte à l’opposition des artisans, à des
actions de bris de machines et d’incendies d’usines dans le Sud dès 1778 ;
on aboutit entre 1811 et 1813 à la grande crise du « luddisme » et à une
révolte un temps plus que menaçante contre les nouveaux systèmes
de production. Vers 1830, la moitié de la production industrielle continue
d’être le fruit du travail en atelier, au prix il est vrai d’énormes
privations endurées par les artisans, contraints, dans les secteurs menacés,
d’accepter des rémunérations
de
plus
en
plus
basses
pour
leur
travail.
Si
les
gains
considérables de productivité et de production, l’élan
prodigieux des usines de cotonnades qui surpassent les lainages au tournant du
siècle, les revenus croissants d’un secteur secondaire, qui emploie dès
1806 le tiers de la main-d’œuvre, peuvent enivrer les profiteurs du système,
satisfaire la classe bourgeoise montante baptisée « classe
moyenne » précisément vers 1800, le prix paraît
trop élevé aux vaincus comme au nouveau prolétariat nommé « classes
laborieuses » dans les années 1820 ; le développement
des villes, telle Manchester, est trop rapide pour que l’habitat ouvrier ne soit
pas misérable ; le manque de sécurité dans le travail,
dans le salaire, dans les gestes techniques est gros de menaces pour les accidentés,
les vieux, les faibles ; la vie familiale s’étiole quand femmes et
enfants concurrencent les hommes adultes et partagent avec eux des journées
longues et épuisantes. Des crises périodiques, de surproduction
ou de sous-consommation, de financement aussi des industries, même si les
entreprises reposent beaucoup sur l’épargne et l’autofinancement, suscitent
le désespoir en 1816, au début des années
1820,
1825,
en
1830.
Le
monde
nouveau
est
exalté par les idéologues, le premier en date étant
Adam Smith, auteur dès 1776 des Recherches sur la richesse des nations.
Une école libérale développe ses intuitions et ses principes,
mais succombe aussi, avec David Ricardo vers 1817, au pessimisme social. Pour
les pauvres, auxquels leurs « vices » promettent des familles
trop nombreuses et un impossible salaire de pure subsistance, les grands esprits
n’envisagent aucun secours, en vertu même des lois naturelles qu’il convient
de respecter. Ceux qui s’enrichissent par la rente et par un profit dépendant
des bas salaires sont justifiés à leurs propres yeux par leurs
vertus et leurs capacités. Pour l’étranger, cette royauté de
l’or et cet apogée de l’égoïsme sacré paraissent ramener
l’Angleterre vers la « barbarie ».
La
puissance
britannique
doit
cependant
beaucoup à des capacités
matérielles qui augmentent plus rapidement qu’ailleurs. Jusqu’en 1789,
seule la France a fait aussi bien, voire mieux, en demeurant pour l’essentiel
fidèle à ses techniques anciennes. La révolution permet
une « échappée » irrésistible
de
la
Grande-Bretagne,
dont
l’avance
technique
semble
irrattrapable
et
dont
la
croissance
s’affirme
dans
les
secteurs
les
plus
modernes.
Le grand essor mondial
Colonisation
et
guerres
ont
nourri
la
puissance économique comme elles
en ont retiré les plus gros avantages. Une longue période de pacifisme
au temps de Robert Walpole a été suivie de guerres répétées,
en particulier contre la France. Le traité de Paris de 1763 vaut à la
Grande-Bretagne les droits essentiels sur le Canada et l’Inde ; le premier
empire colonial subit la tempête de la sécession américaine,
consacrée à Versailles en 1783 , mais les possessions extérieures
demeurent nombreuses et elles s’accroissent au cours des guerres contre la Révolution
et l’Empire. Des bases essentielles comme Malte sont alors acquises. Surtout,
de même qu’elle sait tirer bien des richesses et trouver des marchés
dans ses colonies, qu’elle ruine l’industrie du coton en Inde au profit de la
sienne, l’Angleterre développe son commerce mondial avec des pays indépendants.
Elle conserve ses liens économiques avec les jeunes États-Unis,
inonde l’Europe centrale et orientale de ses productions, satellise en partie
l’Empire ottoman, bénéficie du marché de l’empire portugais,
favorise les révolutions latino-américaines et s’ouvre tout grands
les marchés de l’Amérique espagnole devenue indépendante.
Les guerres « françaises » suscitent des pertes,
en partie liées à la guerre de course ; le blocus continental
décrété par Napoléon Ier en 1806 manque de jeter
le Royaume-Uni à genoux vers 1811-1813 ; mais les dépenses
militaires sont aussi l’occasion de nouveaux développements et l’aide
aux alliés prend souvent la forme de l’expédition de lettres de
change qui valent des commandes à l’industrie britannique. Il n’est jusqu’à l’agriculture
qui prospère dans les premières années du XIXe siècle,
avec des prix records pour ses produits : dans son cas, la défaite
de la France, la reprise des importations, même limitées par le
jeu des « lois sur le blé » ultraprotectionnistes,
la ruine de fermiers, qui avaient accepté des baux trop coûteux
et connaissent les effets de la déflation monétaire, renversent
la tendance à partir de 1816 ; elles font de William Cobbett, à l’occasion
de ses tournées à cheval dans le pays (Rural Rides) l’observateur
génial du désastre dans les années qui précèdent
la crise de 1830 et la dernière grande révolte des campagnes. La
gloire des armes, après une guerre quasi ininterrompue de 1793 à 1815
(la paix d’Amiens de 1802 n’a procuré qu’un très bref répit),
a été celle de la flotte, victorieuse à Aboukir et à Trafalgar,
avec Nelson, et qui passe désormais pour invincible ; elle a été aussi
celle des troupes terrestres qui ont brillé dans la péninsule Ibérique
avant d’infliger à l’empereur des Français, sous le commandement
de Wellington, sa dernière défaite à Waterloo. Au congrès
de Vienne de 1815, qui refait la carte de l’Europe, l’Anglais R. S. Castlereagh
a joué un rôle décisif. Ensuite, un temps empêtrée
dans une Sainte-Alliance qui est un « jouet sonore et creux »,
plus longtemps fidèle à la quadruple alliance (contre la France)
et à la quintuple (la France y adhérant en 1818) pour contenir
toute nouvelle menace révolutionnaire en Europe, la Grande-Bretagne peut
s’autoriser, à la fin des années 1820, un isolement progressif,
riche de menaces pour tous et dénué d’engagements contraignants.
Soucieuse surtout de l’équilibre des puissances, laissant à Metter
nich
le
rôle de « surveillant général »,
l’Angleterre ne refuse pas d’aider la libération de la Grèce du
joug des Turcs en 1827, aux applaudissements d’une opinion publique exaltée
auparavant par les appels d’un Byron, mais n’entend pas être mêlée à des
interventions répétées à l’intérieur d’États
souverains.
Le rayonnement intellectuel
Si le rayonnement intellectuel est très réel, il n’a pas toujours été à la mesure des succès politiques et économiques. Il a pourtant été lui aussi particulièrement impressionnant. D’abord parce que la philosophie des Lumières est largement venue du Nord, s’est parfois propagée directement d’Angleterre vers la Suède et la Russie, a imprégné la pensée de Français qui, à l’instar de Voltaire ou de Montesquieu, ont trouvé en Grande-Bretagne modèles et exemples. De Locke à Hume, à Priestley, à Burke, nombre d’idéologues ont pesé d’un grand poids, avant que Jeremie Bentham, prophète de l’utilitarisme et du libéralisme politique, assume sur le terrain de la morale et du droit public la fonction occupée par Adam Smith, Malthus, Ricardo, Owen dans le domaine de la pensée sociale et économique. Aux frontières de la littérature et de la pensée morale, les grands satiristes du début du XVIIIe siècle, Jonathan Swift, Joseph Addison, Daniel Defoe avant Samuel Johnson et Samuel Richardson au milieu du siècle ; l’histoire, illustrée par Edward Gibbon et son essai sur la décadence de l’Empire romain ; le théâtre d’Oliver Goldsmith, de R. B. Sheridan ; la musique, qui sait adopter G. F. Haendel ; la peinture qui brille de son plus vif éclat avec Thomas Gainsborough, Joshua Reynolds, John Constable, William Hogarth, ce dernier en même temps chef de file d’une école extraordinaire de caricaturistes de génie ; ajoutons tant de poètes qui mènent peu à peu au romantisme des Wordsworth, Burns, Blake ou Coleridge ! S’il est impossible de citer tous les noms, la preuve est faite que le dessèchement avéré des études universitaires, la décadence des anciennes écoles, compensée parfois par l’éclat de certains centres dont des « Académies » puritaines, ne doivent pas amener à conclure à un lien quelconque entre capitalisme croissant et barbarie nouvelle. L’éclat de la réflexion religieuse prouverait à lui seul le contraire : le XVIIIe siècle, à partir de 1739, est celui d’un renouveau religieux conduit par John Wesley : l’« inventeur » du méthodisme se situe longtemps, jusqu’en 1787, à l’intérieur de l’anglicanisme, mais suscite de toute manière, dans l’Église officielle, le courant évangélique, attaché à la lettre des Écritures et ouvert cependant à une chaleur et à une communication infiniment plus développées qu’auparavant. Le méthodisme de son côté, marqué après la mort de Wesley, en 1791, par nombre de schismes, s’enrichit globalement de la constance de tels renouvellements, et passe pour avoir sauvé le peuple de la déchristianisation précoce, peut-être même d’avoir permis « un nouveau pouvoir de la croix » et évité à la Grande-Bretagne les affres révolutionnaires. Au minimum, enrichi par l’essor même du revenu des dîmes et de la rente foncière, le clergé anglican est plus digne et recruté dans des milieux sociaux plus élevés qu’aux siècles précédents. Au moment de la révolution industrielle triomphante, la grandeur de Byron, la verve des romanciers « gothiques », dont Walter Scott, l’art du récit chez Mary Shelley ou Jane Austen conduisent à mettre en doute les jugements caricaturaux et pessimistes.
L’époque victorienne
L’époque victorienne couvre la plus grande partie du XIXe siècle.
La reine dont elle tient son nom est montée sur le trône en 1837, à l’âge
de dix-huit ans, elle est morte en janvier 1901. Mariée en 1840 à Albert
de Saxe-Cobourg, qui fournit ainsi à sa dynastie une nouvelle dénomination,
elle ne se consola jamais d’un veuvage précoce, en 1861. Parmi ses neuf
enfants, plusieurs épousèrent des princes ou princesses allemands
et russes : elle devint la « grand-mère de l’Europe » et,
plus précisément, celle de l’empereur Guillaume II après
avoir été la belle-mère de l’empereur Frédéric III.
Cette
vie
familiale
crée un modèle de vertu proposé à son époque
aux Britanniques et qui contribua à sauver l’institution monarchique de
l’opprobre moral suscité par des souverains précédents :
en particulier George IV (1820-1830), l’ancien régent, connu depuis
sa jeunesse pour sa vie dissolue et ses relations suspectes avec des favoris
comme, vers 1817, « le beau Brummell ». Affrontée à un
fort courant républicain en 1837, Victoria meurt dans l’affliction générale
et fait bénéficier
ses
successeurs
d’un
loyalisme
monarchique
presque
sans
faille.
La démocratisation
Aimant
son
métier de reine et l’accomplissant avec une rare conscience
et aussi une jalousie certaine, après la mort de son époux, à l’encontre
de tout membre de sa famille, Victoria a su s’adapter aux exigences de son époque. À partir
de 1841 et de la chute de Melbourne, ses Premiers ministres, à commencer
par sir Robert Peel, sont choisis en fonction de la majorité au
Parlement. Affirmé peu à peu, en fonction de la discipline croissante
des partis au Parlement, et de la clarté des scrutins, le système
parlementaire de la responsabilité ministérielle s’impose. La reine
n’a pas non plus essayé de se mettre en travers de l’évolution
vers la démocratie : en 1867, le droit de vote est accordé à des
locataires de logement et non plus aux seuls propriétaires, ce qui donne à un
million d’ouvriers une arme électorale : en 1884-1885, la majorité des
hommes de vingt et un ans et plus (à l’exclusion des domestiques, des
fils de famille vivant sous le toit de leurs parents, des non-résidents)
sont admis aux urnes ; à quoi s’ajoutent les effets des réformes
locales, la loi sur les municipalités de 1835 à présent
appliquée, la loi de 1888 sur les conseils de comté élus,
d’autres mesures dans les années 1890 sur des administrations de districts
ou de paroisses. La Chambre des communes, recrutée de plus en plus selon
un système plus équitable de répartition des sièges
(on passe en 1885 à une quasi-généralisation du système
uninominal à un tour après nouveau découpage des circonscriptions),
s’impose comme la véritable représentante dans la nation, même
si les lords ne perdent encore aucun droit théorique. Des lords que la
reine « alimente » de plus en plus en nouveaux collègues
désormais recrutés, à partir des années 1880-1890,
aussi bien dans les milieux d’affaires que dans les groupes traditionnels d’anciens
militaires, fonctionnaires, hommes de loi. Les chefs de parti ont pris de l’assurance
en raison même de la qualité croissante de leurs organisations.
Les deux principaux partis sont le Parti conservateur, héritier du tory
en 1836, et le Parti libéral, qui adopte son nom en 1847 aux dépens
du whig ; ils ont longtemps été des coteries soutenues par
des clubs ou des associations locales ; ils tirent de la réforme
de 1867 la conviction qu’ils doivent se constituer en puissantes « machines »,
avec des agents professionnels et des sections locales disciplinées. Les
Premiers ministres qui commandent ces formations sont souvent de grande valeur,
tout en ne personnalisant pas encore leur pouvoir à l’excès :
en particulier Peel, qui se suicida politiquement en soutenant, contre une partie
de ses amis conservateurs, le libre-échange en 1846 ; John Russell,
qui, de 1846 à 1852, a connu le grand choc de la famine irlandaise et
de la revendication démocratique chartiste ; H. T. Palmerston, également
libéral, maître à penser de la politique étrangère,
Premier ministre de 1855 à 1858 et de 1859 à 1865, et surtout Benjamin Disraeli
(conservateur)
et
W.
E.
Gladstone
(libéral), parvenus à la tête de leur formation respective
en 1867 et qui brillent d’un éclat incomparable, faisant pâlir en
regard des successeurs plus « moyens », dont le conservateur
R. C. Salisbury, pourtant aux affaires de 1886 à 1892, puis de 1895 à 1902
(il fut le dernier Premier ministre recruté parmi les lords). La reine
a su composer avec de tels serviteurs, usant de la possibilité d’opérer
des choix quand les majorités n’étaient pas nettes, servant à l’occasion
d’utile trait d’union pour obtenir un consensus essentiel, comme lors de la réforme
de 1884-1885, prodiguant des conseils sollicités ou infligés, mettant
en garde au nom d’une expérience évidemment croissante. Fonctions
parfois discrètes, et parfaitement définies en théorie
par
Walter
Bagehot,
auteur
d’une
brillante
Constitution
de
l’Angleterre
(1867).
À
la fin du règne d’une femme, la démocratie anglaise se caractérise
pourtant par le refus de prêter attention à une active revendication
féministe. Le mouvement des suffragettes, en fait très divisé,
se heurte aux préjugés anciens et aussi, même dans les partis
plus avancés, comme le Parti socialiste, apparu en 1883, le Parti travailliste
indépendant, né en 1893, et le tout nouveau Comité pour
la représentation des travailleurs, père du Parti travailliste, à une
objection quelque peu hypocrite : avant d’accorder le droit de vote aux
femmes, il conviendrait d’éliminer au préalable toutes les discriminations
pesant encore sur les hommes !
Les difficultés politiques
Les
grands
problèmes qui divisent l’opinion et le Parlement ont varié.
Au départ, on peut en recenser trois à l’intérieur :
la politique économique, la réforme sociale et la question de la
démocratisation. La première est surtout celle du choix du système
douanier : aux protectionnistes invétérés, soutenus
par les « intérêts fonciers », s’opposent
les libre-échangistes de l’école de Manchester, dont Richard Cobden
est le porte-drapeau, et sa Ligue pour l’abolition des lois sur le blé l’instrument
majeur de revendication ; les partisans de la libération des échanges
en attendent l’ouverture du monde à la production industrielle britannique,
le pain bon marché pour les ouvriers, la paix entre les nations, mais,
en dépit de l’organisation du premier groupe de pression véritable
de l’histoire contemporaine, c’est à la famine irlandaise qu’ils doivent
la conversion de sir Robert Peel et l’adoption de la loi décisive
de 1846. La question sociale est posée par l’énorme misère
qui accompagne la révolution industrielle : une première loi
sur le travail des femmes et des enfants en usine, en 1833, est positive, mais
sans grand effet, et, à l’avènement de Victoria, on vit surtout
sous l’impression créée par la nouvelle loi des pauvres de 1834,
qui repose sur les principes d’uniformisation, de centralisation et de restriction
de l’assistance publique ; celle-ci devrait en principe n’être accordée
que dans des asiles, les sinistres workhouses, dont la multiplication suscite
des révoltes désespérées ; dans les années
qui suivent, on s’oriente vers un interventionnisme timide au bénéfice
toujours des femmes et des enfants avec la loi sur les mines de 1842, qui les écarte
du travail au fond, et la loi de dix heures de 1847. Cette timidité explique
pour partie l’essor du mouvement politique chartiste entre 1838 et 1848 (il survit
ensuite jusque vers 1854) : il est né de la déception provoquée
par la réforme de 1832, qui a corrigé des abus, mais réservé le
droit de vote aux seuls bourgeois... sans d’ailleurs altérer immédiatement
la domination politique des classes agricoles ; à partir de 1838,
la « Charte du peuple » représente une Constitution
idéale, prévoyant le suffrage universel des hommes de vingt et
un ans et plus, l’éligibilité de tous et l’indemnité parlementaire,
une répartition des sièges selon des principes démographiques,
l’élection annuelle d’un Parlement ; à coups de pétitions
massives en 1839, 1842 et, surtout, 1848, de meetings , mais aussi, dans l’aile
violente dominée par Feargus O’Connor et guidée par son journal,
le Northern Star, d’appels à la grève générale (1839),
de violences contre les outils de travail (1842), voire de menaces révolutionnaires
(1848), les chartistes se battent en vain ; leur combat paraît même
aux libéraux gros de la menace d’une révolution de la société,
un Parlement élu par des pauvres risquant de mener à une redistribution
de la propriété.
À
partir de l’échec de l’ultime manifestation de masse des chartistes en
1848, le débat politique s’apaise et, jusqu’en 1867, il est fait de querelles à l’intérieur
du monde parlementaire, où les peelites voient fuir vers le Parti libéral
des intransigeants comme Gladstone, où les tories « sociaux » trouvent
dans l’étoile montante de Disraeli l’espoir encore vain de réformes,
où la réalité du régime parlementaire a quelque mal à s’imposer.
En 1867, la conversion de Disraeli à la première réforme
démocratique, véritable « saut dans le noir »,
marque un tournant, parce que les chefs et les appareils sont invités à définir
des programmes de nature à séduire un électorat plus populaire. À la
fin des années 1860 et jusqu’au début des années 1880, les
questions à l’ordre du jour sont plus diverses. Le problème de
l’Irlande, déjà aigu jusqu’en 1845 lorsque O’Connell se battait
pour l’annulation de l’Union de 1801 (le Repeal), assoupie à la suite
de la Grande Famine, a retrouvé sa gravité avec son triple aspect
politique, agraire et religieux ; ce dernier est éliminé en
1869 quand Gladstone fait voter la séparation de l’Église (anglicane)
et de l’État en Irlande (disestablishment), mais un mouvement agrarien
obtient plus difficilement des concessions, au début des années
1880, sur ses revendications des « trois F » (fair rent,
fixity of tenure, freedom of tenant to sell, c’est-à-dire loyer juste,
garantie de non-éviction du fermier et liberté de céder
la terre occupée en location), cependant que la revendication politique
d’un Home Rule, exprimée par C. S. Parnell, ne reçoit que
la réponse de lois d’exception. Pendant ce temps, le pari disraélien
de faire voter les pauvres en faveur des plus capables de l’élite sociale
pousse à de nouvelles propositions démocratiques (vote secret en
1872), à la définition de programmes sociaux (lois sur les syndicats
et sur les rapports « patrons-ouvriers », et non plus « maîtres
et serviteurs »), dans la soudaine rivalité progressiste des
deux principaux partis, à l’émergence du « socialisme
municipal » à Birmingham, dont Joseph Chamberlain est
maire en 1874, à de premières offres de candidature à des
ouvriers qu’on se propose de faire élire sous l’étiquette libérale
(les lib-lab, ou libéraux-travaillistes). Par ailleurs, la politique extérieure
devient enjeu populaire, Disraeli projetant de faire sacrifier la lutte des classes
sur l’autel patriotique et de faire de l’impérialisme le nouvel évangile
social ; d’où la décision de faire de Victoria l’impératrice
des
Indes
(1876)
.
Les
dernières décennies du règne, marquées
par la grande crise économique, confirment la permanence de
l’enjeu impérialiste,
même si un parti comme le Parti libéral se divise profondément
sur ce thème. À partir de 1895 et de l’arrivée
de Joseph Chamberlain
au ministère des Colonies sous Salisbury, l’option de l’expansion
est consacrée comme un élément majeur du programme
conservateur. Le souci de grandeur est venu compliquer la question
politique irlandaise et
jusqu’à l’équilibre des partis. Gladstone, convaincu à partir
de la réforme électorale de 1884-1885 que le Home Rule
est aussi un moyen d’épargner au Parlement de Westminster
le risque d’un arbitrage par la masse de plus de cent députés
d’Irlande, tente de le faire voter, au nom de la justice, en
1886 et échoue, tout comme il échouera
devant les Lords dans sa deuxième tentative de 1893 :
il casse son Parti libéral, abandonné par les « unionistes » de
Chamberlain, qui évoluent vers une étroite alliance-association
avec les conservateurs. À ces troubles s’ajoutent les
effets de la propagation du socialisme (H. M. Hyndman,
plagiaire de Marx, fonde la Fédération
sociale-démocrate en 1883 et professe un socialisme
révolutionnaire
qui rallie un temps les chômeurs londoniens en 1886-1887 ;
des anarchistes, un temps rejoints par William Morris, ont
créé en 1885 la Ligue
socialiste ; « gradualistes »,
les membres de la Société fabienne,
brillant club d’intellectuels comme les deux Webb, H.
G. Wells et G. B. Shaw,
veulent saper la société capitaliste, parfois
d’abord au niveau des nouveaux conseils de comté,
par des réformes progressives ;
le mineur écossais Keir Hardie, après
avoir poussé le
syndicalisme sur la voie socialisante, fonde le Parti
travailliste indépendant
et œuvre, en 1899-1900, pour fédérer syndicats
et mouvements politiques. Il ne reste aux tenants de
la tradition qu’à préconiser un socialisme
d’État propre à désarmer la revendication
révolutionnaire,
comme le préconisent les « radicaux » dans
le Parti libéral, ou à insister encore
davantage sur les promesses de prospérité de
l’empire. Les choix sont parfois rendus plus malaisés
par des tensions internationales qui portent la politique
extérieure au centre du débat
politique, comme en 1898 quand Français et
Anglais manquent de se faire la guerre sur l’affaire
de Fachoda, ou en 1895-1900 quand les Allemands
soutiennent
la cause des Boers en Afrique du Sud contre les
ambitions déchaînées
du « panbritannisme » ;
on crie aux avantages du « splendide
isolement », mais on commence aussi à ressentir
le besoin d’alliances, sans savoir si l’ennemi
principal est franco-russe, ce qui serait le résultat
des rivalités impérialistes les
plus aiguës,
ou
allemand,
quand
en
1897
Berlin
se
lance
dans
la
construction
d’une
grande
flotte
de
guerre.
De l’apogée au déclin économique et aux tensions sociales
On
s’aperçoit dès lors des conséquences d’une décadence économique
relative après l’apogée des années 1850-1870. Le chemin
de fer prenant le relais du textile, l’industrie sidérurgique et mécanique
devenue inégalable, la Grande-Bretagne avait pris une telle avance sur
les autres que l’Exposition universelle de Londres, en 1851, la première
dans l’histoire, avait prouvé son rôle d’« atelier du
monde ». Une série de traités de libre-échange,
le plus connu étant celui de 1860 avec la France (traité Cobden-Michel-Chevalier),
avait donné un immense coup de fouet à la prospérité.
L’agriculture, encore abritée de la concurrence par les distances maritimes,
on avait connu l’impression d’aller vers l’âge d’or. Les années
qui s’écoulent à partir de 1873 ruinent les illusions d’une durable
supériorité technique : Allemagne, France, États-Unis
sont vite de redoutables concurrents, pendant que la plupart des grandes et petites
nations du continent s’ouvrent à l’ère industrielle ; sous
l’effet aussi d’une relative pénurie de moyens de paiement, provoquant
la déflation et peut-être à cause de l’esprit rentier des
héritiers des grands bourgeois d’autrefois, les marchés se rétrécissent,
l’innovation se limite aux secteurs nouveaux, le capital s’exporte à l’étranger,
où il trouve des investissements autrement plus rémunérateurs
qu’en Angleterre ; l’arrivée massive d’aliments en provenance des
pays neufs plonge l’agriculture dans une « grande dépression » et
provoque des abandons considérables de surfaces cultivées et un
exode rural précipité. Demeurée fidèle au libre-échange,
malgré les fair-traders des années 1880 et les partisans d’un système
impérial dans la décennie suivante, la Grande-Bretagne trouve de
nouveaux clients et compense en outre par l’élargissement de ses marchés
intérieurs le rétrécissement des autres : une première
société de consommation bénéficie d’une « révolution
du commerce de détail », de la naissance des chaînes
de magasins, du développement des coopératives, de la création
de nombreuses boutiques. Mais le chômage industriel est endémique
et la première place mondiale est définitivement perdue à partir
de 1890. Joseph Chamberlain, en 1903, achèvera de convaincre ses
amis de la nécessité du protectionnisme : pour leur perte !
C’est au milieu des tourmentes de l’économie qu’évolue une société également
définie par d’énormes
mutations.
La
population
augmente,
dépassant les 40 millions d’habitants à la
mort de Victoria, mais dès les années 1860 le malthusianisme familial
triomphe dans la bourgeoisie avant de gagner les classes populaires au cours
des vingt années suivantes. Affaiblie par un courant d’émigration,
elle est en outre vieillissante, malgré l’arrivée de vagues d’immigration,
parfois temporaires quand s’ensuivent des départs vers les États-Unis
ou le Canada, parfois plus définitives avec l’établissement de
nombreux sujets juifs de l’Empire des tsars. Inégalement répartie
en fonction de la prospérité de certaines régions, encore
dense dans l’Angleterre « noire » ou « grise » du
Nord et du Centre, aux bastions industriels solides, elle s’agrège, au
sud, surtout dans l’agglomération londonienne qui, à elle seule,
réunit 6 millions et demi d’habitants en 1901. L’ère victorienne
a de toute manière été celle des grandes villes : Birmingham
est passé de 230 000 à 520 000 habitants de 1851 à 1901,
Glasgow de 357 000 à 762 000, Manchester de 303 000 à 645
000. Quatre Britanniques sur cinq sont des citadins au tournant du siècle.
Les
différences sociales sont étonnantes. Au début des années
1840, dans son roman Sybil, Disraeli a évoqué l’existence de « deux
nations » sur le même sol ; fournissant un aliment à la
thèse de la lutte des classes chère aux socialistes, qui en trouvent
d’ailleurs la démonstration dans la grande étude du jeune Engels
sur la Situation de la classe laborieuse en Angleterre (1845). En fait, le prolétariat
est loin d’être uniforme : des enfers comme Manchester se comparent
mal à des centres plus anciens comme Bradford. Mais il faut attendre la
seconde moitié du siècle pour connaître des efforts, d’abord
très localisés, d’urbanisme, d’adduction d’eau, de drainage, plus
longtemps encore pour voir livrer, à la fin de la période, la guerre
aux taudis et aux quartiers insalubres... sans d’ailleurs les éliminer !
L’indigence la plus crue guette constamment les victimes du chômage, de
l’âge, de l’invalidité, des crises cycliques ou accidentelles, comme
la « famine » (ou pénurie) du coton liée à l’arrêt
des exportations américaines pendant la guerre de Sécession. À la
fin du siècle, à Londres, Charles Booth, à York, Seebohm Rowntree
fixent, au prix d’enquêtes sociologiques de valeur, à un quart ou
un tiers la proportion des citadins vivant sur une « frontière
d’indigence » et constamment menacés de devoir recourir à la
cruelle assistance publique. La progression du revenu national, les lois sociales,
la croissance des salaires réels, les efforts éducatifs, surtout
dans la période 1870-1890 qui voit naître l’enseignement primaire
obligatoire (et gratuit en 1891), contribuent à des améliorations
certaines, d’autant que le coût de denrées essentielles est en nette
régression et que le commerce concurrentiel contribue à l’abaissement
des prix en fin de siècle. Voilà qui explique la « socialisation » de
la classe ouvrière, son souci croissant de « respectabilité » dans
l’imitation des classes riches. Mais les poches sombres sont nombreuses :
les immigrants, irlandais puis juifs orientaux, regroupés dans des ghettos
sociaux, les chômeurs sont des crève-la-faim, les jeunes et les
femmes font toujours l’objet de discriminations injustifiées dans l’emploi
et les salaires. Les marginaux sont nombreux : une classe criminelle se
développe malgré le renforcement des polices (la police métropolitaine
de Londres est née en 1829), des pickpockets aux grands meurtriers (Jack l’Éventreur
en 1888) en passant par l’immense société des prostituées
de tous étages. Le « vice » semble partout présent,
dont s’effrayent, parfois avec hypocrisie, de bons bourgeois par ailleurs fort
attirés par des plaisirs interdits ou des fréquentations douteuses ;
si aucune loi durable ne peut être dirigée contre les prostituées
(une loi de 1869 est annulée en 1885), l’homosexualité, pour la
première fois définie dans le vocabulaire anglais sous ce nom vers
1870, fait l’objet de textes sévères, dont Oscar Wilde, condamné à deux
ans de travaux forcés
en
1895,
fait
les
frais.
Les
classes
moyennes
se
développent, elles aussi avec des strates nombreuses,
mais marquées par un état d’esprit et un système de valeurs :
l’exaltation du travail, du mérite individuel, ou self-help, comme instrument
de promotion dans le société, de la famille, de l’ardeur patriotique ;
s’y ajoutent des signes d’appartenance à la classe, très particulièrement
l’emploi d’un nombre donné de domestiques, l’apparence de l’appartement
ou de la maison, le vêtement strict. La fin de la période a été celle
de la croissance de la petite bourgeoisie des boutiquiers et de leur monde d’employés.
Quelque 10 p. 100 des Anglais peuvent prétendre appartenir à la « meilleure
espèce », expression que le darwinisme social en honneur à partir
des années 1880 ne rend pas innocente. La haute bourgeoisie de la Cité,
des armateurs, des négociants au lointain tend à singer les modes
de vie aristocratiques, à mesure d’ailleurs que ses plus jeunes générations,
passées par des public schools de réputation (Eton, Harrow, Rugby),
s’y sont frottées à des camarades de la classe supérieure,
dans l’acquisition des traits désormais les plus honorés :
la fermeté de caractère, le sens de l’amitié virile, le
fair-play, le goût du loisir et des sports, un certain dédain de
la technique et de la recherche au bénéfice de la culture classique
et des belles-lettres, le sens de la grandeur impériale du Royaume-Uni,
l’espérance d’une résidence campagnarde qui précéderait
ou couronnerait l’ascension de la pairie grâce aux critères de nomination
de nouveaux lords. Dans la dernière décennie du siècle,
on évoque les « barons de la bière », les
beer barons (jeu de mot sur peers, pairs) en pensant à Guiness fait lord
Iveagh !
La
solidité des structures sociales tient en particulier à la persistance
d’un sentiment répandu de « déférence » dans
les classes « inférieures » à l’égard
des « meilleurs », « faits pour gouverner ».
Les syndicats, dont la puissance existait dès 1862 (plus de 200 000 adhérents),
davantage en 1874 (près d’un million et demi) et qui, en 1868, ont créé la
Confédération intersyndicale (T.U.C., ou Trades Union Congress),
se sont gardés d’adopter un ton révolutionnaire : abandonnant
rapidement la Ire Internationale, fondée à Londres en 1864,
jouant le double rôle de mutuelles et d’organismes de défense, ils
ont cherché longtemps à tirer parti des bénéfices
du capitalisme ; leur conversion à des revendications socialisantes
est postérieure à 1888-1889, leur virulence demeure limitée
et il faut attendre 1900 pour voir la majorité du T.U.C. se prononcer
pour la fédération
avec
les
partis
socialistes
qui
donnera
naissance
au
travaillisme
contemporain.
La vie de l’esprit
La religion continue
d’apparaître comme un bon ciment de la société.
En 1851, le seul recensement de la pratique jamais tenté au monde a démontré la
déchristianisation d’une moitié de la population, parfois des trois
quarts dans les centres industriels et les grandes villes. D’énormes efforts,
constructions d’églises et de temples, évangélisation en
plein air, dont la nouvelle Armée du salut créée sous ce
nom en 1878 par l’ancien méthodiste William Booth, son premier général,
se fait une spécialité, propagande de tous les instants et partout
n’y ont rien fait. Seuls les catholiques, dont les rangs sont, pour 80 %,
alimentés d’immigrants irlandais, ont mieux résisté au choc
de la société industrielle. Mais la religiosité demeure
quand la pratique a fléchi, l’école est l’une des voies d’un endoctrinement
moral fondé sur les principes traditionnels, l’absence de tout anticléricalisme
favorise la préservation de grands fondements de la foi. Les intellectuels
sont parfois touchés par une grâce nouvelle, que favorise par exemple
le mouvement d’Oxford des années 1830, qui conduit les uns vers le retour à Rome,
d’autres vers l’« anglo-catholicisme » au sein de l’Église
d’Angleterre ; dans les vingt dernières années du siècle,
le modernisme cherche à retenir les convaincus des nouvelles thèses
scientifiques et de la critique biblique. Le conformisme religieux est toujours
le souci des élites et sa nécessité emporte
bien
des
convictions.
Certains élans religieux ont, en tout cas, déterminé la
recherche du beau dans l’architecture des nouveaux temples, souvent inspirés,
comme des bâtiments civils d’un esprit néo-gothique ; ils se
retrouvent aussi dans les œuvres d’une école de peinture des plus originales :
succédant à des maîtres académiques ou, au contraire,
emportés, à l’exemple de Turner, sur les ailes du romantisme le
plus génial, les préraphaélites entendent revenir, sous
la houlette de Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, Edward Burne-Jones,
William Holman Hunt, Ford Maddox Brown, à des modes de représentation
prémoderne au service de grands thèmes mythiques, bibliques et
aussi sociaux. C’est une partie du grand élan esthétique rêvé par
le critique John Ruskin et par le poète-artiste-industriel William Morris.
L’époque victorienne est ainsi un grand siècle de l’esprit, également
visible dans une littérature marquée par l’« âge
d’or » du roman (Disraeli, les sœurs Brontë, Charles Dickens,
William Thackeray), une belle veine poétique (Alfred Tennyson,
les Rossetti, Oscar Wilde, par ailleurs brillant dramaturge), la qualité des
penseurs comme les John Stuart Mill, Thomas Carlyle, Walter Bagehot, celle des
hommes de théâtre, dont G. B. Shaw. Il faudrait citer trop
de noms ou encourir le ridicule d’oublis majeurs. Faisons un sort particulier à Rudyard
Kipling, qui a publié en 1894-1895 ses Livres de la jungle et fixe à l’imagination
et à la force de caractère des Anglais des bornes nouvelles, et à Lewis Carroll
dont l’Alice de 1865 a ouvert la voie du fantastique contemporain et frayé le
chemin à une myriade d’interprètes de ses récits, dont les
psychanalystes ne forment pas aujourd’hui la moindre cohorte. Si William Morris
s’effraye de la laideur des monuments, des gares, des églises, s’il juge
aussi incompatibles vie ouvrière et acquisition du sens esthétique
et fait de sa révolte le fondement de son adhésion au socialisme,
les victoriens n’ont pas partagé toutes ses condamnations et la postérité a
considéré le temps de Victoria comme celui d’une floraison intellectuelle
difficilement égalable.
L’Angleterre édouardienne
Prolongée jusqu’en 1914 par les premières années du règne
de George V , l’Angleterre édouardienne tire son nom du bref règne
d’Édouard VII (1901-1910) . Elle correspond à la Belle Époque
en France, impression de l’après-guerre, mais qui tient aussi à la
relève, sur le trône, d’une reine vieille et moralisante par un
souverain renommé pour son goût des plaisirs et des loisirs. Ses
sujets ont de fait connu, dans le début du XXe siècle, les
joies du music-hall, alors à son apogée, l’essor des sports professionnels
de masse, l’âge premier de l’automobile et de la bicyclette, les joies
de la lecture avec l’étonnante croissance de la presse populaire à sensation, à quoi
s’ajoutent les effets sans cesse plus visibles de la révolution commerciale
interne. Sur beaucoup de points, les tendances antérieures se prolongent.
Les libéraux « radicaux » sont parvenus au pouvoir
en 1906, en partie grâce à leur foi libre-échangiste. La
démocratisation continue, marquée en 1911 par la loi sur le Parlement,
qui réduit singulièrement le pouvoir des Lords, dont le veto sur
les lois non financières n’est plus que de deux ans (un mois pour les
lois de finance) ; le même texte instaure l’indemnité parlementaire
et fixe à cinq ans la durée maximale d’une Chambre des communes.
Par contre, le Parti libéral au pouvoir refuse d’aller plus loin et, malgré les
violences des suffragettes dirigées par Emmeline Pankhurst, n’accorde
pas aux femmes l’égalité civique. Le socialisme d’État brille
de ses plus beaux feux, avec les grandes lois sur la journée de huit heures
dans les mines, sur les pensions de vieillesse et surtout, en 1911, sur les assurances
nationales dans le secteur industriel exigeant une participation croissante du
Trésor, d’où le budget « du peuple » de 1909
présenté par Lloyd George, prévoyant une modeste progressivité de
l’impôt sur le revenu (instauré en 1842) ; il est repoussé par
les lords, pour leur malheur. Ces innovations entendent satisfaire un Parti travailliste
né en 1906, encore très minoritaire, et retenir certains syndicats
sur la pente du syndicalisme révolutionnaire prôné par Tom Mann ;
sans toujours y parvenir, comme le démontrent les grandes grèves
de 1911-1913 dans les transports et les chemins de fer. L’inquiétude règne
après l’euphorie de la victoire sur les Boers de 1902. Dans un monde de
plus en plus agité de rivalités, l’heure est aux alliances, ou,
au moins, à la recherche d’accords de défense ; en 1902, on
a signé un traité avec le Japon, en 1904, en partie grâce à l’appui
d’Édouard VII, on parvient à l’Entente cordiale avec la France,
en 1907 à une réconciliation avec la Russie. L’Allemagne, avec
laquelle on a un temps cherché un rapprochement, se range de plus en plus
au rang d’adversaire principal, d’autant qu’elle contraint le Royaume-Uni à une
ruineuse course aux armements navals ; l’empire, gigantesque, paraît
plus difficile à protéger, et on évolue vers la recherche
de liens plus solidaires avec les grandes dépendances de peuplement européen :
sur le modèle
du
dominion
canadien,
créé en 1867 déjà, on accorde
le statut de dominion, c’est-à-dire une pleine souveraineté interne, à l’Australie, à la
Nouvelle-Zélande, à la jeune Union sud-africaine, on donne un caractère
périodique à des conférences « coloniales » puis « impériales » réunissant
les Premiers ministres du Royaume-Uni et des dominions, on s’efforce d’obtenir
la promesse d’appuis plus déterminés à la défense
de l’empire. On ne va pas jusqu’à décoloniser où que ce
soit ; et, très particulièrement, en Inde, le mouvement du
Congrès, né en 1885, d’abord très modéré,
se radicalise sous l’impulsion de Tilak, de même que la Ligue musulmane
n’exclut pas un recours à la violence. Celle-ci menace toujours en Irlande,
bien qu’en 1912 le Premier ministre Herbert Asquith réussisse à faire
voter un Home Rule que le veto des lords empêche d’être appliqué dans
l’immédiat ; mais c’est l’Ulster protestant qui menace, par « loyalisme »,
de s’opposer éventuellement par les armes à toute concession globale à l’île
d’Érin. Auquel cas, l’armée ne serait pas sûre !
La
guerre
touche
un
pays
certes
diminué en comparaison de 1870, mais toujours
fort puissant, économiquement à la traîne, mais grand « banquier
du monde », et dont la flotte incomparable paraît garantir la
sécurité et l’approvisionnement. La décision de 1914 résulte
des engagements pris, de la conscience de l’impossibilité de laisser écraser
France et Russie, et, directement, de la violation de la neutralité belge,
dont la Grande-Bretagne était une garante depuis 1834 et qui lui paraissait
une condition de sa propre sécurité. Les protestations pacifistes
ou socialistes furent très limitées : l’union sacrée
s’imposa même au socialiste révolutionnaire Hyndman, sans englober
toutefois le scrupuleux chef du Parti travailliste, Ramsay MacDonald, obligé d’abandonner
provisoirement, de ce fait, sa position à la tête
de
son
parti.
Le siècle de la guerre totale
De 1914 à 1945, la Grande-Bretagne est entrée dans l’âge de la guerre totale. La Grande Guerre avait déjà conduit au combat cinq millions de soldats, marins, aviateurs et entraîné une énorme mobilisation de main-d’œuvre et de moyens à l’intérieur ; la guerre de 1939-1945, aussi exigeante en combattants, a obligé à soumettre la population civile à des règles d’emploi et à des déplacements contraints de main-d’œuvre qui ont transformé la population active en une véritable armée du travail entre les mains d’un ministre, Ernest Bevin, qualifié de « dictateur du travail ». Les pertes humaines ont été considérables : sept cent mille tués britanniques sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale (et plus de 200 000 soldats de l’Empire) ; plus de quatre cent mille morts au combat entre 1939 et 1945. Chiffres auxquels il convient à chaque fois d’ajouter des blessés graves, succombant parfois quelque temps après, et aussi, pour apprécier l’effet démographique, le déficit des naissances entraîné par la rupture de la vie familiale et les retards au mariage non compensés ; on avait ainsi estimé à deux millions les pertes réelles en métropole de 1914-1918. Les ruines matérielles ont été fort lourdes. Le territoire britannique est relativement épargné pendant la Grande Guerre : il s’est agi alors des pertes en bateaux, du coût financier et de l’endettement, de l’épuisement de machines industrielles, de la disparition de marchés traditionnels, de l’impossibilité de récupérer certains avoirs et investissements, en particulier dans la Russie révolutionnaire. La Seconde Guerre mondiale, qui a connu les mêmes charges, leur a ajouté les énormes destructions provoquées par les bombardements et qu’on a estimées par exemple au tiers du parc des logements et à une proportion similaire des infrastructures ferroviaires ou industrielles. Appauvrissement relatif et déclin de puissance mondiale ne pouvaient que s’ensuivre, même si l’illusion impériale, dans l’entre-deux-guerres, et la victoire dans chacun des conflits ont retardé les prises de conscience. Même si, d’autre part, chaque guerre s’est accompagnée d’un énorme effort de création d’entreprises nouvelles, d’inventivité, et si on a assisté à de véritables bonds en avant technologiques dans les secteurs les plus neufs. Il convient aussi de souligner à cet endroit le traumatisme psychologique considérable, pour les individus comme pour la nation dans son entier, créé par la cruauté des événements et des deuils, et qu’a complété le désir de compensations de toutes sortes, de facilités nouvelles de vie après les guerres : d’une sécurité accrue pour les moins favorisés aux loisirs les plus diversifiés pour tous, dans un esprit de libération des mœurs et de reniement de vieilles valeurs que l’on considère dépassées.
Le bilan de la Grande Guerre
En 1918-1919, les pessimistes sont encore rares. La famille royale, qui a adopté en 1917 le nom de Windsor, est très populaire. Au pouvoir depuis la fin de 1916, David Lloyd George est à la tête d’une coalition parlementaire et gouvernementale regroupant les conservateurs et ceux des libéraux, fidèles à sa personne, qui ne reconnaissent plus la légitimité d’Asquith. En juillet 1918, on a modifié le régime en accordant enfin le droit de vote à tous les hommes de vingt et un ans et plus, ainsi qu’aux femmes à partir de trente ans. En décembre, le nouveau corps électoral, sous l’impression de la victoire, a fait un triomphe aux bénéficiaires de l’investiture de Lloyd George (coupon elections). Celui-ci, fort de l’appui de sa nation, a négocié à Versailles les meilleures conditions possibles de paix, obtenant des dépouilles coloniales allemandes une part considérable de l’ancien Moyen-Orient ottoman, un quart des futures réparations allemandes et, au bénéfice de chacun des dominions, un siège à la Société des Nations. À l’intérieur, où le Parti travailliste s’est doté de sa « constitution » définitive, des transferts de fidélité libérale se font à son profit comme à celui des conservateurs (Churchill n’accomplit ce pas qu’en 1924). Un boom économique, bénéfique aux constructions navales notamment, dissimule la profondeur des difficultés à venir, limitées par ailleurs par la préservation quelque temps des contrôles gouvernementaux dans les mines de charbon et des prix garantis aux agriculteurs.
Les années 1920
En
Angleterre,
comme
ailleurs,
les
années 1920 ont été des
années « folles ». Les femmes sont émancipées
dans leur comportement en société avant de recevoir, en 1928, la
pleine égalité de droits électoraux avec les hommes. Des
loisirs nouveaux pimentent la vie, ainsi le cinéma, les palais de la danse,
les grands spectacles sportifs, qui justifient par exemple la construction d’un
stade de cent mille places à Wembley en 1926. La protection sociale est étendue
par une série de lois successives, en particulier les allocations de chômage
qui, en fin de période, sont versées pendant douze mois aux ayants
droit. L’activité économique s’accélère, procurant
au pays un taux de croissance industrielle supérieur à 2 p. 100
par an en moyenne ; l’Angleterre « verte » s’industrialise :
raffineries de pétrole, usines pétrochimiques, industries électriques,
automobile y prospèrent. L’électrification des entreprises garantit
d’importants gains de productivité. La Cité retrouve son rôle
de grande place financière internationale et, en 1925, le chancelier de
l’Échiquier Winston Churchill peut faire adopter le Gold Standard
Act qui, rétablissant partiellement la convertibilité en or de
la livre, rend à la monnaie britannique sa parité d’avant guerre
avec le dollar américain. De nouvelles chaînes de magasins se développent
– ainsi Marks & Spencer à partir de 1928 –, les activités
de service sont en plein essor. La prospérité est sélective :
les grandes industries traditionnelles du charbon, des constructions navales,
des cotonnades stagnent ou périclitent, condamnant des régions
entières de l’Angleterre « noire » au marasme, conduisant
10 % de la population active, en moyenne, au chômage, semant
les ferments du désespoir dans le sud du pays de Galles, le centre de
l’Écosse, le Lancashire. Dans les campagnes, aux aristocrates et grands
propriétaires appauvris par les impôts sur le revenu et les droits
successoraux, l’euphorie des fermiers, qui leur rachètent, en six ans,
près d’un quart de l’Angleterre, le cède bientôt aux souffrances
d’un endettement excessif dans un temps de baisse des prix agricoles après
la suppression des garanties gouvernementales. Une fraction de la société ne
profite pas du développement : d’où des crises graves en 1921-1922
et surtout en mai 1926, quand une grève « nationale » ou « générale » de
neuf jours paraît mettre en péril la nation elle-même !
Politiquement,
ces
années voient la grande relève du Parti libéral
par le Parti travailliste : à partir de décembre 1923, celui-ci
est le deuxième parti de gouvernement, Ramsay MacDonald devenant en janvier
1924, pour moins de dix mois, le premier Premier ministre de son parti, malgré une
position minoritaire au Parlement ; en 1929, sans avoir la majorité absolue,
le Labour Party n’en devient pas moins le plus nombreux au Parlement, et Ramsay
MacDonald est derechef rappelé au 10, Downing Street. La vigueur
du Parti travailliste explique sans doute dans une certaine mesure l’échec
complet du jeune Parti communiste constitué en 1921 : ce qui n’exclut
pas une grande peur « du rouge », des accusations systématiques
de « cryptocommunisme » contre le Labour Party, en particulier
en 1924 où un faux aujourd’hui notoire, la lettre Zinoviev, prétendument
signée du président de l’Internationale communiste, et attestant
de la réalité de la menace révolutionnaire en Grande-Bretagne,
sert d’argument de poids à la campagne électorale du Parti conservateur.
Plus positivement, la relève politique ne s’accompagne d’aucune remise
en question du système
de
la
monarchie
parlementaire.
L’empire évolue. Pendant que l’Irak devient un protectorat de fait et
la Transjordanie, création artificielle, un mandat solidement contrôlé,
qu’on se consolide en Palestine , qu’on refuse en Inde de tenir les promesses
de 1917, on fait évoluer les dominions vers une pleine souveraineté internationale.
En 1926, la conférence impériale adopte la définition de
la commission Balfour d’un Commonwealth de nations britanniques égales
en statut et unies par leur commune allégeance à la Couronne ;
et, cinq ans plus tard, le Parlement peut l’inclure dans le statut de Westminster
(1931). Cette position juridique est aussi celle d’une fraction de l’Irlande :
les vingt-six comtés de l’« État libre »,
détaché de l’ensemble par l’accord de décembre 1921
qui
a,
ipso
facto,
maintenu
l’Ulster
au
sein
du
Royaume-Uni.
La
position
mondiale
de
la
Grande-Bretagne,
quoique
diminuée, demeure
exceptionnelle. Elle constitue avec la France, en l’absence des États-Unis,
l’un des deux piliers essentiels de la Société des Nations. Elle
s’efforce, en Europe, de jouer les honnêtes courtiers, au prix d’un refroidissement
des relations avec la France, dans le but d’une réinsertion de l’Allemagne
dans la communauté des nations et de la restauration de la prospérité générale :
en 1925, le pacte de Locarno, grâce à la garantie britannique de
toutes les frontières à l’ouest de l’Europe, dégèle
la situation et permet, l’année suivante, de faire entrer l’Allemagne à la
S.D.N. Les Britanniques ont aussi favorisé la mise sur pied de règlements
de réparations plus étalés et moins exigeants, en 1924 (plan
Dawes) et en 1929 (plan Young). Dans le Pacifique, l’Angleterre a dû renoncer à poursuivre,
en 1921-1922, son alliance avec le Japon, de façon à inclure les États-Unis
(accords de Washington, 1922) dans un vaste ensemble international de garanties
apportées à l’intégrité chinoise et à un système
de parités fixes entre les flottes de haute mer ; ce qui équivalait à laisser
aux Américains la police du Pacifique ! Ouvert très tôt à la
reprise de relations commerciales avec la Russie bolchevique, après quelques
velléités d’intervention armée contre-révolutionnaire,
le Royaume-Uni reconnaît le premier l’U.R.S.S. en 1924... mais rompt avec
elle en 1927. Reflet du pacifisme de l’opinion publique, la diplomatie britannique
joue partout en faveur de la paix, incitant à l’ouverture d’une conférence
du désarmement sous l’égide de la S.D.N. (elle s’ouvre en fait
en 1932), participant en 1928 au pacte Briand-Kellog de mise hors la loi de la
guerre ; les budgets militaires diminués attestent à la fois
des incapacités matérielles et une volonté politique.
Les années 1930
Dans
la
mémoire collective, les années 1930 constituent les années « sombres »,
années noires de dépression économique, de crise sociale,
de démission
internationale.
La
crise économique, née en 1929 aux États-Unis, frappe
l’Angleterre de plein fouet en 1931, menant en juillet à une panique financière.
Elle est marquée par une crise commerciale, par la diminution, parfois
de moitié, de la production industrielle, par un chômage qui frappe
au moins trois millions de Britanniques en 1932, par la souffrance des régions
déjà victimes du déclin au cours de la décennie précédente.
Elle dure au moins jusqu’en 1935 et a paru appeler, pour la combattre, un gouvernement
d’Union nationale que Ramsay MacDonald constitue le 24 août 1931 contre
la majorité de son propre parti qui le qualifie de « déserteur » .
Le très bas prix des produits alimentaires et des matières premières,
auxquels la Grande-Bretagne n’applique pas de droits de douane, constitue pour
elle un fondement de son salut ; elle y ajoute une dévaluation monétaire
de l’ordre de 40 % en 1932 pour relancer ses exportations,
une stricte austérité budgétaire pour rétablir la confiance
dans la livre, le retour au protectionnisme abandonné en 1846, mais en
le nuançant par des accords de « préférence impériale » avec
son Empire (accords d’Ottawa, 1932) ; une vigoureuse politique de construction
de logements sociaux et privés, l’encouragement public à des opérations
de concentration de l’appareil productif, des garanties de prix accordées à l’agriculture
par l’intermédiaire d’offices fonciers, le dynamisme des secteurs de pointe
et une relance par la consommation (sans suivre pourtant les incitations de John
Maynard Keynes à une inflation contrôlée), obtenue par l’augmentation
du pouvoir d’acquérir des biens industriels et par l’arrivée à maturité de
l’arme publicitaire, ont constitué entre autres les conditions de relèvement.
Au total, les années 1930 auront connu, malgré la crise, un taux
de croissance moyen d’environ 3 % et certainement
démenti
les sombres prédictions d’observateurs étrangers comme André Siegfried
(« La Crise anglaise au XXe siècle », 1931)
sur l’incapacité paresseuse des dirigeants de l’économie britannique.
Guérie en 1935, celle-ci ne parvient pourtant pas à résorber
un important chômage, près de deux millions de victimes encore en
1937, année de la publication de la grande enquête de George Orwell,
La Route de Wigan Pier ; des régions entières demeurent sinistrées,
décrites par J. B. Priestley dans ses Voyages en Angleterre, et,
en Écosse et dans le pays de Galles, des mouvements nationalistes y trouvent
le prétexte de leur développement. La misère a été grande
parmi les chômeurs en fin de droits, humiliés par l’obligation de
s’adresser à l’Assistance publique et d’y subir un rigoureux examen de
toutes leurs ressources (Means Test) ; la « faim » a
provoqué en 1934 et en 1935 l’organisation de marches sur Londres. Les
gouvernants, Stanley Baldwin succédant à MacDonald en 1935
et cédant la place à Neville Chamberlain en 1937, n’ont jamais
accepté de prendre de grandes mesures sociales : c’est en 1938 seulement
qu’on instaure une semaine de congés payés. Même si, économiquement,
la politique suivie paraît efficace, si se trouve presque résolue
la terrible question du logement ouvrier, si des signes nouveaux de confort se
sont largement répandus, dont la radio dans 80 %
des foyers en 1938, les mentalités ouvrières ont été marquées
durablement par la vision d’un désastre
social.
Le
politique
reflète le trouble de l’économique. Le Parti travailliste,
victime de ses déchirements intérieurs, a été laminé aux élections
de 1931 et ne connaît qu’un début de redressement en 1935, même
si de nouveaux chefs, Clement Attlee, Stafford Cripps, Hugh Dalton, viennent
remplacer les anciens : à la fin de la période, la suggestion
d’un « Front populaire » avec les communistes, faite par
Stafford Cripps et Aneurin Bevan, conduit à des exclusions également
dommageables à l’unité et à l’image du parti. Sans effectuer
de véritable percée, le Parti communiste tente de profiter de la
situation, pratique à partir de 1935 une politique de « la
main tendue », essaye d’encadrer les chômeurs et de s’infiltrer
dans les syndicats, gonfle quelque peu des effectifs militants toujours inférieurs à la
trentaine de milliers. Plus sérieuse a paru un moment la menace fasciste.
D’abord appelée Nouveau Parti en 1931, une Union britannique des fascistes
a été créée par sir Oswald Mosley en 1932. Ancien
ministre travailliste en 1930 encore, un temps idole de la gauche du parti, remarquable
orateur, Mosley imite l’Italie, constitue des troupes de « chemises
noires », mène des actions violentes ; à partir
de 1934, séduit par Hitler, Mosley achève de donner un caractère
raciste et particulièrement antisémite à son mouvement et
consent à de véritables opérations de pogrome dans l’East
End londonien . Le mouvement ne compte guère plus de vingt mille membres.
Son dynamisme s’étiole quand la loi sur l’Ordre public de 1936 interdit
le port d’uniformes aux membres de tout parti politique et promulgue l’interdiction
de manifestations. Il ne peut guère prendre prétexte de la gravité d’une
crise qui se résorbe peu à peu ; il ne correspond pas à un
besoin pour des bourgeois que rassure la vigueur du Parti conservateur. Il n’ose
pas, en 1935, affronter le verdict des urnes ; il souffre de la douteuse
réputation des nazis et des fascistes du continent. Du coup, pendant que
les libéraux ne cessent de s’entre-déchirer entre partisans obstinés
du libre-échange et « nationaux », disposés à suivre
les principes de l’Union nationale, sans parler de la petite fraction des fidèles
du seul Lloyd George, les conservateurs apparaissent comme les grands bénéficiaires
de la période. Leur pragmatisme, leur compétence, leur efficacité leur
valent bien des ralliements, leurs chefs, de Stanley Baldwin, déjà Premier
ministre en 1923 et en 1924-1929, à Neville Chamberlain, fils de Joseph,
brillant responsable des Finances, jouissent d’une grande popularité ;
même si Winston Churchill, opposé à toute concession
aux nationalismes coloniaux, est mis alors sur la touche, réduit au rôle
de prophète de malheurs internationaux ou à celui, plus discuté,
d’« ami » du roi Édouard VIII, monté sur
le trône en 1936 et contraint l’année suivante à abdiquer
pour pouvoir épouser Mrs. Simpson.
La
politique étrangère constitue le domaine où l’adhésion
de la grande majorité des hommes politiques et de l’opinion a couvert
les erreurs les plus considérables. En partie sous la pression de la nécessité,
parce qu’une grande politique de réarmement a longtemps paru financièrement
suicidaire, surtout par l’effet de mauvais calculs, on a privilégié partout
et toujours la recherche du compromis, l’acceptation des coups de force, la résignation à la
révision de traités essentiels, le non-engagement militaire. En
1932, rien n’est fait pour empêcher le Japon d’annexer de facto le Mandchoukouo ;
en 1935-1936, l’opposition à la conquête italienne de l’Éthiopie,
pourtant accompagnée d’un embargo international sur certains produits
et du déploiement d’une force navale britannique importante en Méditerranée,
aboutit à un fiasco et à la reconnaissance de l’empire italien
d’Afrique en 1937 ; dans l’affaire de la Rhénanie en 1936, on déclare
hors de question toute intervention militaire contre une Allemagne dont on a
admis, dès 1935, le réarmement naval par un traité bilatéral
qui violait ouvertement le traité de Versailles ; la guerre d’Espagne
(1936-1939), qui est, en Grande-Bretagne, la grande affaire où partisans
et adversaires du fascisme se reconnaissent, mais où aussi les partisans
de l’ordre à tout prix privilégient l’injustice plutôt qu’un
gouvernement « rouge », est l’occasion pour Londres d’imposer à la
France la politique de non-intervention ; l’Anschluss de l’Autriche est
reconnu sans difficulté et, en 1938, Chamberlain, homme de l’appeasement,
devient celui, inoubliable, de Munich . Il faut attendre mars 1939 pour que le
gouvernement soit soudain saisi d’une fièvre de garanties à tous
les pays menacés par l’expansionnisme nazi, dont la Pologne, mais il demeure
si hésitant à l’idée d’une alliance avec l’U.R.S.S. que
celle-ci est poussée à préférer, en août, un
pacte avec l’Allemagne. Dans ce grand gâchis, on reconnaîtra la pression
de l’opinion publique, ultra-pacifiste (succès du « référendum
[privé] pour la paix » de 1935, organisation d’objecteurs de
conscience), une confiance naïve d’hommes civilisés dans les vertus
de la négociation raisonnable, le souvenir du cauchemar des tranchées
de 1914-1918, le refus du principal parti d’opposition, le Parti travailliste,
en avril 1939 encore, d’accepter même l’idée du service militaire
en temps de paix, la foi dans la S.D.N. Et on soulignera que l’Angleterre a pourtant
confirmé en 1936 sa détermination de s’en tenir au traité de
Locarno en cas d’agression contre la France ou la Belgique, qu’elle a commencé alors
son grand réarmement aérien, que sa politique, au printemps et
au cours de l’été de 1939, a été énergique.
Il n’en reste pas moins que le souvenir des échecs contribue jusqu’à nos
jours à ternir la réputation
des
dirigeants
d’avant
la
guerre.
Ceux-ci
avaient été plus sages dans leur politique impériale.
Après l’adoption du statut de Westminster en 1931, les accords d’Ottawa
de 1932, la constitution ultérieure d’une zone sterling (excluant le Canada),
ils ont pratiqué une politique de consultation systématique des
dominions ; seule l’Irlande du Sud de De Valera, qui a proclamé sa
neutralité en 1938, n’interviendra pas aux côtés de la métropole
en 1939. L’Inde a connu une conférence de la Table ronde à Londres,
de 1931 à 1935, mais le nouveau statut de 1935 ne donne pas satisfaction
aux nationalistes. Les Égyptiens qui, en 1936, signent avec l’Angleterre
une « alliance » ne se sentent pas moins vassalisés
qu’au temps, en 1914, où ils étaient devenus un protectorat du
Royaume-Uni. L’empire est pourtant solidement tenu en main et son loyalisme a
paru attesté lors des fêtes du couronnement de George VI
en
1937.
Démocratie décadente aux yeux d’un Hitler, en tout cas solide et
fière de libertés intérieures, rayonnant toujours sur le
monde par sa langue et sa civilisation, elle offre, dans l’entre-deux-guerres,
une floraison exceptionnelle de grands esprits, économistes comme J. M.
Keynes, romanciers comme Aldous Huxley, jeunes poètes comme Stephen Spender,
Cecil Day-Lewis, visionnaires sociaux comme George Orwell, héros
de l’empire comme T. E. Lawrence, auteur en 1926 des Sept Piliers de la
sagesse et prophète de l’alliance des peuples des sables et du peuple
de la mer, sans oublier la reine du roman policier, Agatha Christie !
La Grande-Bretagne a encore une grande fierté de son destin. Le vieillissement
de sa population, inexorable du fait de taux de natalité très bas,
la prévision des experts qu’il n’y aurait plus vers 1970 que vingt-cinq
ou trente millions de Britanniques nourrissaient cependant un pessimisme dont
Arnold Joseph Toynbee commençait à se
faire
le
porte-parole.
La Seconde Guerre mondiale
Dans
ces
conditions,
la
guerre
a
représenté un test suprême.
La Grande-Bretagne peut s’enorgueillir d’avoir résisté seule entre
l’armistice signé par le gouvernement Pétain, et appliqué le
25 juin 1940, et l’entrée en guerre de l’U.R.S.S., attaquée
par l’Allemagne un an plus tard. Les États-Unis ne participent officiellement
au conflit qu’après Pearl Harbor (7 décembre 1941). L’évacuation
de Dunkerque, parachevée les 2 et 3 juin 1940, a rassemblé la
nation dans un grand élan patriotique qu’a su incarner Churchill, devenu
Premier ministre d’un gouvernement de coalition, le 10 mai ; on a parlé de
l’« esprit de Dunkerque » pour signifier l’obligation d’une
solidarité totale dans la guerre comme dans l’avenir, une fois la paix
revenue. La bataille d’Angleterre a été gagnée grâce à la
qualité des avions britanniques et à l’héroïsme des équipages,
grâce aussi au radar et à l’erreur stratégique allemande
qui a consisté à substituer au bombardement des installations militaires
et des réseaux de communication celui de villes à terroriser .
En Afrique, en Asie, de durs revers ont précédé les renversements
décisifs, ainsi l’humiliante perte de Singapour devant les Japonais en
février 1942. Parmi les leçons les plus évidentes du
conflit : le rôle irremplaçable des États-Unis, qui,
après la loi cash and carry de 1939, ont permis aux démocraties
de s’approvisionner chez eux, après la loi « prêt-bail » de
mars 1941 ont permis au Royaume-Uni de poursuivre ses achats sans les payer,
ses caisses étant vides, et qui après leur entrée dans la
guerre ont remporté des victoires navales et terrestres décisives ;
c’est alors que naît l’esprit d’une « grande alliance » des
peuples anglo-saxons et le mythe de liens privilégiés entre Angleterre
et États-Unis. La guerre fait naître des espoirs et des programmes
pour ses lendemains, tels les deux rapports Beveridge, le plus célèbre
de 1942 sur les assurances sociales, et celui de 1944 sur « le plein-emploi
dans une société de liberté ». En 1945, vainqueur
quelque peu épuisé, le Royaume-Uni est heureux d’avoir pu compter
sur le soutien actif de l’Empire, malgré les réticences des nationalistes
hindous, les tentations d’opposition en Irak et en Égypte, la neutralité de
l’Eire. Le destin mondial d’une puissance qui a tenu sa place dans toutes les
grandes conférences, les dernières à Yalta et Potsdam (juill.-août),
paraît indiscutable à tous les responsables politiques et à la
haute
administration.
Entre
1945
et
1987,
la
Grande-Bretagne
a
dû progressivement se résigner à un
déclin mondial accompagné d’un repliement sur les îles métropolitaines,
et se mettre en quête d’un destin nouveau qu’elle a choisi européen. À l’intérieur,
elle a connu le développement d’un État providence, bénéficiaire
pendant longtemps d’un consensus entre les grandes forces politiques avant d’être
remis en question par les néo-libéraux.
L’État providence
Entre
1945
et
1951,
la
première période de l’après-guerre
coïncide avec une expérience socialiste. Portés au pouvoir, à leur
grande surprise et à celle de presque tous les experts, par les élections
de juillet, les travaillistes ont bénéficié, pour la première
fois, de majorités absolues au Parlement et ont pu tenter d’appliquer
un réel programme de gauche. Le même Premier ministre, Clement Attlee,
a gouverné pendant toutes ces années, se comportant volontiers
en chef d’une équipe dont les principaux membres se sont appelés
Ernest Bevin (aux Affaires étrangères jusqu’en 1950), Aneurin Bevan
(au Logement et à la Santé dans les premières années
décisives), Hugh Dalton et Stafford Cripps (successivement aux Finances),
Herbert Morrison, Hugh Gaitskell, étoile montante et dernier
chancelier de l’Échiquier. Ils ont eu à définir la place
du pays dans le système international, à affronter la première
décolonisation, à prendre la mesure de la guerre froide à partir
de 1947-1948, tout en s’efforçant de relever les ruines, de relancer l’économie
et de réaliser des réformes économiques et sociales fondamentales.
Tâches gigantesques qu’il n’a pas toujours été facile de
concilier. Tâches menées dans le strict respect des institutions :
les seules réformes dans ce domaine ont concerné les modalités électorales
en 1948, au prix d’un accord entre les partis, et, en 1949, une nouvelle réduction
du droit de veto des lords (désormais fixé à un an pour
les lois non financières).
La
nationalisation
d’une
partie
de
l’appareil économique s’est imposée
sans pourtant mettre en question l’appropriation privée des neuf dixièmes
de l’appareil de production et d’échanges : la Banque d’Angleterre,
et elle seule parmi les institutions bancaires, l’énergie (charbon-gaz-électricité),
les transports ferroviaires, aériens et le réseau routier, les
canaux sont passés sous contrôle de l’État après fixation
de généreuses indemnités aux anciens propriétaires
ou actionnaires, et pour des raisons économiques souvent évidentes ;
seule la dernière nationalisation, celle de la sidérurgie en 1950,
a paru « idéologique », compte tenu de la modernisation
déjà accomplie dans ce secteur. Le dirigisme a, d’autre part, été imposé,
des règlements et directives nombreux fixant des normes de production,
de répartition des matières premières ou des quantités
réservées à l’exportation notamment ; dans l’agriculture,
des aides fort considérables du Trésor public ont garanti la prospérité des « fermiers » ;
dans le cas du logement et de l’urbanisme, on a privilégié le rôle
des autorités locales et, les entraves bureaucratiques aidant, on n’a
guère pu achever plus de deux cent mille logements par an vers 1950-1951.
Les gains de productivité ont permis, la forte demande aidant, de ne pas
souffrir de la dilution extrême des tâches dans certaines entreprises,
source d’un suremploi, mais aussi condition du plein-emploi : le chômage
a été réduit à des taux incompressibles de l’ordre
de 1 à 1,5 %. Des grands pas en avant ont été accomplis
dans la réalisation d’un certain nombre de réformes sociales majeures :
service national de santé, voté en 1946, appliqué en juillet 1948,
et qui, outre la rationalisation du réseau d’hôpitaux, entraîne
la disparition de 95 % de la médecine libérale,
mais aussi, pour le patient, la gratuité des soins, des médicaments,
des prothèses et de tous les types d’appareillage ; assurances nationales
(1946) qui couvrent tous les accidents de la vie, « du berceau à la
tombe ». L’originalité de toutes les institutions nouvelles
est qu’elles ne sont pas sélectives et que toutes les classes de la société en
bénéficient également. Par ailleurs, la démocratisation
de l’enseignement, autorisée par la loi Butler de 1944 et par l’ouverture
de diverses filières secondaires au grand nombre, répond au souci
de l’égalité des chances et au rêve d’une « méritocratie »...
alors que, paradoxalement, on se garde de toucher aux grandes écoles privées,
les public schools. Tous ces efforts coûtent cher et le temps du travaillisme
est celui d’une énorme pression fiscale, qui paraît d’ailleurs l’instrument
d’une « révolution silencieuse » et d’un nivellement
de la société : illusion que toutes les recherches ultérieures
ont dénoncée. La livre sterling a dû être dévaluée
de 30 % en 1949. Les classes moyennes, découragées,
et où le parti avait trouvé d’indispensables soutiens électoraux,
se détachent du coup du pouvoir, pour qui les élections de 1950
sont un sévère avertissement, suivi d’une défaite en octobre 1951
lorsque Attlee veut forcer la chance et tenter d’arrondir sa majorité en
organisant une nouvelle consultation. La conciliation de la réforme sociale
avec le poids du réarmement, en effet, est devenue incertaine, on a commencé en
1951 à réduire certaines prestations de santé et la gauche
s’est divisée, l’aile la plus « rouge »,
avec
Bevan
et
Harold
Wilson,
abandonnant
le
gouvernement
pour
mieux
le
critiquer
et
créant
ainsi le trouble dans les esprits. Rien n’aurait été aussi facile,
relativement, sans une assistance américaine, d’abord bilatérale
(mission Keynes à la fin de 1946 et octroi en 1947 d’un énorme
prêt de Washington), puis par l’intermédiaire du plan Marshall.
Ce dernier, en accélérant la division de l’Europe entre Ouest et
Est, est en partie responsable de la guerre froide, des tensions qui mènent
au réarmement, et, fait révolutionnaire, de la recherche par les
Britanniques d’engagements militaires en temps de paix : après l’alliance
de Dunkerque avec la France en 1947, ils adhèrent à une Europe
occidentale à cinq en 1948 (pacte de Bruxelles) avant de s’intégrer à l’O.T.A.N.
en 1949. C’était reconnaître la nécessité de l’aide
américaine, et, bon gré mal gré, souscrire à un évident
déclassement de puissance, déjà manifesté en avril 1947
par la « cession » aux États-Unis de la charge d’aider
la Grèce
et
la
Turquie
contre
l’U.R.S.S.
L’empire
vacille
aussi
quelque
peu.
L’Inde
doit être divisée avant
de recevoir son indépendance de 1947 (Inde et Pakistan) , Ceylan suit,
précédant la Birmanie. Au Moyen-Orient, le mandat palestinien doit être
abandonné. L’Égypte obtient enfin une indépendance réelle.
En 1949, la substitution d’un Commonwealth des nations au Commonwealth « britannique » crée
un ensemble multiethnique et linguistique qui ménage à tout le
moins les chances de préserver une structure de cohabitation amicale entre
des parties de l’ex-empire, dont on admet qu’elles puissent être en même
temps des républiques (du coup, le souverain anglais n’est plus que le « chef » de
l’ensemble).
Malgré ces difficultés, la résolution anglaise de demeurer « un
grand » est entière. Elle s’affirme parfois à l’occasion
de gestes comme la reconnaissance, dès 1950, de la Chine populaire. Elle
se traduit en tout cas par le refus de faire quoi que ce soit pour prendre la
tête de l’unification européenne ou, à partir de 1950, pour
s’intégrer aux communautés dont l’idée est lancée
par la France (C.E.C.A., C.E.D.). Tout au plus admet-on la coopération économique
(O.E.C.E. en 1948) et la consultation sans danger (Conseil de l’Europe, 1949).
Malgré l’ardeur européenne de Churchill, président du mouvement
européen, rien ne laisse prévoir un changement de cap, que les
conservateurs, revenus au pouvoir en octobre 1951, se garderont bien de tenter.
Les Britanniques, privés en 1946 du libre accès aux recherches
atomiques américaines, ont décidé de se doter d’une bombe
nationale (et y parviendront dès 1952, trois ans après
l’U.R.S.S.).
Laboratoire
du
socialisme
démocratique, terre d’élection d’un puissant
syndicalisme, pays des libertés tranquillement assumées, la Grande-Bretagne,
qui n’a pas découragé la proclamation de la république en
Irlande du Sud en 1949, tout en faisant face à des actions violentes de
l’I.R.A. dans le Nord, représente encore, aux yeux des Européens
du continent, un havre respecté et envié.
Vers la société d’abondance
Entre
1951
et
1961,
les
nuages
s’accumulent
pendant
que
se
construit
pourtant
une
société de consommation promise à un bonheur que bien
des auteurs dénoncent comme illusoire. La Grande-Bretagne est revenue
sous la houlette des conservateurs. Trois Premiers ministres se succèdent :
Winston Churchill jusqu’en 1955, où il cède la place à Anthony
Eden qui, victime de l’échec de Suez et malade, doit démissionner
et trouve en Harold Macmillan, en janvier 1957, le maître d’œuvre
d’un nouveau départ. Le parti au pouvoir tire le plus grand profit de
sa sagesse : il sait adopter les grands principes de l’État providence
et continuer l’œuvre travailliste, il modère les privatisations en les
limitant aux seules entreprises de camionnage et à la sidérurgie ;
les tories bénéficient aussi du sentiment croissant de retour à la
prospérité : la reconstruction est considérée
comme achevée en 1951 ; Macmillan sait tirer l’industrie du logement
de son relatif marasme par un retour à l’initiative privée et, à partir
de 1957, par une politique de libération des loyers ; le rationnement
achève de mourir en 1954 et, avec lui, bien des contrôles administratifs ;
la croissance demeure forte malgré les à-coups infligés
par une surveillance attentive de la monnaie et une progression en dents de scie
que déterminent des phases de hausse et de baisse des taux d’intérêt
(stop and go). La consommation intérieure peut se diversifier ; on
entre dans l’âge de la diffusion de masse de l’automobile, des équipements
ménagers, de la télévision et, en 1959, le slogan électoral
du parti tory est « vous n’avez jamais été aussi bien ! » .
L’euphorie créée est souvent factice, les espoirs sont immenses
et l’optimisme certain. Les dividendes de la bonne situation socio-économique
sont tirés d’autant plus aisément que les travaillistes, éloignés
du pouvoir, connaissent de graves divisions internes : sur le réarmement
et les priorités, on connaît la dynamique campagne de Bevan et des
bévanistes contre la direction du parti ; sur l’arme atomique et
le principe d’un éventuel désarmement nucléaire unilatéral,
la gauche du mouvement se divise elle-même – Bevan est très
réticent, et les oppositions sont considérables entre 1957 et 1967 ;
la succession de Clement Attlee à la tête du parti s’est faite en
1955 au bénéfice de Hugh Gaitskell, un temps contesté par
les bévanistes avant la réconciliation plus ou moins sincère
des deux leaders en 1958. À l’extérieur, la position mondiale du
pays continue à reculer, alors même que le point de vue des dirigeants
sur la place de la Grande-Bretagne n’est pas modifié. L’Afrique peut encore être
tenue, au prix de sanglants événements au Kenya (1952-1955, guerre
des Mau-Mau) et de concessions immédiates au Ghana et au Nigeria à partir
de 1957. Le Moyen-Orient est le lieu le plus trouble : devant l’érosion
de leurs positions, les Britanniques évacuent dès 1956 les bases
de la zone de Suez (accord de 1954) et mènent une sévère
guerre économique contre l’Iran entre 1951 et 1954 pour aboutir à des
concessions majeures au nationalisme pétrolier et au partage de leur position
autrefois dominante ; le pacte de Bagdad dont ils essayent de faire l’équivalent,
sous leur égide, d’une O.T.A.N. de la région unit un temps Iran,
Irak, Turquie, mais s’écroule en 1958 avec la révolution irakienne ;
surtout, l’expédition
militaire
de
Suez,
déclenchée en novembre 1956 pour répondre, en coordination
avec la France et Israël, à la nationalisation du canal par Nasser
en juillet, tourne rapidement au désastre sous la pression des menaces
soviétiques et d’une spéculation américaine sur la livre
sterling. À cette occasion, le Royaume-Uni s’est aperçu qu’il n’était
plus un « géant » du monde. Il est de toute manière
ravalé à un rang second en Asie, ignoré quand les États-Unis
concluent une alliance avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande (Anzus),
leurs dominions, en 1952, intégré par une Alliance du Sud-Est asiatique
(1955) sans réelle consistance. Quelques réussites internationales
font illusion : la participation à la guerre de Corée, le
maintien d’une politique active à l’Est, où l’Union soviétique
tarde à prendre la mesure de la faiblesse diplomatique britannique, une
brillante contribution à la conférence de Genève de 1954
qui règle le sort de l’Indochine française, la solution du réarmement
allemand, après l’échec de la C.E.D., par l’intégration
de l’Allemagne à l’U.E.O. et des engagements précis de maintien
de la puissance anglaise sur le sol allemand ; peut-être aussi la
signature, à la fin de 1959, de la convention de Stockholm qui crée
l’Association européenne de libre-échange en groupant Grande-Bretagne,
Suède, Norvège,
Danemark,
Suisse,
Autriche
et
Portugal.
En
fait,
au
cours
de
la
décennie, la Grande-Bretagne s’entête à ne
pas revenir sur ses refus européens fondamentaux : quittant la conférence
de Messine (1955), tentant d’empêcher la signature, puis la ratification
du traité de Rome (1957), qui crée la C.E.E. et Euratom, les Britanniques
continuent de croire à la totale souveraineté de leur pays et à un
destin plus atlantique que continental. Les nuages s’accumulent en fin de période.
Ils sont en partie faits du constat amer, à partir de 1959, que l’État
providence a été loin de faire disparaître l’indigence, que
l’éducation pour tous n’a pas réellement créé l’égalité des
chances, que le Commonwealth, déchiré par des querelles internes,
n’est pas solidaire en cas de crise (ainsi à l’occasion de Suez) et que
les relations préférentielles avec l’empire sont en constante régression,
que le continent avance à un
rythme
bien
plus
rapide
que
l’Angleterre.
Le
règne d’Élisabeth II, inauguré en 1952, ne réussit
pas à évoquer les envolées de la dernière
souveraine Tudor. Ce qui n’incite d’ailleurs pas à un changement
de régime :
la seule réforme constitutionnelle importante, en 1959, est
la création
de « pairs à vie » qui ne donneront
pas naissance à de
nouvelles dynasties de lords. Concession faite au respect pour
les capacités
et grâce à laquelle une élite en place, à laquelle
on confère décisivement vers 1955-1959 l’appellation
d’Establishment, espère se perpétuer. Pourtant,
cette élite déplore
de trouver parmi les siens des traîtres à la patrie :
de grandes affaires d’espionnage, dont en 1952 l’affaire Burgess-MacLean,
en annoncent d’autres,
car on n’a pas encore déterré la « taupe » principale,
Philby , et des complices cachés comme l’historien
d’art Anthony Blunt.
Sans qu’il y ait de chasse aux sorcières, l’ère
de la suspicion existe. Cette suspicion pénètre
toutes les couches de la société.
Même le mouvement syndical, fort de plus de douze
millions d’adhérents,
n’y échappe pas. La peur du rouge sévit alors
que le Parti communiste britannique ne cesse de décliner
et connaît, après l’affaire
hongroise de 1956, des désertions massives, en
particulier d’intellectuels, comme la romancière
Doris Lessing. Une jeune génération
se reconnaît mal dans les satisfactions matérielles
de l’époque.
Les « jeunes hommes en colère » trouvent
en John Osborne,
auteur en 1956 d’une pièce à succès
Look Back in Anger, l’adversaire inspiré de
l’esprit
bourgeois.
L’âge des désillusions
Les
années 1960 ont été celles de bien des déceptions,
mais aussi de retournements significatifs et des progrès d’une conception
humaine des relations sociales. En annonçant, au Cap, en 1961, qu’« un
vent du changement » s’était levé sur l’Afrique, Harold Macmillan
entendait mettre ses auditeurs devant l’alternative de l’abandon de l’apartheid
ou du départ d’un Commonwealth dont l’élargissement était
conditionné par le respect de la liberté et des droits de l’homme.
La neuve « République » sud-africaine est issue
de la réponse de la minorité raciale blanche. Mais l’expression « vent
du changement » fait bientôt fortune et s’applique à d’autres
aspects
de
la
politique
britannique.
En
août 1961, le cabinet Macmillan décide de solliciter des Six
du Marché commun l’ouverture de négociations en vue d’une éventuelle
candidature de la Grande-Bretagne à la Communauté. Il s’agit en
fait, aux dires mêmes d’Edward Heath, chargé de mener les négociations à Bruxelles,
d’une première candidature et, si l’on en croit son discours de présentation
en novembre, du choix déterminé d’un destin européen. Seize
mois d’efforts butent en fait sur le veto français (conférence
de presse du général de Gaulle, le 14 janvier 1963, et suspension
effective sine die des négociations peu après) : l’Angleterre
n’a pas su choisir de sacrifier ses liens spéciaux avec les États-Unis
et a signé, en décembre 1962, les accords de Nassau, qui la
placent sous la dépendance des fournitures de fusées Polaris pour
l’équipement de ses sous-marins atomiques. Le pays avait cependant adopté la
voie nouvelle : le Parti conservateur avait soutenu le cabinet, les libéraux
s’affirmaient les champions de l’Europe unie, les travaillistes, plus réticents,
se laissant convaincre surtout après leur retour au pouvoir de 1964-1966.
Le Commonwealth, consulté, avait autorisé les négociations
en 1962. La Grande-Bretagne avait perçu d’ailleurs la diminution considérable
des échanges avec son ex-empire (30 % seulement
de ses exportations en 1966), elle avait pris conscience
de la lenteur de sa croissance
en comparaison des Six, de son déclin relatif, de la nécessité d’un
vaste marché continental pour rentabiliser ses innovations techniques,
du besoin de l’aiguillon de la concurrence pour stimuler la modernisation indispensable
de ses entreprises. Toujours éprise d’indépendance, elle pouvait
prendre acte de la disparition progressive du fédéralisme militant
dans les sphères du pouvoir, en particulier en France, et escompter une
Europe respectueuse des indépendances nationales. L’A.E.L.E. était
loin d’apporter l’équivalent de la C.E.E. La crise chronique de la livre
sterling, que découvre brutalement la dévaluation de 1967, exigeait
le resserrement des solidarités et permettait d’envisager un nouveau système
monétaire éventuel. De puissantes raisons en faveur de la candidature
expliquent le renouvellement de la tentative par Harold Wilson en 1967 :
le refus français de même entamer les négociations fait tout échouer
jusqu’en
1970.
La
conversion à l’Europe est aussi l’aveu de l’affaiblissement mondial.
Les deux géants ne s’embarrassent plus de trouver un intermédiaire,
et les États-Unis, de toute façon, sont davantage préoccupés
par l’Asie (guerre de Vietnam, Chine) que par le monde atlantique en ces temps
de coexistence pacifique. En 1967, le gouvernement Wilson doit prendre la décision
de retirer, au cours des années suivantes, les forces britanniques à l’est
de Suez : un effort militaire considérable, malgré la fin
du service obligatoire en 1960, ne suffit plus à assumer un rôle
déterminant sur toutes les mers du globe !
Nées dans la satisfaction du développement de la société de
consommation, les années 1960 ne démentent pas l’attente d’une « abondance » sans
cesse plus réelle. Mais les laissés-pour-compte sont de plus en
plus nombreux, quand l’économie ne progresse plus qu’au rythme de 2 %
par an en moyenne ; la modernisation inévitable rend illusoire le
maintien du plein-emploi, qui cesse d’être la doctrine du gouvernement
Wilson même si est affirmée la conviction d’y revenir ; la
concurrence sur le marché de la main-d’œuvre pose la question de l’immigration,
recherchée dans les années 1950, ressentie désormais comme
intolérable dans les milieux les plus divers : en 1962, la première
loi sur la limitation de l’entrée des immigrants en provenance du « nouveau
Commonwealth » est adoptée, elle s’exerce contre les immigrants
dits « de couleur », des Noirs des Antilles aux Pakistanais,
Indiens ou Asiatiques, tout comme à l’encontre de groupes ethniques opprimés
dans les nouveaux États indépendants d’Afrique noire anglophone.
L’indigence reconnue dément l’optimisme antérieur et frappe 7 %
de la population. L’enseignement paraît inadapté, on se hâte
de prévoir l’augmentation (modeste) du nombre des universités et
des étudiants, de construire des écoles techniques supérieures,
on en vient, à partir de 1965, à la conception de collège
secondaire unique pour garantir le même enseignement à tous. Les
résultats sont médiocres. Pendant que, dès 1968, le « powellisme » (du
nom de l’ancien ministre conservateur Enoch Powell) fustige les risques
de l’immigration de couleur et alimente en arguments un néo-fascisme renaissant
avec lequel il se refuse pourtant à se confondre, le ressentiment gagne
les régions les plus déshéritées. Le nationalisme écossais,
le gallois en retirent de premiers bénéfices politiques, surtout
lors d’élections partielles. Gênés dans leur œuvre de modernisation
par les rigidités de l’appareil industriel, les gouvernants dénoncent
les excès de la mainmise syndicale : Harold Wilson, bien que
travailliste, tente en vain d’élaborer un projet de loi antisyndicale.
Pourtant, les lumières ne sont pas absentes. L’État providence
reste vigoureux, même si, à la fin de la période, rompant
le pacte non écrit du consensus, le Parti conservateur, guidé par
Edward Heath qui en a pris la tête en 1965, brode sur les thèmes
de la nécessaire sélectivité des assistances publiques.
Le cabinet Wilson, pour sa part, a fait voter des dispositions nouvelles, en
particulier des allocations complémentaires qui devaient permettre aux
plus pauvres d’arriver à un minimum vital. L’humanisation de la société est à l’ordre
du jour : en 1968, une loi contre la discrimination raciale apporte de premières
garanties aux immigrés traumatisés par la campagne qui se développe
contre eux ; la répression fait place à la rééducation
et à la réinsertion dans le système pénal, et la
peine de mort, après une première période d’observation,
est définitivement abolie en 1969 ; la même année, dans
le domaine civil, une loi sur le divorce vient humaniser la vie de familles séparées
en instaurant la pratique du divorce par consentement mutuel ; deux ans
plus tôt, on a légalisé l’avortement et mis fin à la
pénalisation des actes homosexuels entre adultes consentants. Certains
dénoncent la « société permissive »,
quand d’autres exaltent la « société civilisée ».
La société britannique, dans un nivellement tout relatif, qu’a
renforcé en 1963 la loi sur la pairie autorisant des héritiers
de titres à les abandonner et à ne pas siéger à la
Chambre des lords, connaît un élan vers le bonheur que dénoncent
les censeurs de la « médiocrité ».
Le
désenchantement est naturellement visible dans le champ de la politique.
Les conservateurs ont mal terminé leur « règne » de
treize ans : Harold Macmillan, malade, mais victime indirecte du scandale
Profumo (relations entre son ministre de la Guerre et la maîtresse d’un
diplomate soviétique), a dû céder la place en 1963 à lord
Home, qui devient « sir Alec Douglas Home » en utilisant
la loi sur la pairie. Celui-ci, malgré ses mérites, subit une défaite
en 1964. Revenus au pouvoir avec Harold Wilson, les travaillistes sont,
aux yeux de leurs adversaires, des gestionnaires sans idéal : ils
s’en défendent en invoquant les thèmes de la modernité et
de la rénovation technique, ainsi que leur souci réel de justice
sociale. Les libéraux tentent de se refaire un visage attrayant, en particulier
en brandissant la bannière européenne. Pendant que la crise tchécoslovaque
accentue le déclin rapide du Parti communiste en 1968, la désaffection à l’égard
de la démocratie progresse, l’indifférence ou la révolte
frappent les jeunes. Le système n’est pas menacé, un nouvel élan
s’impose
manifestement.
De
1970 à 1979, on note un ébranlement considérable des
certitudes et des espoirs. L’Europe devient une réalité britannique.
En 1970, parvenu au pouvoir, le conservateur Edward Heath sait profiter
des bonnes dispositions des Six et de l’esprit d’ouverture du président
Pompidou . Une négociation relativement rapide aboutit en 1971 aux accords
de Luxembourg et, en janvier 1972, après ratification de la démarche
par le Parlement de Westminster, à la signature du traité d’accession à la
Communauté : son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier
suivant. Edward Heath a persuadé le Danemark, l’Irlande et (pour
peu de temps) la Norvège de l’accompagner dans son adhésion ;
il a obtenu des garanties pour certains membres du Commonwealth, une période
de cinq ans pour l’intégration effective, il s’est contenté de
faire des promesses quant au sort de la livre. Son œuvre est dénoncée
par les travaillistes : ceux-ci se font l’écho des consommateurs
qui craignent une hausse des prix alimentaires, des syndicats qui redoutent l’accroissement
du chômage et la concurrence de la main-d’œuvre étrangère,
des partisans de la souveraineté entière du Parlement, des nostalgiques
de la grandeur. Revenus aux affaires à la suite des deux élections
de février et d’octobre 1974, ils renégocient effectivement les
termes du traité, se contentent cependant de faibles aménagements
et, en juin 1975, organisent le premier référendum de l’histoire
britannique, après l’avoir proclamé « contraignant » dans
ses résultats ; ils obtiennent que les deux tiers des votants se
prononcent en faveur du maintien dans la Communauté. Ensuite, ils paralysent
quelque temps la définition de l’élection directe du Parlement
de la C.E.E., mais, au prix du choix pour le seul Royaume-Uni d’un mode de scrutin
uninominal à un tour, acceptent d’organiser en 1979 la première élection
de députés européens. L’Europe entre ainsi dans les faits,
sans rallier une majorité de
l’opinion
publique.
La
crise économique explique bien des préventions. Elle est antérieure à la
crise mondiale qui se développe à partir de 1973 et qui frappe
le pays, alors que sa monnaie est à la dérive (la livre est devenue
flottante en 1972), qu’une forte inflation est précipitée par une
politique de relance de la consommation, qu’une maladie chronique affecte de
nombreuses entreprises obsolètes. Le Marché commun n’est pas une
panacée. Le mécontentement social est à l’origine d’une
grave tension entre le gouvernement Heath et les syndicats à l’occasion
de la grève des mineurs de la fin de 1973, d’où les élections
anticipées de 1974. La gauche au pouvoir tente de gérer la situation
en attendant en particulier la manne du pétrole de la mer du Nord, aux
perspectives justement prometteuses, mais qui, en réalité, aidera
surtout le gouvernement Thatcher dans la période suivante. Un « contrat
social », négocié avec les syndicats par le cabinet
Callaghan, successeur du cabinet Wilson, aide à juguler l’inflation. Mais
le chômage progresse de 3,5 % de la population
vers 1973 à 6-7 %
en
1978.
Les
difficultés régionales ne peuvent que croître. En Écosse,
les nationalistes ont remporté, avec le tiers des voix, onze sièges
en octobre 1974 ; au pays de Galles, le Plaid Cymru a eu trois élus.
On essaye de composer avec eux, le gouvernement Callaghan propose la « dévolution » de
certains pouvoirs à des parlements locaux, mais les référendums
de 1979, dans l’une et l’autre région, échouent devant la coalition
des « loyalistes » et des extrémistes du nationalisme.
Le gouvernement, qui devait son maintien au soutien parlementaire des députés
des mouvements nationalistes, doit revenir aux urnes à la fin de mars 1979.
Au cours des années 1970, les troubles ne cessent de s’aggraver en Irlande
du Nord. L’État « protestant » d’Ulster avait semblé évoluer
vers une plus grande fraternité des communautés catholique et protestante,
mais le mouvement catholique des droits civiques s’est heurté en 1968 à une
répression violente. Des incidents sanglants ont suscité l’arbitrage
de la Grande-Bretagne et l’envoi de troupes anglaises dans l’île dès
1969. En 1972, le statut d’autonomie interne ne peut plus être maintenu
et une administration directe de Londres tente de trouver un compromis difficile
entre des revendications soutenues à présent avec violence par
l’I.R.A. et les refus farouches de nombreux dirigeants protestants. D’échec
en échec (dont celui de 1974 de constitution d’un gouvernement biconfessionnel
avec la bénédiction de l’Eire), l’Irlande du Nord s’enfonce dans
le terrorisme aveugle et la répression la plus déterminée.
L’impasse crée des impatiences inutiles, la crise économique rend
pénible le poids financier du maintien de l’ordre et évidente la
nécessité de développer l’économie locale pour garantir
plus de bien-être aux classes défavorisées,
qui
ne
sont
pas
toutes
catholiques.
Les
Britanniques
ont
le
sentiment
que
leur
destin
devient
très flou. Les
partis traditionnels en pâtissent en ralliant, lors des élections
générales, une proportion étonnamment réduite
des électeurs
(bien qu’encore supérieure aux trois quarts). On se plaint
d’une administration d’« amateurs distingués »,
sans craindre le paradoxe de s’en prendre aux « technocrates » que
tous les gouvernements s’efforcent d’introduire aux commandes des
entreprises publiques et aux postes
de commande de l’État. Le désarroi est le sentiment
dominant, il aboutit à des réactions xénophobes, à la
dénonciation
de la montée de la criminalité, à la diminution
de la natalité (tombée à moins
de 13 p. 1 000 en 1975), au souhait d’un « ordre » qu’exploite
le Front national néofasciste.
Du thatchérisme au « majorisme »
En
1979,
le
Parti
conservateur
revient
au
pouvoir,
sous
la
houlette
d’un
nouveau
leader : élue en 1975 contre l’ancien Premier ministre Edward Heath,
Margaret Thatcher est vite surnommée, avant même son arrivée
au 10, Downing Street, la Dame de fer. Elle n’a connu qu’une expérience
limitée aux sommets de l’exécutif (dans le cabinet Heath de 1970-1974,
elle fut ministre de l’Éducation et de la Science). Mais c’est une femme
de caractère, et qui propose à son parti et au pays une nouvelle
approche des problèmes. Initiée par ses plus proches conseillers,
sir Keith Joseph et Geoffrey Howe, aux principes de l’école de Chicago,
disciple de l’économiste Friedrich von Hayek, politiques elle entend réagir
contre les « excès » de l’État Providence,
renoncer aux coûteux soutiens budgétaires accordés à des « canards
boiteux » de l’industrie, accepter que le « dégraissage » de
l’appareil de production entraîne une croissance provisoire du chômage,
limiter au maximum les aides sociales, lutter contre l’emprise du pouvoir syndical.
Elle dénonce le « trop d’État », et veut
restaurer le goût de l’initiative et de la responsabilité individuelles
en revenant aux notions de profit et de self-help (« aide-toi toi-même »),
et en diminuant les charges fiscales sur les hauts revenus. Convaincue de la
nécessité d’une monnaie forte, elle compte imposer une stricte
discipline budgétaire, réduire la masse monétaire, couper
court rapidement à l’inflation. Animée d’un vif sentiment de la
grandeur nationale, elle ne renie pas les engagements européens, mais
flatte l’opinion en proclamant sa volonté d’obtenir « justice » sur
la question de la contribution britannique au budget communautaire et en obtenant
d’ailleurs de très importantes ristournes avant la mise sur pied d’un
système pleinement satisfaisant à partir de 1984. Elle sait aussi
tirer le maximum de profit, sur le plan politique, de la guerre des Malouines
(avril-juin 1982) ; celle-ci a opposé les Anglais aux Argentins débarqués
sur l’archipel, qu’ils considéraient comme une fraction de leur territoire
national. Son influence sur l’homme du commun lui inspire un populisme qui marie
des principes réactionnaires à quelques autres d’apparence plus
ouverte : elle entend transformer les Britanniques en une nation de « propriétaires » en
favorisant l’acquisition, par leurs occupants, des logements sociaux et en prônant
un capitalisme populaire à l’occasion de la privatisation de grandes sociétés
dont les actions sont vendues en Bourse ; elle se déclare attachée
aux valeurs religieuses et morales, alors qu’elle s’attire les foudres de plusieurs Églises,
dont l’Église anglicane, par son indifférence aux questions brûlantes
des quartiers défavorisés des grandes villes et de la pauvreté grandissante
de millions de ses concitoyens ; elle affirme être favorable « à la
loi et à l’ordre » (sans aller jusqu’à soutenir ouvertement
le rétablissement de la peine capitale). Elle allie ainsi le très
moderne esprit de libre entreprise et de respect de la loi des marchés à une
mentalité qui rappelle étrangement la haute époque
victorienne.
Le
Premier
ministre
a été longtemps servi par la chance. Elle bénéficie
pleinement jusqu’en 1986 de la rente pétrolière, qui s’accroît
avec l’exploitation de plus en plus poussée des gisements de la mer du
Nord, et ne diminue ensuite que par le fait de la baisse mondiale des cours de
l’or noir. Les privatisations de grandes entreprises deviennent de plus en plus
nombreuses : des aciéries aux télécommunications, du
gaz à l’aérospatiale, des compagnies aériennes à celles
des eaux, des pétroles à l’automobile ; cela vaut au Trésor
des rentrées « miraculeuses » (41 milliards de livres
de 1979 au printemps 1992, dont il faut défalquer le règlement
des dettes), et permet d’opérer sans crainte une progressive réforme
de la fiscalité : à partir de 1988, il n’y aura que deux tranches
pour l’imposition des revenus, 25 % et 40 %. Même
si on liquide ainsi l’« argenterie de la famille » (Harold
Macmillan), on fait de l’investissement dans le Royaume-Uni une possibilité et
un attrait : d’où l’afflux de capitaux étrangers, en particulier
arabes et japonais, qui, de même, contribuent à l’équilibre
des balances extérieures. L’ouverture des frontières, du côté de
l’Europe, mais aussi d’autres pays du monde, comporte l’inconvénient de
peser sur la balance commerciale, mais l’avantage de favoriser la baisse des
prix et de pouvoir mieux lutter contre l’inflation. La Cité, euphorique,
vend toujours mieux ses services bancaires et financiers, et se modernise en
opérant, avec la télématique, une révolution de ses
méthodes de gestion à partir du « big bang » du
27 octobre 1986. Même certains aspects négatifs ont eu leur
utilité : le chômage, qui culmine à 14 % en
1982, avant de baisser notablement ensuite, jusqu’à moins de 7 %
en 1989, entraîne une diminution des effectifs syndicaux, place les trade-unions
en position défensive, permet de faire accepter plus facilement les grandes
lois antisyndicales de 1980, 1982 et surtout 1984, et de s’attaquer de manière
décisive au monopole syndical d’embauche, d’interdire les grèves
de solidarité, d’imposer des délais avant le déclenchement
d’un mouvement et de saper ainsi considérablement l’un des grands obstacles
traditionnels au changement. La défaite des mineurs après une année
de grève, en 1984-1985 , en est l’éclatante démonstration.
Le « thatchérisme » devient peu à peu un
modèle, surtout lorsque ses résultats imposent le silence à certaines
critiques. Après trois années « floues »,
de 1979 à 1982, la croissance est au rendez-vous des années 1983-1988
avec une moyenne annuelle de 3,7 % pour le P.I.B. et 4,5 %
pour la productivité industrielle ; le Royaume-Uni est redevenu un « banquier
du monde », l’inflation a baissé (4 ou 5 %
en 1988 ; 3,7 % au début de 1992), le chômage tombe à 5,5
% en 1990. Malgré les perturbations des années 1988-1990,
l’élan semble donné, qui autorise Margaret Thatcher à parier,
en 1986, sur le Marché unique européen pour 1993 et la persuade,
en 1990, de corseter sa monnaie en la faisant entrer, à la demande du
chancelier de l’Échiquier, John Major, dans le système monétaire
européen.
Les
critiques
ne
manquent
pourtant
pas : sur la division du royaume entre
un Nord en constante difficulté et un Sud qui fait partie de l’Europe
de la prospérité, sur la « désindustrialisation »,
sur la croissante opposition entre riches et pauvres, le désarroi des
jeunes générations et des personnes âgées ; sur
la progression de la délinquance et de la criminalité, dans les
quartiers d’immigrés antillais, dans les centres les plus touchés
par la crise, mais aussi dans des groupes divers affectés par l’ennui
et le cynisme et qui alimentent le « hooliganisme », notamment
sur les stades ; sur l’aveuglement qui pousse à réduire les
autonomies locales et les capacités d’intervention d’autorités
proches du citoyen (suppression des gouvernements des grandes métropoles
en 1986), en limitant aussi leurs possibilités budgétaires :
l’instauration de 1989-1990 d’une nouvelle fiscalité locale fondée
sur le principe de l’égalité de tous les adultes, sans considération
de leurs revenus réels, devant une « capitation » (Poll
Tax) très lourde, a pour but avoué d’encourager une discipline
budgétaire et pour résultat une surimposition des plus défavorisés.
Reprises
par
les
partis
d’opposition,
mais
aussi
par
des
conservateurs
attachés à la
tradition disraélienne de socialisme d’État, ces critiques ont
surtout pour effet de figer Margaret Thatcher dans une personnalisation de plus
en plus excessive du pouvoir, qui lui fait écarter les « mous » de
son cabinet. Elle a contemplé la vaine montée d’un « tiers
parti » : la sécession de sociaux-démocrates qui,
en 1981, ont quitté le Labour Party pour fonder leur propre formation
et s’allier avec les libéraux a valu à l’Alliance un quart des
suffrages en 1983 et en 1987, mais fort peu de sièges. Elle a vu les travaillistes
empêtrés dans leur recherche d’un leader efficace (après
Michael Foot, de 1980 à 1983, Neil Kinnock doit peu à peu confirmer
ses qualités) et surtout dans la définition d’un programme que
la gauche du parti a trop dominé jusqu’en 1987 pour le rendre crédible.
Les victoires électorales de 1983, où a pu jouer un « effet
Malouines », et de 1987 ont, par contraste, composé l’image
d’un
Premier
ministre
d’exception.
Margaret
Thatcher,
qui,
en
1981,
a
laissé dix membres de l’I.R.A. mourir
dans leur prison d’une grève de la faim, n’a certes pas su résoudre
le problème irlandais, ni empêcher le terrorisme de gagner l’Angleterre,
où d’horribles attentats ont marqué les années 1980 – celui
de Brighton, en 1984, manquant coûter la vie au Premier ministre lui-même.
Mais, en 1985, elle a su saisir, par les accords de Hillsborough, la chance d’un
net rapprochement avec la république d’Irlande, rompant de fait avec la
pesante « amitié » des « loyalistes » protestants.
Faisant preuve d’un atlantisme sans faille, elle a resserré les relations
privilégiées entre Royaume-Uni et États-Unis : elle
refuse de limiter la modernisation des armes américaines dans son pays,
se plie aux vœux de croissance de son budget de la Défense et achète
aux Américains de nouveaux missiles Trident, appuie Washington dans son
expédition aérienne contre la Libye en 1986 comme dans la fermeté de
sa réaction à l’encontre de l’Irak lors de l’invasion du Koweït,
quatre ans plus tard. Elle y gagne une autorité internationale qui, sa
clairvoyance devant la perestroïka aidant, facilite le rapprochement entre
Mikhaïl Gorbatchev et les présidents Reagan et Bush. Européenne
par réalisme, elle a, dans son discours de Bruges de 1988, clairement
marqué les limites de son engagement. Elle a su préserver le Commonwealth,
revigoré par la solution de la question rhodésienne en 1979 et
l’entrée du Zimbabwe dans l’organisation (1980), secoué pourtant
par la mollesse de Londres devant les sanctions contre l’Afrique du Sud, mais
conforté par la conversion des dirigeants sud-africains au démantèlement
de l’apartheid à partir de 1989 et, la même année, par le
retour du Pakistan après dix-sept années d’absence. En Asie, en
1984, elle a consolidé ses rapports avec Pékin en signant l’accord
sur le retour de l’ensemble de la colonie et territoires à bail de Hong
Kong à la souveraineté chinoise
en
1997.
La
stature
de
Margaret
Thatcher
ne
prévient pas une chute que provoque
la montée de révoltes, en particulier contre la capitation
locale. Son parti ne l’ayant pas réélue à la
majorité qualifiée à son
poste de leader, elle démissionne le 22 novembre 1990
et cède
la place à celui qui est alors son favori, John Major.
Ce dernier, d’origine modeste, est bien davantage un chef d’équipe
que son prédécesseur.
Il est attaché aux mêmes principes généraux
de l’économie,
mais c’est un réaliste qui, très rapidement, fait
adopter une fiscalité locale
plus juste. Sa fermeté lors de la guerre du Golfe, le
retour à un
esprit plus « social », son action en
faveur d’une Europe communautaire dont il attend beaucoup,
la signature qu’il appose sur le traité de
Maastricht en prenant soin de ne pas approuver le volet social
des accords et de réserver les droits du Parlement
de Westminster avant tout passage à une
monnaie unique lui permettent d’affirmer sa personnalité.
En avril 1992, en remportant brillamment une élection
générale que les
augures avaient prévue désastreuse pour les
conservateurs, il obtient un clair mandat de la nation.
On commence alors à évoquer un « majorisme » qui,
au minimum, serait un thatchérisme « à visage
plus humain » et
plus internationaliste. La reprise de la crise, la montée
du chômage
jusqu’à plus de 10 %, l’orage financier de septembre
1992 l’obligent à dévaluer
de fait la livre en sortant du S.M.E. et en la laissant
flotter. Il donne des arguments aux adversaires du traité de
Maastricht, qu’il entend faire ratifier contre le vœu
de certains de ses amis « eurosceptiques » et
soulève des doutes sur sa réelle capacité à affronter
les tempêtes. Le majorisme devient déjà une
hypothèse
des
plus
floues.
L’agonie et la mort du majorisme
Pendant
cinq
années encore, John Major va demeurer au pouvoir, dans un
pays qui cesse peu à peu d’être l’homme malade de l’Europe. La sortie
du système monétaire européen a abouti à une dévaluation
de la livre, qui rend celle-ci compétitive par rapport aux autres monnaies
européennes. Favorisés par des prix un temps moins élevés,
commerce et industrie ont gagné des parts de marché non négligeables
par comparaison aux pays du continent européen. La livre elle-même
s’est peu à peu redressée jusqu’à retrouver, en 1997, ses
meilleurs niveaux antérieurs à la crise. La place financière
de Londres est la première en Europe. Le chômage, entre 1992 et
1996, a reculé de 2 674 000 à 2 158 000 individus, encore
que ces chiffres soient discutables. Par ailleurs, les investissements étrangers
autorisent parfois la création de nouvelles firmes, mais ils sont liés
aussi aux bas salaires relatifs des ouvriers britanniques par rapport à ceux
de leurs camarades européens. La pauvreté, elle, n’a pas reculé,
et l’augmentation des recettes publiques permet de faire face en priorité à de
nouvelles demandes d’assistance : de quatre millions et demi en 1991, on
est passé en 1996 à plus de cinq millions et demi de bénéficiaires
d’une assistance spécifique et, avec leurs dépendants, à plus
de 9 millions et demi, soit plus de 17 % de la population ;
proportion que certains observateurs jugent encore largement sous-évaluée
et qu’ils estimeraient à 25 %. En regard, il est aisé de
souligner le gonflement extraordinaire de certaines fortunes, d’origine parfois
spéculative. Plus que jamais, le pays semble celui de « deux
nations », les riches et les pauvres. Même si le budget de la
santé publique augmente de 4 % par an, en termes réels,
de 1992 à 1996, cela ne permet pas de mettre fin à de nombreuses
discriminations sociales et régionales.
Les
points
noirs
sont
nombreux.
Paradoxalement,
les
héritiers de Mme Thatcher
ont renoué avec une pression fiscale accrue (de l’ordre de 5 %
en moyenne) aux dépens de tous les types de ménages : au point
que la campagne électorale de 1997 sera une sorte de « monde à l’envers »,
les travaillistes, habituellement accusés d’être des dépensiers,
stigmatisent les vingt-deux augmentations d’impôts intervenues depuis 1992.
L’enseignement public recule, les conservateurs poussant de plus en plus à la
privatisation des écoles. Présentée comme un progrès,
la transformation des Polytechnics (comparables aux I.U.T. français) en
universités de plein exercice a mis en concurrence, pour des subsides
trop restreints, quatre-vingt-dix établissements d’enseignement supérieur
au lieu des quarante-quatre traditionnels. Surtout, l’enseignement supérieur
de masse, approchant les deux millions d’étudiants, a entraîné une
réduction substantielle des allocations d’études et les étudiants
sont contraints d’emprunter auprès de banques les compléments indispensables.
En matière de logement public, le cabinet Major a suivi la politique antérieure
de privatisation et de dévolution des constructions nouvelles à des
entreprises privées, et seules les catégories les plus pauvres
peuvent encore prétendre à un habitat à bon marché,
devenu le maillon le plus faible du système de l’État-providence.
L’Écosse continue de poser la question de son avenir dans le Royaume-Uni.
L’Ulster constitue toujours, sur les « marges celtiques »,
le problème majeur. Le cabinet Major n’est pourtant pas resté inactif.
Avec la déclaration de Downing Street en décembre 1993 et un accord
plus large en février 1995, il a associé étroitement la
république d’Irlande à la recherche d’une solution ; il n’a
pas exclu la participation du Sinn Fein à des négociations politiques
avec les autres partis irlandais, mais l’a liée à un arrêt
des actes de violence de l’I.R.A. : celle-ci y procède bien d’août
1994 à février 1996, mais refuse tout désarmement préalable à la
conclusion d’un accord. En novembre 1995 est mise sur pied une commission, présidée
par l’ancien sénateur américain George Mitchell, chargée
de définir les formes que pourrait prendre un désarmement progressif
de tous les groupes paramilitaires. En mai 1996, des élections à une
Assemblée nord-irlandaise inter-partis (destinées à désigner
les délégués aux négociations de paix) peuvent se
dérouler avec la participation du Sinn Fein et permettent l’ouverture
des pourparlers en juin. Les attentats de l’I.R.A. et les controverses sur le
désarmement mènent, dès la fin juillet, à ce qui
semble être une impasse. Accusé de faiblesse et d’acceptation d’une
internationalisation du problème par les uns, rendu responsable d’un enlisement
du processus par les autres, John Major ne tire pas de bénéfices
visibles d’une action pourtant cohérente.
Surtout,
la
question
européenne pèse de plus en plus lourd et la
division croissante des conservateurs entre partisans de l’Union européenne
et « eurosceptiques » ou « europhobes » mène à une
véritable paralysie gouvernementale. En 1992, la ratification parlementaire
du traité de Maastricht, privé de son volet social et sans référence à une
marche obligatoire vers l’union monétaire, avait déjà valu
au cabinet la fronde d’une fraction des tories et n’avait été acquise
que par le recours à une question de confiance. Le boycottage des exportations
de viande bovine britannique, décidé par la Commission européenne
après l’annonce, en mars 1996, des risques présentés pour
l’homme par la maladie de la « vache folle »,
accentua
encore
l’europhobie.
Querelles
intestines,
démissions ministérielles soulignent le manque
d’autorité du leader. À l’atmosphère empoisonnée
créée par les frasques de membres de la famille royale, et que
détaille à plaisir la plus acharnée des presses à sensation
s’ajoutent quelques scandales. Ils contribuent à créer une atmosphère
de fin de règne et à entretenir le sentiment que, après
seize années de pouvoir, les tories devraient céder la place à une
opposition plus éclairée et plus dynamique. Très injustement,
John Major est en effet rendu responsable d’une dépravation morale et
d’affaires de corruption, qui contredisent évidemment son slogan du « retour
aux valeurs fondamentales » (Back
to
Basics).
Les
sondages
d’opinion
traduisent
dès lors une chute sans répit
du parti au pouvoir jusqu’à des profondeurs jamais atteintes :
dès
décembre 1992, le Parti travailliste a creusé un écart
de près de 16 % des intentions de vote par rapport aux conservateurs,
cet écart est de 40,5 %, le plus haut niveau historique
jamais mesuré, en décembre 1994, et demeure de près
de 30 % encore en 1996. L’incapacité des tories à trouver
un successeur à un
Premier ministre impopulaire contraste avec les deux choix successifs
de l’opposition :
Neil Kinnock, ayant démissionné après la
défaite
de 1992, est remplacé, en juillet, par John Smith ;
le décès
de ce leader compétent et modéré, le 12 mai
1994, amène à la
tête du parti Tony Blair, alors âgé de
quarante et un ans et dont la popularité est immédiate
(en décembre 1995, il
est crédité de plus de 63 % d’opinions favorables).
De ce fait, le Premier ministre n’a jamais osé faire
le pari d’élections
législatives anticipées.
Tony Blair et le New Labour
Élu en juillet 1994 à la
tête de son parti, le nouveau chef travailliste,
avocat de son état et excellent orateur, inspiré par
le christianisme social, a pour lui sa jeunesse et un indéniable
charisme. Il parachève
la rénovation du Parti travailliste. Déjà,
John Smith, en 1993, avait réussi à limiter fortement
les interventions syndicales dans la sélection des candidats
du parti aux élections. Le 29 avril
1995, lors d’un congrès extraordinaire, Tony Blair fait
adopter la modification de la clause IV des statuts du parti,
vieille de soixante-sept ans et qui fixait comme objectif suprême
la nationalisation des biens de production et d’échange ;
le nouveau texte préserve la foi dans le bien
public, dans l’égalité des chances, dans l’emploi
pour tous, mais, désormais, la prospérité et
le bonheur devraient venir d’un partenariat bien compris avec
les grands décideurs économiques,
sans rupture avec l’économie de marché et la dynamique
de la concurrence. La gauche fait dès
lors
de
moins
en
moins
peur
aux
classes
moyennes.
Le
programme électoral de 1997 affirme la nécessité de réformes
constitutionnelles et promet, sous réserve de décisions par référendum,
la mise en place de Parlements distincts pour l’Écosse et le pays de Galles ;
il prévoit l’incorporation de la Convention européenne des droits
de l’homme dans le droit britannique ; reprenant des vues très anciennes
et qui, en 1969, avaient conduit Harold Wilson dans une impasse, il inscrit à nouveau
la réforme de la Chambre des lords parmi les priorités du parti.
Satisfaisant les syndicats, il affirme la nécessité de ratifier
le volet social du traité de Maastricht ; il y ajoute l’engagement
d’instaurer un salaire de base minimum. Figure aussi la promesse d’un impôt
spécial sur les bénéfices des entreprises privatisées
par les conservateurs (windfall tax). Rien n’est cependant envisagé pour
rendre aux syndicats leur puissance d’autrefois ; forte, en 1997, de quelque
sept millions d’adhérents, la Confédération intersyndicale
est loin de ses douze millions d’adhérents de 1979, et elle doit faire
face au manque de combativité de bien des salariés, surtout soucieux
de préserver leur emploi, ainsi qu’au poids croissant des syndicats de « cols
blancs », sensibles aux discours modernisateurs et peu enclins aux
actions de grève. Au lendemain de sa victoire électorale, le 1er mai
1997, et après le discours du trône du 14 mai, Tony Blair résume
ainsi son projet : « Moderniser ce qui est périmé,
redresser les injustices, et agir en recourant aux méthodes les meilleures,
sans esprit dogmatique ou doctrinaire, sans peur et en toute objectivité. »
Cette
victoire électorale a été acquise largement. Un peu
plus de 31 millions de citoyens, environ 71 % des inscrits, ont
pris part au vote. Les conservateurs ne représentent plus que 31,4 %
des suffrages, en baisse de plus de 10 % par comparaison à 1992,
alors que les travaillistes sont passés de 34 à 44 %.
La majorité nouvelle dispose de 419 sièges contre 165 aux tories,
46 aux libéraux-démocrates et 29 divers. Le cabinet Blair se retrouve
ainsi dans une situation confortable, et son rapprochement parlementaire avec
les libéraux sur l’Écosse et sur une réforme électorale
dans un sens proportionnel ne tient pas à une nécessité pressante.
Le
nouveau
Premier
ministre
a
donné la priorité absolue à l’éducation
et à l’emploi, au vote des réformes du statut de l’Écosse
et du pays de Galles, à de significatifs progrès en Irlande du
Nord, où la violence a pris fin, à l’élaboration d’un nouveau
système pénal à l’encontre des jeunes délinquants
récidivistes, aux préparatifs d’un retour de l’agglomération
de Londres à l’unité administrative sous la responsabilité d’un
maire élu. En revanche, rien n’est changé aux fondements de l’économie
libérale, la gauche du parti étant invitée à se réjouir
seulement de l’annonce, pour 1999, d’une loi de suppression de la pairie héréditaire.
Sur l’Europe, et tout particulièrement sur la monnaie unique, tout pas
en avant est subordonné à une éventuelle consultation populaire
qui interviendrait dans un délai encore non précisé. La
politique étrangère demeure prioritairement axée sur les
relations spéciales avec les États-Unis (comme le démontre
l’attaque conjointe contre l’Irak en décembre 1998), malgré quelques
gestes en faveur d’une plus forte coopération européenne. Pragmatique,
le New Labour se réjouit des succès de l’économie de marché,
se satisfait d’un chômage tombé au-dessous des 6 % et
défend la position de la City dans les échanges
internationaux.
Une
récession amorcée au début de 1999, la politique envers
l’Union européenne, de premiers signes de mécontentement de la
gauche travailliste, quelques scandales qui, au début de la nouvelle année,
secouent le cabinet, les impatiences de la gauche du parti changeront-ils la
donne et ébranleront-ils la stabilité politique ? Deux ans
après son arrivée au pouvoir, Tony Blair continue de bénéficier
d’une forte popularité dans une nation que la mort de la princesse Diana,
le 31 août 1997, avait montrée plus fortement soudée
qu’on
ne
le
pensait.

Royaume-Uni, Grande-Bretagne et Angleterre sont souvent utilisés comme synonymes. Le terme de Royaume-Uni désigne l’ensemble des territoires du royaume tandis que la Grande-Bretagne désigne l’île composée de l’Angleterre, du pays de Galles et de l’Écosse. L’Angleterre et le pays de Galles sont réunis depuis 1536 ; les Couronnes d’Angleterre et d’Écosse, depuis l’acte d’Union de 1707 qui a fondé le royaume de Grande-Bretagne (voir Actes d'union). À partir de 1801, après l’union de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, le royaume a été appelé officiellement Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, jusqu’à l’indépendance de la république d’Irlande, en 1922.
L’île de Man et les îles Anglo-Normandes dépendent directement de la Couronne britannique mais ne font pas partie du Royaume-Uni. Elles ont leurs propres institutions, le Royaume-Uni assurant leur représentation diplomatique et leur défense. Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges du Royaume-Uni, les îles Caïmans, les îles Malouines, Gibraltar, Montserrat, Sainte-Hélène (et ses dépendances administratives : Ascension et Tristan da Cunha), la Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud et les îles Turks et Caicos ont leur propre gouvernement mais ont choisi de rester sous contrôle britannique. Les exceptions sont le Territoire britannique de l’Antarctique et les territoires de l’océan Indien avec l’île Diego Garcia, louée aux États-Unis, et qui abrite une base aéronavale américaine. Hong Kong est revenu à la Chine à l’expiration du bail britannique sur le territoire en 1997.
La Grande-Bretagne, huitième île du monde par sa surface, occupe 229 870 km² et couvre 90 % de la superficie totale du Royaume-Uni. Elle est traditionnellement divisée en deux ensembles structuraux, qui s’étendent de part et d’autre d’une ligne Exeter-Newcastle, de l’embouchure du fleuve Exe dans le Devon, et au nord-est de l’estuaire de la rivière Tees. Au nord de cette ligne se trouvent les massifs anciens, vestiges de l’orogenèse calédonienne : l’Écosse, le Lake District, le pays de Galles, le nord, le nord-ouest et le sud-ouest de l’Angleterre. L’Écosse est divisée en trois régions : les Highlands, la zone la plus montagneuse, où se trouve le point culminant du royaume, le Ben Nevis (1 343 m) ; les Basses-Terres centrales et les Highlands du Sud. Le pays de Galles est principalement formé par les monts Cambriens ; le point culminant du pays de Galles et de l’Angleterre (1 085 m) est situé dans le massif de Snowdon. L’Angleterre est compartimentée en trois régions principales de hautes terres et deux régions de basses terres (East Anglia et le Sud-Est) rattachées par de riches plaines agricoles. La zone des hautes terres de la péninsule de Cornouailles comprend les massifs de Dartmoor, d’Exmoor et de Bodmin Moor ; la chaîne des Pennines est située au nord et les monts du Cumberland du Lake District sont situés au nord-ouest.
En Irlande du Nord,
les monts Sperrin et les monts Antrim, au nord et au nord-est, sont
une extension des
Highlands écossais. Avec les
monts Mourne, où se situe le point culminant d’Irlande du Nord
avec le Slieve Donard (852 m), ils bordent une plaine centrale où se
situe le lough Neagh (396 km²), le plus grand lac d’eau douce du
Royaume-Uni.
La longueur maximale du Royaume-Uni est de 1 264 km. Le point le plus
septentrional est Out Stack, au large d’Unst, dans les îles Shetland,
le point le plus méridional est St Agnes, dans les îles
Scilly. La largeur maximale du royaume est de 670 km de Lough Melvin
dans le sud-ouest de l’Irlande du Nord jusqu’à Lowestoft, dans
le Suffolk. Les dimensions maximales de la Grande-Bretagne sont de 974
km du nord au sud et de 531 km d’est en ouest.
L’ensemble du Royaume-Uni, hormis la région d’Angleterre située au sud des estuaires de la Tamise et de la Severn, fut recouvert par les glaces pendant la période du pliocène ; la glaciation contribua à façonner des paysages, comme ceux du Lake District. L’activité humaine a aussi joué un rôle important dans cette modification, notamment dans les Norfolk Broads, les terres marécageuses de l’est de l’Angleterre, et les landes du nord de l’Écosse.

 |
|
Dit Union Jack soit à cause du roi Jacques Ier qui l’a dessiné soit parce que sur les navires de guerre, il est obligatoirement le pavillon de beaupré (en anglais : ja.ck). Superposition des croix de Saint-Georges (Angleterre, rouge sur fond blanc, adoptée au XIIème siècle), Saint-André (Écosse, blanche sur fond bleu, ajoutée en 1707)1 Saint-Patrick (Irlande, rouge sur fond blanc, ajoutée en 1801). Seul le bâtiment de l ‘amiral de la flotte le porte au grand mât. Les autres navires de guerre y arborent l' « enseigne blanche» de la Royal Navy (croix de Saint-Georges, avec petit Union Jack, case I). |
 |
|
Depuis Richard Cœur de Lion (v. 1200), elles sont celles des ducs de Normandie : 3 léopards d'or sur champs de gueules (rouge), En 1339, Édouard III (qui revendiquait la couronne de France) écartela son écu avec les fleurs de lys d'or semées sur champ d'azur (réduites à 3, pour imiter les rois de France à partir du XVème siècle). A partir de 1603, les armes d'Écosse (un lion de gueules, dans un cadre également de gueules, sur champ d'or) et celles d'Irlande (une lyre d'or sur champ d'azur) sont jointes aux précédentes ; Guillaume III y rajoute en 1688 1ion et billettes de Nassau. En 1801, on enleva les fleurs de lys de France mais on rajouta un écusson de pré tendance avec les armes du Hanovre, que la reine Victoria supprima en 1831. Depuis, les armoiries Royales sont écartelées en 1 et 4 d'Angleterre, en 2 d'Écosse et en 3 d'Irlande. |
 |
Dieu et mon Droit |
|
 |
God Save the Queen |
|
 |
qui indique la présence de la reine dans un bâtiment ou sur un navire, représente les armoiries écartelées des 3 royaumes ; sans leurs supports (lion couronné et licorne), sans devise et sans crête (heaume avec Couronne royale, surmontée d'un lion couronné). |
 |
|
 |
 |
|
|
|||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|||
 |
 |
||
Certains
des éléments de cette page proviennent des sites suivants :
|