
L’Espagne a été habitée dès le paléolithique comme l’attestent les nombreux gisements découverts dans tout le pays et les peintures rupestres du nord, en bordure du golfe de Gascogne et dans les monts Cantabriques (voir Altamira). Des témoignages de la culture néolithique datant de 3000 av. J.-C. ont également été découverts à Almería, au sud-est de l’Espagne.
Venus d’Afrique du Nord, les Ibères envahissent le sud
de la péninsule, tandis que les Celtes, originaires de France,
s’implantent au nord. Au IIe millénaire av. J.-C., l’Andalousie
entre dans le circuit commercial méditerranéen. Des Phéniciens,
probablement avant le XIe siècle av. J.-C., puis des Grecs occupent
les côtes méditerranéennes espagnoles, à la
recherche d’argent, de plomb, de cuivre et surtout d’étain,
nécessaire à l’industrie du bronze. Les Phéniciens établissent
une colonie sur le site de l’actuelle Cadix. À l’intérieur
de la péninsule coexistent Celtes et Ibères dont le métissage
a donné le fond celtibère de la population espagnole.
Après la première guerre punique et la perte de la Sicile,
Carthage décide de se lancer à la conquête de la
péninsule Ibérique. Celle-ci est menée, entre 237
et 228 av. J.-C., par le général carthaginois Hamilcar
Barca qui impose sa domination à l’est du pays jusqu’à Barcelone
qu’il fonde. Son successeur, Hasdrubal, est stoppé en 227
av. J.-C. par les Romains, sur l’Èbre. Il construit alors
la forteresse de Carthago Nova (aujourd’hui Carthagène).
Hannibal, qui lui succède en 221 av. J.-C., déclenche la
seconde guerre punique par la prise de Saguntum (actuelle Sagonte), alliée
de Rome, en 219 av. J.-C.
La conquête romaine, menée par les frères Scipion, est longue. Mais en l’an 206 av. J.-C., les Carthaginois, vaincus, sont obligés de quitter la péninsule. Neuf ans plus tard, Rome divise la péninsule en deux provinces : l’Hispania Citerior (Espagne Citérieure), au nord-est, et l’Hispania Ulterior (Espagne Ultérieure), au sud et à l’ouest. La pacification est difficile : la bordure nord de la péninsule (Galice, Asturies, Cantabrie) n’est définitivement pacifiée que sous Auguste en 19 av. J.-C. Celui-ci divise l’Espagne en trois provinces romaines : la Lusitanie à l’ouest, la Bétique au sud et la Tarraconaise qui s’étend du nord de Carthagène jusqu’au nord-ouest de la péninsule. La « paix romaine » règne quatre siècles dans la péninsule (Ier-Ve siècle apr. J.-C.). C’est pour l’Espagne une période de grande prospérité. L’Hispanie est l’une des colonies les plus riches de Rome. Elle fournit de grandes quantités de céréales et ses mines produisent fer, cuivre, plomb, or et argent. Le christianisme fait son apparition en Espagne dès le IIe siècle et se répand peu à peu.
L'Espagne wisigothique
Les grandes invasions barbares commencent au Ve siècle apr. J.-C. En 409, des envahisseurs, surtout des Vandales, des Alains et des Suèves, traversent les Pyrénées et ravagent la péninsule. En 412, l’empereur Honorius charge les Wisigoths, peuple « fédéré » installé en Aquitaine, de rétablir l’autorité impériale. Ceux-ci refoulent les Vandales en Bétique (Andalousie), rejettent les Alains en Lusitanie et cantonnent les Suèves en Galice. En 419, le royaume wisigoth de Toulouse, vassal de Rome, est fondé.
Sous le roi Euric (466-484), les Wisigoths occupent toute la péninsule Ibérique à l’exception de l’extrême Nord-Ouest où se trouvent refoulés les Suèves. Ils établissent un royaume puissant s’étendant du détroit de Gibraltar au nord de la Loire, en France. Expulsés de la Gaule du Sud, après la victoire en 507 de Clovis sur Alaric II, successeur d’Euric, les Wisigoths réduisent leur domination à l’Espagne, sur laquelle ils règnent pendant deux siècles. Toutefois, leur domination sur l’ensemble de la péninsule ne devient effective qu’après la destruction et l’annexion du royaume suève en 585. Ils établissent leur capitale à Tolède. Cependant, l’opposition religieuse entre les Wisigoths ariens et les Hispano-Romains catholiques empêche la fusion des deux peuples. En 589, le roi Récarède Ier se convertit avec son peuple, et le catholicisme devient la religion officielle.
L’Espagne musulmane (VIIIe-XIIIe siècle)
En 711, des Maures musulmans d’Afrique du Nord franchissent le
détroit de Gibraltar. Roderick, dernier roi wisigoth d’Espagne,
est vaincu près de Cadix. La quasi-totalité de la péninsule
est dès lors rapidement soumise à la domination des conquérants, à l’exception
des régions montagneuses du Nord (monts Cantabriques, Pyrénées
occidentales). Stoppés dans leur progression vers le nord par
Charles Martel, à Poitiers, en 732, les Maures se replient en
deçà des Pyrénées. Les populations rurales
se convertissent à l’islam. Dans les villes, des « capitulations » garantissent
le plus souvent aux chrétiens, les Mozarabes, la liberté religieuse.
L’Espagne musulmane, à l’exception des Asturies
et du Pays basque, devient une dépendance lointaine du califat
de Damas.
En 756, le prince de la dynastie omeyade Abd al-Rahman Ier, détrôné par
les Abbassides, se réfugie en Espagne. Il en fait un émirat
indépendant et s’établit à Cordoue. En 929,
un de ses descendants, Abd al-Rahman III, prend le titre de calife.
L’Espagne musulmane connaît son apogée sous le califat de Cordoue, qui dure jusqu’en 1031. Ses institutions très élaborées (administration centralisée, législations judiciaire et financière) contrastent alors avec le morcellement féodal des États chrétiens d’Occident et lui assurent une grande prospérité économique. Sa marine domine la Méditerranée. L’irrigation est étendue, de nouvelles cultures (canne à sucre, riz, mûrier) sont introduites. Un important artisanat urbain (soie, cuir, métaux) se développe.
Le califat de Cordoue est également un centre culturel et artistique très brillant. De nombreuses écoles et une importante bibliothèque sont fondées. Les grandes universités musulmanes y enseignent la médecine, les mathématiques, la philosophie et la littérature. L’œuvre d’Aristote y est étudiée bien avant que l’Europe chrétienne ne la découvre à son tour. Cordoue devient le haut lieu de la philosophie arabe, avec Averroès, et juive, avec Maïmonide. L’art hispano-mauresque y atteint son apogée (voir art de l'Islam).
Au XIe siècle, l’Espagne musulmane se fragmente en une vingtaine de royaumes maures indépendants, les « royaumes de taifas ». Les plus importants sont les royaumes de Saragosse, d’Almería, de Valence et de Séville.
L'expansion des États chrétiens du Nord et la Reconquista
Deux contrées espagnoles ont réussi à échapper aux Maures du fait de leur isolement et de leur situation périphérique : le Nord-Ouest (Asturies, León) et le Nord (Pyrénées). C’est de ces refuges que part la Reconquista. En 718 est fondé le petit royaume des Asturies par un chef wisigoth, Pelayo (Pélage). Son gendre, Alphonse, conquiert presque toute la Galice et reprit la quasi-totalité du León. Sous Alphonse III le Grand (866-911), le royaume de León et des Asturies est étendu jusqu’au Douro et la capitale transférée à León. En 932, le comté de Castille, qui forme la partie sud-orientale du royaume, fait sécession.
Entre-temps, d’autres foyers de résistance se développent en Navarre, érigée en royaume en 830, et dans les hautes vallées de l’Aragon. Au XIe siècle, le roi de Navarre, Sanche le Grand (1000-1035), enlève presque tout l’Aragon aux Arabes. Il parvient ensuite à regrouper tous les royaumes chrétiens espagnols sous son autorité. À sa mort, ses possessions sont partagées entre ses fils. L’Espagne chrétienne se répartit alors entre les royaumes de León, de Castille (royaume en 1035), de Navarre et d’Aragon (royaume en 1035). Ferdinand Ier, roi de Castille, conquiert le León en 1037, puis la Galice musulmane. Devenue le plus puissant des royaumes chrétiens, la Castille entame, dans la seconde moitié du XIe siècle, la Reconquête ou Reconquista, après trois siècles de domination musulmane en Espagne.
Le morcellement du califat de Cordoue, au début du XIe siècle, facilite la Reconquista, qui devient la croisade de l’Espagne chrétienne. En 1085, Alphonse VI de Castille s’empare de Tolède. En 1094, son vassal, Rodrigo Díaz (le Cid Campeador), conquiert le royaume maure de Valence. Devant l’ampleur de la menace chrétienne, le roi Abbad III de Séville fait alors appel aux Almoravides, Berbères fanatiques d’Afrique du Nord. Après avoir infligé deux graves défaites à Alphonse VI, en 1086 et en 1109, ceux-ci régnent sur l’Espagne musulmane jusqu’en 1147.
Une nouvelle offensive chrétienne aboutit en 1118 à la prise de Saragosse et à l’occupation de toute la moyenne vallée de l’Èbre. Mais, au milieu du XIIe siècle, les souverains chrétiens, divisés, n’opposent qu’une faible résistance à la contre-offensive des musulmans, menés par les Almohades. Ceux-ci établissent une nouvelle fois leur domination sur l’Espagne musulmane après la terrible défaite infligée au roi de Castille, Alphonse VIII, à Alarcos, en 1195. Décidés à poursuivre la Reconquista, les souverains chrétiens coalisent alors leurs forces et remportent la victoire de Las Navas de Tolosa contre les Almohades, en juillet 1212. L’occupation de la basse Andalousie par Ferdinand III de Castille est suivie par la prise de Séville et de Carthagène en 1248. Parallèlement, à l’est, le roi d’Aragon, Jacques le Conquérant, s’empare des Baléares (1229-1235) puis du royaume maure de Valence (1238). Après la prise de Cordoue en 1262, la présence musulmane dans la péninsule Ibérique se limite dès lors au royaume de Grenade, qui perdure jusqu’en 1492.
Les royaumes de Portugal, de Castille (englobant le León, les Asturies, Cordoue, l’Estrémadure, la Galice, Cadix et Séville) et d’Aragon (incluant Barcelone, Valence et les îles Baléares) sont les grands bénéficiaires de la Reconquista. La Navarre, passée sous domination des comtes de Champagne en 1234, est unie à la Couronne de France sous Philippe le Bel.
Du XIIIe au XVe siècle, le royaume d’Aragon constitue un empire méditerranéen (Sardaigne, Sicile, Corse). Mais, durant cette période, les difficultés intérieures se multiplient dans les royaumes hispaniques : crises dynastiques en Castille, sous Alphonse X, puis entre Pierre Ier le Cruel et Henri de Trastamare, conflits entre la monarchie et l’aristocratie en Aragon, lutte contre Majorque, crise successorale de 1410, révolte de la Catalogne (1462-1472). Malgré ces déchirements, le pouvoir royal s’affermit progressivement.
L'Espagne
des Rois Catholiques et l'unité nationale
En 1469, le mariage d’Isabelle de Castille avec Ferdinand V d’Aragon
est le premier pas vers l’unité nationale. Ensemble, ils
gouvernent la Castille (dès 1474) et l’Aragon (à partir
de 1479), chacun des deux royaumes conservant ses propres institutions.
En raison de sa supériorité territoriale et démographique,
la Castille acquiert toutefois un rôle prépondérant.
Leur règne, qui leur vaut le surnom de « Rois Catholiques »,
est celui de l’intransigeance religieuse : le tribunal de l’Inquisition,
créé en 1478, est particulièrement actif et puissant,
se livrant à l’expulsion ou à la conversion forcée
des juifs et des Maures et proclamant de nombreuses condamnations pour
hérésie. L’Inquisition s’accompagne, dans
les deux royaumes, d’un renforcement de l’autorité monarchique.
En 1492, la prise de Grenade marque la fin de la Reconquista.
La découverte de l’Amérique en 1492 par Christophe Colomb, mandaté par l’Espagne, inaugure une ère d’hégémonie espagnole. Sur le plan européen, Ferdinand V joue un rôle prépondérant. Il étend sa souveraineté sur le royaume de Naples aux dépens des rois de France Charles VIII et Louis XII, puis sur le royaume de Navarre, après la mort de sa femme (1504). À sa mort en 1516, l’Espagne contrôle le sud de l’Italie, la Navarre et, plus au nord, la Cerdagne et le Roussillon. C’est son petit-fils, Charles, fils de Jeanne la Folle et de Philippe le Beau, qui lui succède.
Les Habsbourg (XVIe-XVIIe siècle)
L’accession de Charles porte la dynastie des Habsbourg au trône d’Espagne. Héritier légal des royaumes de Castille et d’Aragon, Charles les unit et devient le premier souverain du royaume d’Espagne, de 1516 à 1556. Possesseur de Naples, de la Sicile et des Pays-Bas, il reçoit la Bourgogne en héritage, de son aïeul Maximilien Ier de Habsbourg. En 1519, il est élu empereur d’Allemagne sous le nom de Charles Quint. Charles Quint est le plus puissant monarque européen de son temps. Élevé en Flandre, il est plus néerlandais qu’espagnol. Ses préoccupations continentales, marquées par les guerres qu’il mène contre François Ier, l’emportent le plus souvent sur les intérêts ibériques. Sa méconnaissance des problèmes castillans déclenche la révolte des Comuneros (1520-1521) qu’il réprime.
Le XVIe siècle est le Siècle d’or du royaume. L’Espagne acquiert une place prépondérante en Europe tandis que son prestige et sa puissance sont renforcés par la fondation de l’empire d’Amérique. La Castille connaît une grande prospérité, et c’est sous le règne de Charles Quint que sont menées l’exploration et la conquête des Amériques : conquête de l’Empire aztèque, au Mexique, par Hernán Cortés, de 1519 à 1521 ; conquête de l’Empire inca, au Pérou, par Francisco Pizarro, de 1531 à 1533. Vers 1550, l’Espagne contrôle presque tout le continent sud-américain, l’Amérique centrale, la Floride, Cuba et, en Asie, les Philippines.
Après la découverte, dans les années 1530, de riches
mines d’or et d’argent, cet immense empire d’outre-mer
est pour l’Espagne la source d’une grande richesse ; celle-ci
finance les guerres contre les Français qui permettent à l’Espagne
d’étendre sa puissance, au nord et au sud de l’Italie,
et d’asseoir son hégémonie en Europe. Le Siècle
d’or est également pour l’Espagne une période
de prestige artistique et intellectuel, avec des auteurs comme Tirso
de Molina et Cervantès, mais également religieux, avec
la fondation de la Compagnie de Jésus par saint Ignace de Loyola
et l’essor du mysticisme (Thérèse d’Ávila,
saint Jean de la Croix).
En 1556, les échecs de Charles Quint en France et en Allemagne
le conduisent à l’abdication en faveur de son fils, Philippe
II. Celui-ci signe avec la France, en 1559, le traité du Cateau-Cambrésis.
Le Siècle d’or atteint son apogée sous son règne
(1556-1598). Le Portugal est annexé en 1580. Avec le Portugal,
qui contrôle des terres en Asie, en Afrique et au Brésil,
l’Espagne fonde le plus vaste empire du monde.
Cependant, Philippe II accumule les échecs en Europe. La persécution qu’il fait exercer contre les protestants hollandais et ses tentatives de gouverner les Pays-Bas comme une province espagnole déclenchent en 1566 la révolte des Pays-Bas espagnols. La guerre avec l’Angleterre d’Élisabeth Ire tourne au désastre avec la destruction en 1588 de l’Invincible Armada. L’intervention dans les guerres de Religion, en France, se solde par un échec (paix de Vervins, 1598). À la fin du règne de Philippe II, les sept Provinces-Unies sont pratiquement indépendantes. Pendant ce temps, la situation à l’intérieur de l’Espagne se détériore. Le trésor des Amériques ne pouvant à lui seul entretenir les guerres de l’Espagne, les impôts deviennent exorbitants. L’économie commence à s’appauvrir. Des épidémies ravagent le pays vers 1590. L’Inquisition est renforcée et la répression contre les Maures et les juifs accrue. À sa mort en 1598, Philippe II laisse un pays sur la voie du déclin, à la fois sur le plan national et international.
La décadence se précipite au XVIIe siècle sous
les règnes de ses successeurs (Philippe III, 1598-1621 ; Philippe
IV, 1621-1665 ; Charles II, 1665-1700). L’Espagne demeure toutefois
un très grand royaume jusqu’en 1659. Mais derrière
la façade d’une civilisation brillante, la puissance espagnole
va en s’amenuisant. Marquée à l’intérieur
par un affaiblissement économique, financier et démographique,
l’Espagne connaît à l’extérieur de graves
revers politiques. En 1609-1610, Philippe III expulse d’Espagne
près de 270 000 morisques (Maures christianisés). L’Aragon
perd du même coup le huitième de sa population. L’émigration
vers l’Amérique et les guerres européennes contribuent également à la
dépopulation. La population espagnole, estimée à 8
millions d’âmes au début du siècle, n’en
compte plus que 6 millions à la mort de Philippe IV.
Le déclin économique est marqué par la chute du
commerce des Indes et par la baisse des importations de métaux
précieux. L’Espagne a de moins en moins les moyens de gérer
et de conserver un empire aussi vaste. Les Néerlandais en profitent
pour s’emparer d’une grande partie des possessions portugaises
d’Orient. Avec les Anglais, ils développent le commerce
interlope sur les côtes américaines.
Philippe III confie les affaires du royaume au duc de Lerma jusqu’en 1618. Prudent en politique étrangère, celui-ci signe un traité de paix avec l’Angleterre en 1604 puis, en 1609, la trêve de Douze Ans avec les Provinces-Unies. Sous le règne de Philippe IV, le pouvoir est exercé par Gaspard de Guzman, comte d’Olivares. Celui-ci cherche à restaurer la puissance espagnole hors de ses frontières. Son refus de renouveler la trêve de Douze Ans entraîne l’Espagne dans un long conflit avec les Provinces-Unies. Mais sa politique, trop ambitieuse, connaît à partir de 1640 de graves revers.
Les Français annexent le Roussillon et vainquent les Espagnols à la bataille de Rocroi (1643). L’affaiblissement de l’Espagne s’accentue, à partir de 1640, avec l’épuisement rapide des mines d’argent en Amérique. Trois soulèvements ont lieu de 1640 à 1646 en Catalogne, au Portugal (dont la noblesse proclame roi le duc de Bragance), en Sicile et à Naples. Olivares est finalement disgracié en 1643. L’Espagne est contrainte d’accepter l’indépendance des Pays-Bas en 1648 (traités de Westphalie). Par le traité des Pyrénées (1659), elle cède le Roussillon et l’Artois à la France. Elle passe ensuite sous l’influence française avec le mariage de Louis XIV et de l’infante Marie-Thérèse.
Sous le règne de Charles II, la situation empire. Le nouveau monarque ne peut gouverner réellement en raison d’infirmités physiques et mentales. Le Portugal acquiert définitivement son indépendance en 1668. L’Espagne perd une partie de la Flandre (traité d’Aix-la-Chapelle, 1668) à l’issue de la guerre de Dévolution (1667-1668). Elle perd ensuite la Franche-Comté (traité de Nimègue, 1678), à l’issue de la guerre de Hollande (1672-1678), au profit de la France de Louis XIV. La branche espagnole des Habsbourg s’éteint avec Charles II. Sans descendant, celui-ci lègue le trône d’Espagne à son petit-neveu, le duc d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, qui monte sur le trône d’Espagne sous le nom de Philippe V et inaugure le règne de la dynastie des Bourbons.
Les Bourbons (XVIIIe siècle)
L’arrivée des Bourbons sur le trône d’Espagne suscite l’inquiétude des autres puissances européennes, préoccupées par la politique ambitieuse de Louis XIV en Europe. L’Angleterre, les Pays-Bas, l’Autriche et la Prusse forment une coalition contre la France et l’Espagne, pour soutenir l’archiduc Charles de Habsbourg, autre prétendant au trône d’Espagne. Philippe V d’Espagne (1700-1746) ne voit son trône assuré qu’à la fin de la longue guerre de Succession d’Espagne (1701-1713). Le traité d’Utrecht, en 1713, aboutit à un compromis dans lequel l’Espagne cède d’énormes avantages à ses adversaires, en échange de quoi, Philippe V est reconnu roi d’Espagne. Le pays doit reconnaître l’annexion de Gibraltar par les Anglais, en 1704, et abandonner toutes ses possessions européennes. L’Autriche reçoit les Pays-Bas, le royaume de Naples, le Milanais et la Sardaigne. La Sicile revient au duc de Savoie.
Le règne de Philippe V et celui de son successeur, Ferdinand VI (1746-1759), sont marqués, sur le plan intérieur, par une politique de centralisation, inspirée du modèle absolutiste français. Les pouvoirs sont partagés entre le Conseil de Castille et quatre secrétaires d’État. Le royaume est divisé en vingt-quatre provinces. Les réformes administratives et fiscales renforcent le pouvoir royal. Les privilèges du clergé et de la noblesse se trouvent réduits. Les intendants sont généralisés sous Ferdinand VI. Durant cette période, l’économie connaît une nette amélioration. Celle-ci s’accompagne d’une forte croissance démographique (9 308 000 habitants selon le recensement de 1768-1769). Les colonies d’Amérique sont réorganisées et leurs liens commerciaux avec l’Espagne améliorés.
La politique extérieure de l’Espagne est marquée par une alliance belliqueuse avec la France, essentiellement contre une Autriche enrichie des possessions espagnoles en Italie depuis la fin de la guerre de Succession d’Espagne (traités d’Utrecht en 1713 et de Rastatt en 1714). Influencé par sa seconde épouse, Élisabeth Farnèse, et ses ministres, notamment Giulio Alberoni, le souverain Philippe V se laisse entraîner dans une délicate politique italienne qui, à terme, a pour effet un premier retour de Parme, de Plaisance et de la Toscane à l’Espagne (acquisition de l’infant don Carlos au traité de Séville, 1729), puis l’échange de ces terres contre le royaume de Naples et la Sicile lors du traité de Vienne (ratifié en 1738) qui clôt la guerre de Succession de Pologne et, enfin, l’acquisition définitive de Parme et de Plaisance par l’infant don Philippe à l’issue de la guerre de Succession d’Autriche (traités d’Aix-la-Chapelle, 1748).
À la mort de Ferdinand VI, son frère Charles, roi des Deux-Siciles (1734-1759), lui succède sur le trône d’Espagne sous le nom de Charles III (1759-1788). « Despote éclairé », Charles III engage le pays dans la voie des réformes. Il s’appuie sur des ministres réformateurs, dont le comte d’Aranda, qui préside le Conseil de Castille jusqu’en 1773. Il favorise les arts et tente de rénover l’économie : développement de l’irrigation, avec l’achèvement du canal d’Aragon et la construction d’un barrage près de Murcie, création d’un réseau routier reliant Madrid aux principales villes, appel à des spécialistes étrangers, création de manufactures. Il cherche à lutter contre l’influence des couvents, expulse les jésuites en 1767 et réduit les pouvoirs de l’Inquisition. Charles III est également très présent en politique extérieure. Après avoir conclu avec la France le troisième Pacte de famille, en 1761, il engage l’Espagne, aux côtés de la France, dans la guerre de Sept Ans contre la Grande-Bretagne. Le traité de Paris (1763) lui fait perdre la Floride, mais Louis XIV lui cède, en compensation, la Louisiane. De nouveau alliée de la France en 1779 dans la guerre de l’Indépendance américaine, l’Espagne récupère la Floride en vertu du traité de Versailles de 1783. L’Espagne est désormais présente sur une grande partie du continent nord-américain.
La Révolution française et la guerre d'Indépendance (fin XVIIIe-début XIXe siècle)
Sous le règne de Charles IV (1788-1808), successeur de Charles III, les problèmes de politique étrangère, notamment la Révolution française, acquièrent une place prépondérante. En 1793, après l’exécution de Louis XVI, l’Espagne s’allie aux autres puissances européennes et entre en guerre contre la France. Après l’invasion de la Catalogne par la France révolutionnaire, Charles IV se laisse dominer par Manuel de Godoy, favori de la reine Marie-Louise. Il signe la paix de Bâle dès 1795, puis conclut une alliance avec la France contre la Grande-Bretagne (traité de San Ildefonso, 1796). La suprématie navale britannique a des conséquences désastreuses sur le commerce colonial et, par répercussion, sur l’économie espagnole. La Louisiane est, quant à elle, restituée à la France en 1800. L’alliance avec la France est la cause de la destruction de la flotte espagnole, avec la flotte française, à la bataille de Trafalgar en 1805. En mars 1808, le mécontentement de la population espagnole contre Godoy donne lieu à des émeutes. Godoy est destitué et Charles IV abdique en faveur de son fils, Ferdinand. Celui-ci est déposé en mai 1808 par Napoléon qui installe sur le trône d’Espagne son propre frère, Joseph Bonaparte.
Les Espagnols, dans leur majorité, refusent le joug étranger. Une insurrection populaire éclate à Madrid le 2 mai 1808. Durement réprimée par Murat les 2 et 3 mai, elle marque le début de la guerre d’Indépendance. La révolte gagne l’Andalousie et Séville où, dès juin 1808, une junte insurrectionnelle prend la tête de la résistance. Celle-ci se trouve renforcée dès 1808 par un corps expéditionnaire britannique commandé par Arthur Wellesley, futur duc de Wellington. L’armée française capitule par deux fois, à Bailén en juillet 1808, puis à Sintra, au Portugal, en août 1808, face aux Britanniques. Les Français remportent par la suite de nombreux succès et, en 1810, occupent la quasi-totalité du pays. Mais la résistance acharnée des Espagnols immobilise jusqu’à la fin de l’Empire une partie de la Grande Armée, harcelée par les guérilleros. Après la campagne de Russie, Napoléon tente de se débarrasser de ce fardeau en rendant son trône à Ferdinand VII (traité de Valençay, décembre 1813). Mais après la défaite décisive des Français à Vitoria (21 juin 1813), Wellington franchit les Pyrénées en 1814 et envahit le Sud-Ouest français.
L’occupation de l’Espagne par les armées impériales a de graves conséquences outre-mer. Les colonies américaines refusent de reconnaître Joseph Bonaparte pour roi. Leur loyalisme tourne rapidement au séparatisme, malgré le retour de Ferdinand VII. Les colonies d’Amérique acquièrent tour à tour leur indépendance, grâce notamment à l’action de Simón Bolívar. Dès 1826, l’Empire espagnol d’Amérique n’existe plus, à l’exception de Cuba et de Porto Rico.
Les troubles
du XIXe siècle
Les principes de la Révolution française influencent une
partie de l’élite espagnole. Les libéraux, obtenant
la majorité aux Cortes de Cadix, qui se réunissent de 1811 à 1813,
votent la Constitution libérale de 1812. Cette Constitution anti-absolutiste
instaure un gouvernement parlementaire, supprime l’Inquisition,
limite le pouvoir du clergé et de la noblesse. Ferdinand VII (1814-1833), à son
retour en Espagne en 1814, abroge aussitôt la Constitution de Cadix
et restaure l’absolutisme. Dès lors commence une lutte très
vive entre les partisans de l’absolutisme et ceux du régime
libéral qui marque tout le XIXe siècle. La répression
menée contre les libéraux entraîne en 1820 une révolution,
déclenchée par le commandant Rafael del Riego. Le roi est
contraint d’accepter la Constitution de 1812. Mais, en 1822, lors
du congrès de Vérone, les puissances européennes
de la Sainte-Alliance, craignant l’extension de la révolution à toute
l’Europe, décident d’une intervention militaire française. À l’issue
de cette intervention, menée à bien en 1823, le régime
libéral est abrogé et l’absolutisme rétabli.
Lorsque Ferdinand VII meurt, sa fille et héritière du trône,
l’infante Isabelle, est âgée seulement de trois ans.
Sa mère, Marie-Christine, soutenue par les libéraux, devient
régente. Les absolutistes, quant à eux, lui préfèrent
don Carlos, frère du roi Ferdinand VII et prétendant au trône.
La lutte politique dégénère en une guerre civile opposant
les carlistes aux partisans d’Isabelle II, les cristinos. Don Carlos
est soutenu par de nombreux membres de la noblesse et du clergé.
Les partisans carlistes sont particulièrement nombreux en Catalogne,
en Navarre et dans le Pays basque. La guerre ne s’achève qu’en
1839 par la défaite des carlistes.
Tout au long du conflit, les libéraux procèdent à des
réformes. Une nouvelle Constitution, inspirée de celle de
1812, est établie en 1837. Par la suite, le chef des libéraux
progressistes, le général Baldomero Espartero, contraint
Marie-Christine à l’exil et assure lui-même la régence,
avant d’être renversé en 1843 par un modéré,
le général Manuel Narváez.
Le règne personnel d’Isabelle II (1843-1868) se déroule dans l’instabilité politique et est marqué par la lutte permanente entre libéraux progressistes et libéraux modérés, ainsi que par les intrigues de favoris et par les scandales financiers.
Une grave crise politique finit par éclater en 1868. Isabelle II, discréditée par sa vie privée, est destituée en septembre 1868, lors de la « Révolution glorieuse », par un coup d’État dirigé par le général Juan Prim et Francisco Serrano. La reine se réfugie en France et un gouvernement provisoire est constitué, dirigé par le général Francisco Serrano. Une Constitution démocratique est votée en 1869, instituant une monarchie parlementaire et la liberté des cultes. Le général Serrano devient régent dans l’attente d’un nouveau souverain. Celui-ci est trouvé en la personne d’Amédée de Savoie, fils du roi Victor-Emmanuel II d’Italie, qui finit par accepter la couronne d’Espagne en décembre 1870. Son règne, marqué par de nombreux troubles (insurrection de Cuba en 1868, nouvelle guerre carliste dans le nord du pays) ne dure que deux ans. Il finit par abdiquer en février 1873. La proclamation de la Ire République espagnole, le 11 février 1873, est suivie d’une période d’anarchie politique. Finalement, fin décembre 1874, un coup d’État militaire rétablit la monarchie des Bourbons en faveur du fils d’Isabelle II, le roi Alphonse XII (1875-1885), dans un pays en pleine crise économique.
La Restauration
La période de la Restauration, qui correspond au règne
d’Alphonse XII et de la minorité d’Alphonse XIII,
sous la régence de sa mère, Marie-Christine de Habsbourg-Lorraine
(1885-1902), marque un retour à la stabilité. Une nouvelle
Constitution est établie en 1876. Elle institue de nouveau une
monarchie parlementaire avec deux chambres, le Sénat et les Cortes.
Le suffrage universel est adopté en 1890. Les conservateurs, avec
Antonio Cánovas, et les libéraux, avec Práxedes
Sagasta, alternent au pouvoir. Une nouvelle insurrection carliste est
réprimée en 1876. Pendant vingt ans, l’Espagne retrouve
une stabilité politique et une prospérité économique
perdues depuis le XVIIIe siècle. Alphonse XII meurt en 1885 en
laissant un fils à naître, Alphonse XIII. La régence
de sa mère, Marie-Christine, est marquée par la guerre
hispano-américaine en 1898. Vaincue, l’Espagne perd Cuba
et doit céder Porto Rico et les Philippines aux États-Unis.
Désormais, la politique coloniale s’oriente vers l’Afrique,
l’Espagne ne jouant plus qu’un rôle secondaire dans
les affaires internationales.
À
l’intérieur, la défaite contre les Américains
renforce les mouvements antimonarchiques. Les partis républicains
refont surface. Le mouvement anarchiste se développe et s’enracine
chez les paysans journaliers andalous et chez les ouvriers de l’industrie
catalane par le biais de la Confédération nationale du travail
(CNT). Le socialisme commence à se développer dans les usines
et les mines basques et asturiennes. Le sentiment régionaliste en
Catalogne se transforme en demande d’autonomie. Les complots et les
grèves se succèdent et l’armée domine de plus
en plus la vie politique. La situation s’aggrave sous le règne
personnel d’Alphonse XIII, monté sur le trône en 1902.
Restée neutre pendant la Première Guerre mondiale, et malgré un important essor économique, l’Espagne voit s’amplifier les troubles sociaux et politiques. Les mouvements régionalistes se développent. Le mouvement ouvrier devient une force revendicatrice et organisée avec un syndicalisme en pleine émergence. Les soldats, mal payés, forment des juntes militaires pour appuyer leurs demandes auprès de l’État. Le mouvement anarchiste devient beaucoup plus fort en Espagne que dans tout autre pays européen. L’agitation urbaine, notamment à Barcelone, dégénère en terrorisme, avec les anarcho-syndicalistes. La crise atteint son point culminant avec la révolte d’Abd el-Krim dans le Maroc espagnol (sous-protectorat depuis 1912) et la défaite désastreuse de l’armée espagnole à Anoual en juillet 1921.
La chute de la monarchie et la IIe République
En septembre 1923, le coup d’État du général Miguel Primo de Rivera est accepté par Alphonse XIII, favorable au retour de l’ordre. Primo de Rivera instaure une dictature (1923-1930) et substitue au Parlement un Directoire de militaires. Les partis politiques sont interdits et les privilèges autonomistes de la Catalogne supprimés. La pacification du Maroc, avec l’aide des Français en 1926, est ruineuse. L’opposition grandit en 1928-1929. Critiqué, devant faire face à une grave crise financière et sociale, Primo de Rivera démissionne en janvier 1930. La situation du roi devient alors difficile car la Couronne a soutenu la dictature. Les républicains remportent une majorité écrasante aux élections municipales d’avril 1931. Alphonse XIII s’exile sans abdiquer. La IIe République espagnole est aussitôt proclamée le 14 avril 1931.
Un gouvernement provisoire, réunissant une large coalition (républicains conservateurs, radicaux, socialistes modérés, autonomistes catalans), est constitué, avec à sa tête un ancien ministre de la monarchie, Niceto Alcalá Zamora. Mais celui-ci démissionne rapidement. En octobre 1931, Manuel Azaña, qui dirige l’Action républicaine, devient chef d’un gouvernement de coalition de gauche. Il reste au pouvoir jusqu’en 1933 et mène une œuvre réformatrice de grande envergure.
Une nouvelle Constitution institue une république laïque et parlementaire. Le droit de vote est accordé aux femmes. Le nombre d’officiers se trouve considérablement réduit. Le principe de l’autonomie, déjà accordé à la Catalogne, est étendu au Pays Basque. Le gouvernement entreprend de grandes réformes sociales et fiscales puis, en 1932, une réforme agraire prévoyant la redistribution des terres des latifundia, dans le Sud. Il lance un vaste programme de travaux publics. Il mène également une politique anticléricale, marquée par la séparation de l’Église et de l’État, la laïcisation de l’enseignement, l’expulsion des jésuites et l’introduction du divorce. Mais devant les résistances de la société et les difficultés à faire appliquer un programme aussi ambitieux, la coalition au pouvoir s’effrite peu à peu en 1933. Les modérés trouvent trop rapide le rythme des réformes sociales. Les socialistes radicaux et les anarchistes les jugent insuffisantes et trop lentes. L’opposition monte aussi parmi les catholiques, hostiles à l’anticléricalisme républicain, mais surtout parmi les représentants de l’Église, de l’armée ou encore parmi les grands propriétaires, frappés de plein fouet par les réformes.
Les élections de novembre 1933, qui donnent la majorité à une coalition de droite, inaugurent une période d’agitation politique. Des mesures visant à atténuer l’anticléricalisme et à annuler la réforme agraire et la législation sociale provoquent une vive réaction de la gauche. La tension éclate en octobre 1934 avec une insurrection ouvrière dans la région minière des Asturies, menée par les socialistes et les anarchistes. Elle est sévèrement matée, et de nombreux militants de gauche sont poursuivis et emprisonnés.
Les élections de février 1936 donnent toutefois une courte victoire au Front populaire (Frente popular), large coalition de gauche. Manuel Azaña redevient président. Les socialistes, de plus en plus dominés par la tendance révolutionnaire communiste, refusent de participer au nouveau gouvernement. Le Front populaire rétablit une législation réformatrice. Mais les désordres se multiplient : combats de rue opposant militants d’extrême gauche et phalangistes, prise de possession des terres par les paysans, grève générale, églises brûlées. De violentes critiques s’élèvent dans les rangs de l’opposition menée par Gil Robles et José Calvo Sotelo. Le 13 juillet 1936, Calvo Sotelo est assassiné.
La guerre civile
C’est dans ce contexte qu’éclate une insurrection
des militaires contre le gouvernement. Depuis les élections de
1936, la Phalange regroupe les opposants au régime. Elle favorise
le coup de force du général Francisco Franco, le 17 juillet
1936 à Mellila (Maroc), qui prend le commandement des troupes
espagnoles du Maroc. Le 18 juillet, les garnisons d’Espagne se
soulèvent. La révolte des militaires n’obtient qu’un
demi-succès. Elle est réprimée à Madrid,
Barcelone, Valence, où elle se heurte aux grandes organisations
ouvrières. Au total, l’ensemble de l’Espagne méditerranéenne
reste sous le contrôle des républicains. Le pays est dès
lors partagé en deux zones : une zone nationaliste tenue par les
rebelles (provinces rurales, Vieille-Castille, Galice, villes du Sud-Ouest),
et une zone loyaliste (ou républicaine) englobant presque toutes
les zones urbaines et industrielles. Il s’ensuit une longue guerre
civile jusqu’en 1939, qui est une sanglante guerre d’usure.
Les nationalistes s’unissent derrière un chef d’envergure,
le général Francisco Franco. Celui-ci se proclame chef de
l’État le 1er octobre 1936. Les nationalistes bénéficient
du soutien militaire de Mussolini et d’Hitler, qui envoient des soldats
et du matériel de guerre ultramoderne. Les républicains,
avec pour chef de file Juan Negrín, socialiste modéré,
sont plus divisés. Leur armée rassemble des modérés,
des socialistes, des anarchistes, des régionalistes basques et catalans,
et des communistes. Ils ne peuvent bénéficier que d’une
aide officieuse de la France et de la Grande-Bretagne, qui adoptent une
politique de non-intervention, mais reçoivent d’importantes
fournitures de matériels de l’URSS. Des Brigades internationales,
constituées à l’instigation du Komintern par des volontaires
venus d’Europe et d’Amérique, viennent renforcer leurs
rangs.
Les armées franquistes s’emparent peu à peu de toute l’Espagne républicaine. Elles conquièrent successivement la Biscaye et les Asturies, à l’issue d’une difficile campagne — d’avril à octobre 1937 — au cours de laquelle a lieu le dramatique bombardement de Guernica. Les loyalistes lancent une contre-offensive en décembre 1937 et prennent Téruel en janvier 1938. Mais les nationalistes reprennent leur progression. Ils atteignent la Méditerranée à la mi-avril. Les loyalistes ripostent en attaquant les armées franquistes sur leur front arrière, sur l’Èbre, mais épuisent leurs forces dans la longue bataille qui s’ensuit, jusqu’en novembre 1938. Finalement, en décembre 1838, une percée des nationalistes en Catalogne fait reculer les loyalistes vers Barcelone qui tombe le 26 janvier 1939. Profondément divisés et épuisés, les loyalistes n’offrent plus aucune résistance. Madrid tombe à son tour en mars 1939. La guerre civile prend fin le 1er avril 1939, laissant derrière elle près de 400 000 morts et un pays ruiné.
La dictature franquiste
Le général Franco instaure une dictature militaire. Par la loi du 8 août 1939, tous les pouvoirs se trouvent entre les mains du chef de l’État, le Caudillo. Celui-ci est détenteur du pouvoir exécutif et législatif, également commandant en chef des forces armées, Premier ministre et chef du parti de la Phalange. Bien que redevable à l’Allemagne et à l’Italie de sa victoire, Franco refuse de rejoindre, au début de la Seconde Guerre mondiale, les puissances de l’Axe. Il proclame la neutralité de l’Espagne, préférant organiser le nouveau régime et entreprendre la reconstruction du pays. Il ne tente pas d’obtenir la réconciliation nationale. Les loyalistes sont emprisonnés par centaines de milliers, dont quelque 37 000 sont exécutés durant les quatre années qui suivent la guerre. Presque toutes les lois républicaines en faveur des ouvriers et des paysans sont abrogées. Les principaux appuis de la dictature sont l’armée, l’Église, à laquelle Franco restitue ses privilèges, et la Phalange, parti unique.
Par la loi de Succession du 26 juillet 1947, Franco rétablit la monarchie et s’institue régent à vie, laissant le trône vacant jusqu’à sa mort. Sur le plan extérieur, il réussit à rompre, avec l’aide des États-Unis, l’isolement imposé à l’Espagne par les Nations unies de 1946 à 1950. Le pays entre finalement à l’ONU en décembre 1955. Après 1960, l’Espagne bénéficie d’un important renouveau économique qui se traduit par une rapide croissance industrielle, un essor du tourisme et des investissements étrangers. De son côté, l’Espagne libéralise les rouages de sa propre économie. La population espagnole peut accéder à la consommation de masse. L’agriculture est modernisée et mécanisée. Cette nouvelle prospérité entraîne de rapides changements sociaux. L’exode rural s’accélère. Un immense programme de logements sociaux, subventionné par le gouvernement, permet le passage d’une société rurale à une société urbaine.
Malgré la politique de libéralisation qui accompagne les changements socio-économiques, l’évolution du régime autoritaire est très lente. Après avoir dirigé le pays de façon autocratique jusqu’en 1967, Franco s’appuie de plus en plus, par la suite, sur l’amiral Luis Carrero Blanco, vice-président du gouvernement de 1967 à 1973. La dictature continue à maintenir un régime d’oppression. En 1962, en réaction aux grèves dans les Asturies, Franco décrète la loi martiale. En 1970, six membres d’Euzkadi ta Azkatasuna (« Autonomie et Liberté du peuple basque », ETA), organisation séparatiste basque récemment créée, sont condamnés à mort. Mais, sous la pression internationale, la loi martiale est levée et les six membres de l’ETA graciés. La libéralisation politique progresse dès lors. La liberté de la presse est étendue. Juan Carlos, petit-fils d’Alphonse XIII, est désigné par Franco pour être son successeur à sa mort. À l’étranger, la Guinée espagnole accède à l’indépendance en 1968, devenant la Guinée équatoriale. Sept ans plus tard, le gouvernement accepte de céder le Sahara-Occidental au Maroc et à la Mauritanie.
Cependant, les mouvements d’opposition (ouvriers, étudiants, intellectuels) restent très forts à Madrid, au Pays Basque et en Catalogne. Bien qu’illégales, de nombreuses grèves éclatent en Espagne à la charnière des années 1960-1970. L’action terroriste de l’ETA s’amplifie. Le gouvernement répond par une répression aveugle. Un cycle de violence s’instaure dans le Pays Basque jusqu’en 1975. En 1973, Luis Carrero Blanco est assassiné par l’ETA. Au lieu de riposter par une répression massive, son remplaçant, Carlos Arias Navarro, annonce de nouvelles mesures de libéralisation, en faveur notamment de la création de partis politiques, interdits depuis 1939, ce qui déclenche une révolte chez les phalangistes qui prônent un retour à la dictature répressive. La menace d’une dérive vers la droite est stoppée avec la mort du général Franco le 20 novembre 1975.
Le retour à la démocratie
Juan Carlos Ier devient
roi le 22 novembre 1975, au lendemain de la mort de Franco. Surmontant
courageusement les
pesanteurs du régime
autoritaire toujours en place, il affiche sa volonté de démocratisation.
En juillet 1976, il oblige le Premier ministre franquiste, Carlos Arias
Navarro, à démissionner et lui désigne pour successeur
Adolfo Suárez González, qui est le grand architecte du
passage réussi de l’Espagne vers la démocratie. La
Loi de réforme politique est approuvée par référendum
en décembre 1976. Un régime parlementaire est instauré.
Le parti communiste est légalisé en mars 1977, la liberté syndicale
restaurée en avril. En juin, les députés chargés
d’établir une nouvelle Constitution sont élus démocratiquement.
Le 6 décembre 1978, cette nouvelle Constitution, instituant un
régime démocratique, est approuvée par référendum.
En restaurant des institutions représentatives et en faisant de
l’acte électoral la clé de la légitimité politique,
elle marque une rupture définitive avec le franquisme. La peine
de mort est abolie, la liberté d’information et d’expression
politique rétablie.
La Constitution de 1978 met en place un système semi-fédéral
reposant sur les régions autonomes, dotées chacune d’un
parlement et d’un gouvernement régional. Le Parlement fédéral
est bicaméral. Le Pays Basque, la Catalogne et la Galice bénéficient
d’un statut de « grande autonomie », et leurs langues
deviennent langue officielle.
Partisan du consensus, Suárez favorise la création d’un grand parti centriste, l’Union du centre démocratique (UCD). Mais en janvier 1981, il démissionne, alors que l’Espagne est confrontée à un grave déclin économique. Il est remplacé par Leopoldo Calvo Sotelo. Le mécontentement au sein de l’armée, le terrorisme basque et une situation économique précaire déstabilisent le pays pendant de longs mois. Les partisans du franquisme, restés nombreux et actifs, menacent la démocratie. Un coup d’État militaire avorte le 23 février 1981.
L’Espagne adhère à l’OTAN en mai 1982. Les élections législatives d’octobre 1982 sont marquées par l’effondrement de l’UCD et la victoire triomphale du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), dont le secrétaire, Felipe González, devient président du gouvernement. Il engage des réformes de l’enseignement privé, de la sécurité sociale et fait approuver une loi sur l’avortement. Il lance une politique de rigueur budgétaire et d’assainissement du secteur industriel public, priorité étant donnée à la rentabilité. Conjointement, la politique socialiste en faveur des chefs d’entreprise, la reprise économique mondiale et l’entrée de l’Espagne dans l’Union européenne en 1986 réamorcent la relance de l’économie espagnole.
L’Espagne dans l’Europe
De Felipe González à José María Aznar
Felipe González est réélu aux élections générales de juin 1986 et d’octobre 1989, mais son gouvernement se trouve confronté à la violence dans le Pays Basque, à l’agitation sociale, à un chômage très élevé et à une forte inflation. En 1990, des scandales de corruption impliquant des membres du gouvernement sont révélés. Malgré la tenue en 1992 des jeux Olympiques à Barcelone et de l’Exposition universelle à Séville, la crise économique s’amplifie. En juin 1993, le PSOE remporte de nouveau les élections législatives, mais perd la majorité absolue. González reste à la tête d’un gouvernement de coalition. Il est finalement battu aux élections législatives anticipées de mars 1996. Celles-ci, remportées par le Parti populaire (PP) de José María Aznar, avec seulement 38,85 % des voix et 156 sièges aux Cortes, marquent le retour de la droite au pouvoir. Le PSOE remporte, quant à lui 37,48 % des suffrages et 141 sièges.
La question des séparatismes
La question régionaliste demeure un problème brûlant. Plus de 800 personnes ont été victimes du terrorisme basque entre 1968 et la fin des années 1990. La Catalogne et le Pays Basque semblent désormais pencher en faveur d’une plus grande autonomie sans qu’il y ait pour autant une rupture totale avec le pouvoir central, d’autant plus que l’absence d’une majorité absolue aux Cortes a contraint le Parti populaire à contracter une alliance avec les partis nationalistes basque, catalan et canarien, le plus influent et le plus revendicatif d’entre eux étant le parti catalan Convergence et Union (CiU) de Jordi Pujol, fort de ses 16 sièges.
La scène politique espagnole continue à être dominée par la violence au Pays Basque. Déclarant une guerre sans merci au PP de José María Aznar, l’ETA se livre à une série d’attentats terroristes (assassinats de conseillers municipaux PP). Ceux-ci suscitent une vague d’indignation dans tout le pays (très importante manifestation à Séville, notamment), et le gouvernement adopte une ligne très dure, refusant toute concession. Dans le même temps, l’alliance du Parti populaire — tradition centralisatrice — avec les nationalistes catalans connaît de fortes tensions, notamment à la suite de l’adoption en Catalogne, en décembre 1997, d’une loi étendant l’usage du catalan à l’administration, au commerce et à l’audiovisuel. Quant au problème de la souveraineté de Gibraltar, enclave britannique sur le sol ibérique, il continue d’opposer l’Espagne à la Grande-Bretagne (regain de tension en janvier 1999).
À l’issue du procès contre les Groupes antiterroristes de libération (GAL), accusés de 28 assassinats entre 1983 et 1987 visant plusieurs hauts fonctionnaires des milieux indépendantistes basques, l’ancien ministre de l’Intérieur José Barrionuevo et l’ancien secrétaire d’État à la sécurité Rafael Vera sont condamnés à des peines de prison, puis partiellement graciés en décembre 1998.
Le 17 septembre 1998, l’ETA annonce une trêve « unilatérale et illimitée », mais l’organisation séparatiste refuse de s’autodissoudre tant que la question basque persiste. L’ETA impose comme conditions préalables au cessez-le-feu la reconnaissance du droit à l’autodétermination et le retrait des forces de sécurité du Pays Basque. Les élections du 25 octobre 1998 au Pays Basque confirment l’importance du Parti nationaliste basque (PNV), avec 27,9 % des voix, et font du PP la deuxième force politique (20,1 % des voix) de la communauté. Le 29 décembre 1998, Juan José Ibarretxe du PNV est élu à la tête du gouvernement autonome et passe, en mai 1999, un pacte de gouvernement avec les radicaux nationalistes, rompu au printemps 2000 après l’annonce de la fin de la trêve et la reprise des attentats. C’est la « faillite d’un espoir de paix » déclare Aznar.
Entre la fin de la trêve en décembre 1999 et les élections législatives anticipées de mai 2001 au Parlement basque, les attentats font trente victimes dont le président du PP d’Aragon une semaine avant le scrutin. Alliés dans un pacte antiterroriste, le PP et les socialistes du PSE pensent être en mesure de l’emporter, mais ils ne recueillent ensemble que 40,8 % des suffrages, tandis que le PNV, allié à un autre parti nationaliste modéré, Eusko Alkartasuna (EA), réalise le meilleur score de son histoire, avec 42,4 % des voix (33 sièges sur 75). Les électeurs basques semblent ainsi réaffirmer leur soutien à la cause nationaliste, mais aussi leur rejet de la violence en n’accordant que 10,2 % de leurs suffrages à Euskal Herritarrok (EH), la formation politique issue de l’ETA, qui perd la moitié de ses députés. Juan José Ibarretxe est réélu à la tête du gouvernement basque pour un second mandat de quatre ans.
Les relations internationales
Sur le plan international, l’Espagne renoue ses relations diplomatiques avec Cuba en 1998 et s’engage, le 24 mars 1999, aux côtés de treize des dix-neuf membres de l’OTAN, dans l’opération « Force alliée » menée contre la Serbie. Après 17 mois de procédures à rebondissements, la demande d’extradition vers l’Espagne de l’ancien dictateur chilien, le général Augusto Pinochet, lancée par les juges espagnols Baltasar Garzón et Manuel García Castellón est finalement rejetée par le ministre britannique de l’Intérieur Jacques Straw en janvier 2000. En novembre 1999, le juge Garzón lance des mandats d’arrêt internationaux contre 98 militaires, membres de la Junte au pouvoir en Argentine entre 1976 et 1983.
La reprise économique et le triomphe de José María Aznar
La stabilité économique s’est confirmée en 1998 et le gouvernement, qui poursuit sa politique de rigueur budgétaire, lance un vaste programme de privatisations (en 1999, la compagnie aérienne Ibéria et CASA, l’équivalent d’Aerospatiale) et un plan pour l’emploi. Lors des élections européennes du 13 juin 1999, le Parti populaire obtient 39,7 % des suffrages exprimés, et 27 sièges au Parlement européen, et le PSOE 35,34 % des voix et 24 sièges. En septembre 1999, les députés espagnols, à l’exception de ceux du PP qui s’abstiennent, condamnent officiellement le coup d’État franquiste de 1936. Le parcours « sans faute » du gouvernement Aznar est largement plébiscité aux élections générales de mars 2000. Croissance élevée (4 % en 1998, 3,7 % en 1999), baisse des déficits publics (7 % en 1995, 1,1 % en 1999), stabilisation de la dette, augmentation du niveau de vie et diminution du chômage…, autant de « bonnes notes » qui expliquent le triomphe de la droite qui, pour la première fois depuis la Transition, obtient la majorité absolue aux Cortes (183 sièges pour le PP contre 125 pour le PSOE, 8 pour les communistes et 15 pour CiU, dont le soutien n’est plus nécessaire au PP pour gouverner). José María Aznar forme alors un gouvernement de continuité, dont les priorités restent l’économie et la lutte antiterroriste.
Si l’économie demeure florissante, le problème basque en revanche ne cesse de s’aggraver. Les attentats de l’ETA, qui a rompu la trêve en janvier 2000, se multiplient touchant en 2000 et 2001 toute l’Espagne et visant, outre les magistrats et les militaires, les élus du Parti populaire et du Parti socialiste. Le 1er janvier 2002, l’Espagne assure la présidence de l’Union européenne (UE) au moment du lancement de l’euro, accueilli avec enthousiasme dans le pays. Au cours de l'année 2002, le gouvernement de José Maria Aznar est profondément remanié à la suite d'une grève générale provoquée par une réforme du système d'allocation-chômage. Il doit faire face durant l'été à un accès de tension avec le Maroc au sujet de l'îlot du Persil et, à l'automne, à la catastrophe du pétrolier Prestige au large de la Galice. Le Premier ministre est vivement critiqué pour la gestion de cette crise écologique, notamment pour avoir donné l'impression de chercher à la minimiser. En outre, l’engagement de José Maria Aznar en faveur de la guerre en Irak fait face à une population qui y est opposée à plus de 90 %.
Les attentats de 2004 et la victoire de José Luis Rodriguez Zapatero
Le 11 mars 2004, quatre trains dans des gares de Madrid et sa banlieue sont touchés par dix bombes qui explosent en quelques minutes, faisant plus de 200 morts et près de 1 500 blessés. Alors que le gouvernement attribue ces attentats à ETA, l’enquête s’oriente rapidement vers la piste islamiste, et notamment celle d’Al-Qaida. Le traumatisme collectif rappelle celui du 11 septembre 2001 aux États-Unis, d’autant que l’Espagne avait alors servi de base logistique à la préparation des attaques de New York et de Washington. Les élections législatives se déroulent dans ce contexte tragique qui voit plus de 8 millions d’Espagnols descendrent dans la rue pour s’opposer à la violence. Le 14 mars, contre toute attente, les socialistes remportent une immense victoire, à l’issue d’un scrutin marqué par une très forte participation (77,24 %). Fort de 42,6 % des voix, le PSOE obtient 164 députés au Parlement, à 12 sièges de la majorité absolue, devant le PP, crédité de 37,6 % des voix et 148 élus. La persistance du gouvernement à désigner ETA comme responsable des attentats, perçue comme une manipulation, semble avoir joué un grand rôle dans l’échec du PP.
Le dirigeant du PSOE, José Luis Zapatero, âgé de 43 ans, est élu à la majorité absolue à la présidence du gouvernement le 16 avril. Il forme un gouvernement paritaire (8 hommes et 8 femmes) et annonce le retrait des troupes espagnoles d’Irak comme il l’avait promis durant la campagne.
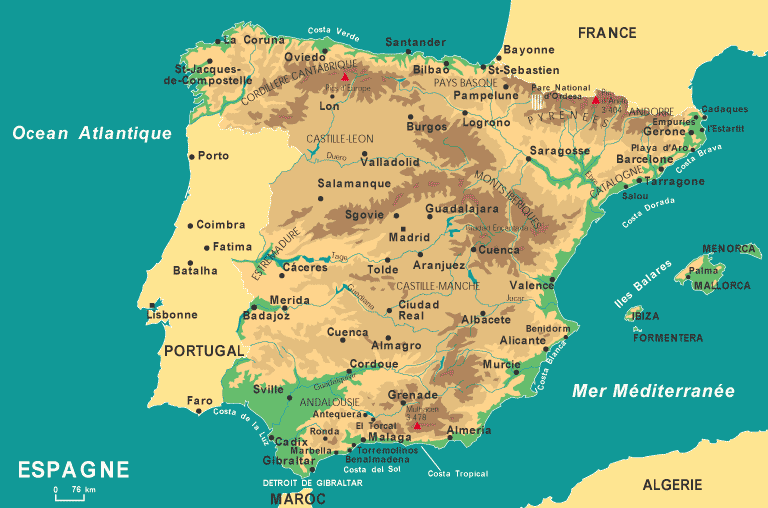
Espagne,
officiellement royaume d’Espagne, pays
du sud-ouest de l’Europe, occupant la majeure partie de la péninsule
Ibérique. Le nord-ouest du pays est ouvert sur l’océan
Atlantique et le golfe de Gascogne. Au nord-est, la chaîne des
Pyrénées marque la frontière avec la France et
la principauté d’Andorre. L’Espagne est bordée à l’est
et au sud-est par la mer Méditerranée, au sud-ouest par
l’océan Atlantique et à l’ouest par le Portugal.
Elle possède deux provinces insulaires, les îles Baléares,
en Méditerranée, et les îles Canaries, dans l’océan
Atlantique, au large de l’Afrique. Elle compte également
deux enclaves en territoire marocain, les villes de Ceuta et de Melilla. À l’extrême
pointe méridionale de l’Espagne se trouve la colonie britannique
de Gibraltar. La péninsule Ibérique n’est séparée
de l’Afrique que par un étroit bras de mer, le détroit
de Gibraltar. La superficie totale de l’Espagne, territoires
d’outre-mer compris, est de 505 990 km². Sa capitale est
Madrid.
L’Espagne est un pays maritime : les côtes atlantiques
(710 km) et méditerranéennes (1 660 km) représentent
88 % de ses frontières. L’Espagne continentale
forme un pays montagneux, au relief hercynien et alpin. Toute la
partie centrale de la péninsule (Castille, Estrémadure)
est occupée par le haut plateau de la Meseta, vaste bloc de
socle hercynien. Deux chaînes montagneuses rattachées
au système alpin viennent s’y accoler : au nord, les
Pyrénées et, au sud, la cordillère Bétique.
La Meseta est accidentée, sur sa périphérie,
par de hauts rebords montagneux : les monts Cantabriques au nord,
les monts Ibériques au nord-est, la serrania de Cuenca à l’est
et la sierra Morena au sud. Elle est coupée en son centre
par les sierras de Guadarrama et de Gredos, qui séparent les
plateaux de la Vieille-Castille, au nord, des plateaux de la Nouvelle-Castille,
au sud.
La plaine du Guadalquivir (Andalousie), au sud-ouest, et celle de
l’Èbre
(Aragon), au nord-est, sont des bassins d’effondrement tertiaires,
au contact de la Meseta et des grandes chaînes alpines. Au nord-est
de la péninsule, la chaîne des Pyrénées
forme une barrière montagneuse continue, longue de 435 km, de
l’Atlantique à la Méditerranée. Elle culmine
au sommet du pic d’Aneto (3 404 m). Au sud de la péninsule,
la cordillère Bétique s’étend sur 800 km
de long, du détroit de Gibraltar au cap de la Nao. Elle culmine
au sommet du Mulhacén (3 477 m), dans la sierra Nevada.
La plaine côtière est étroite, dépassant
rarement 32 km de large. La côte méditerranéenne
est la plus escarpée. Les grands sites portuaires y sont rares, à l’exception
du port de Barcelone. Le point culminant de l’Espagne se situe
dans les îles Canaries, au sommet du pic de Teide (3 715 m),
sur l’île de Tenerife.
Les principaux fleuves d’Espagne sont le Douro, le Miño,
le Tage, le Guadiana, le Guadalquivir et l’Èbre. Les
cinq premiers sont tributaires de l’Atlantique et ont leur
estuaire au Portugal, à l’exception du Guadalquivir.
L’Èbre, au nord-est, se jette dans la Méditerranée.
Ces fleuves traversent plaines et plateaux en perdant beaucoup de
leur eau par évaporation. Seul le Guadalquivir est navigable
sur tout son cours.





Les colonnes d'Hercules (représentation traditionnelle du détroit de Gibraltar) furent ajoutées par Charles Quint (Gand 1500 - Yuste, Estrémadure 1558), pour évoquer l'expansion outre-mer de son empire. La colonne qui porte le mot plus est surmontée d'une couronne impériale, l'autre colonne, d'une couronne royale. Les armes actuelles de l'Etat sont celles de la monarchie espagnole, que symbolisent les trois lis d'or sur champ d'azur des Bourbons, qui règnent de nouveau depuis 1975.


Catalunya, triomfant,
tornarà a ser rica i plena !
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba !Bon cop de falç !
Bon cop de falç, defensors de la terra !
Bon cop de falç !Ara és hora, segadors !
Ara és hora d'estar alerta !
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines !(répéter)
Que tremoli l'enemic
en veient la nostra ensenya :
com fem caure espigues d'or,
quan convé seguem cadenes !(répéter)
 |
|||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||

 |
 |
 |
 |
 |
 |

 |
 |
 |
 |
Certains
des éléments de cette page proviennent des sites suivants :
|





